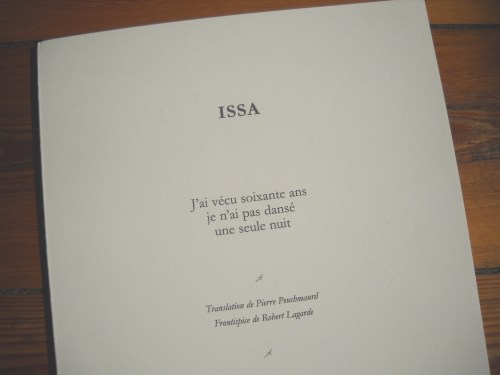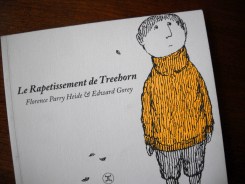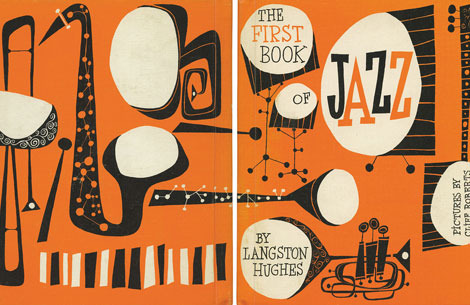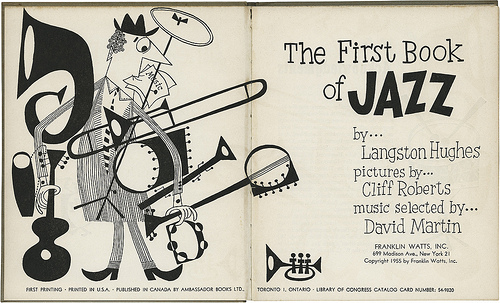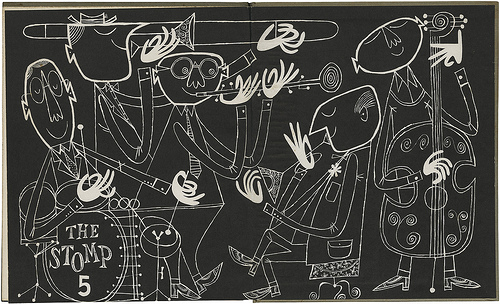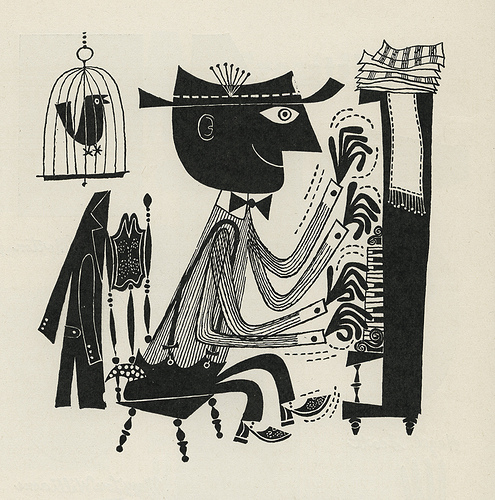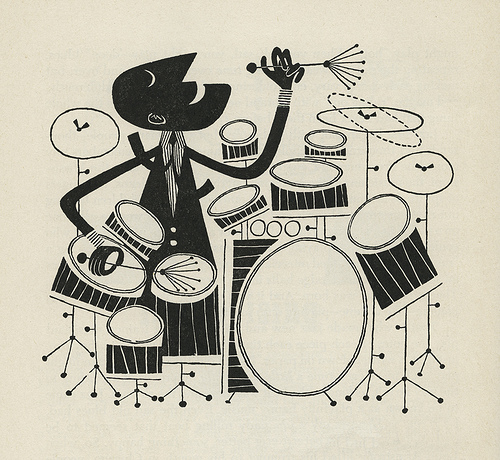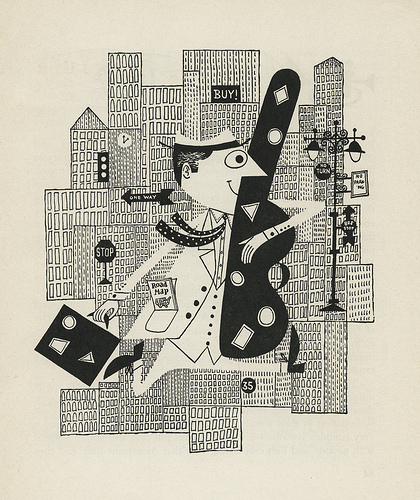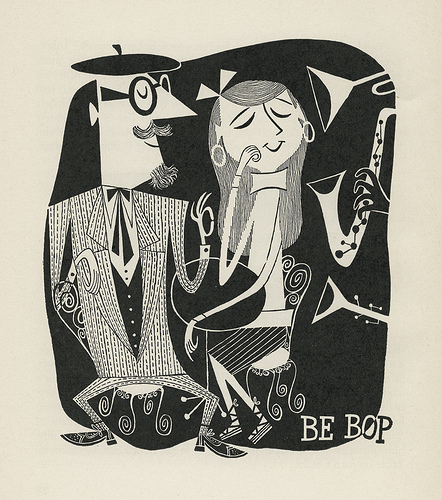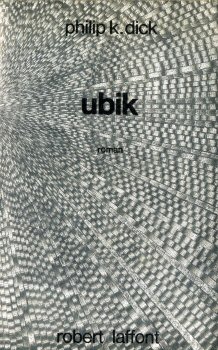In cauda venenum
Paulhan derechef, et sa brièveté légendaire. À partir de mars 1937, la Nouvelle Revue française proposa à la fin de chaque livraison un bulletin des événements, des livres et des spectacles. La rubrique était tantôt anonyme et tantôt signée Jean Guérin — alias Paulhan lui-même, qui avait comme on sait le goût du secret, des masques et de la mystification1. La concision lapidaire de ces brèves et leur ironie à froid doivent beaucoup, ce me semble, à notre cher Fénéon, auquel Paulhan consacrera en 1943 un essai fondamental, F.F. ou le Critique (repris cinq ans plus tard en préface à un volume d’Œuvres de Fénéon ; réédité en 1998 par Claire Paulhan, cette femme admirable, avec un important dossier critique).
Comme chez l’auteur des « Nouvelles en trois lignes », un fait parfaitement épinglé, en l’absence apparente de tout commentaire, devient en soi un commentaire. Par exemple dans cette brève, qui date de septembre 1937 :
Berlin. On fête la vente du trois millionième exemplaire de Mein Kampf, qui est en Allemagne le plus répandu des cadeaux de noces.
Et, comme Fénéon (voir ici), Paulhan est passé maître dans l’art de la dernière petite phrase assassine :
La mythologie pour tous, le donjuanisme petit-bourgeois, la philosophie première, l’apothéose d’un immonde crémier, ce sont autant de sujets que Jean Dutourd traite, dans un style élégant, avec éclat, abondance, désinvolture. Avec succès. Et quoi de plus ? On souhaite timidement qu’il ait un jour quelque chose à dire qui lui tienne à cœur.
Mais ce qui a rappelé Jean Guérin à mon bon souvenir, c’est ce « Bulletin » publié dans la livraison d’août 1938 de la N.R.F. (premier numéro paru après les accords de Munich), et reproduit en annexe à la correspondance Leiris-Paulhan (Claire Paulhan, 2000) dont j’achève la lecture. C’est un pense-bête pour se rappeler qu’il serait grand temps d’acquérir le choix des chroniques de Guérin proposé en deux volumes aux éditions des Cendres.
LES ÉVÉNEMENTS
Leningrad. Du 21 au 28 septembre, interdiction de prier pour la paix (d’après l’Osservatore romano).
Munich. Par les accords de Munich, la paix est sauvée. La paix dans ce qu’elle a de plus plat et de plus périssable.
Paris. Les tailleurs répandent le slogan : la paix nous donnant la joie de vivre, l’on s’habillera en clair cet hiver.
Paris. Il est question d’élever un monument à la Tchéco-Slovaquie martyre. L’on peut douter si les Tchèques attendaient de nous tant de prix et de statues.
Leipzig. L’une des nouvelles rues de Leipzig s’appelle Rue des Sudètes. Une autre Rue de la Sarre. Une autre encore Rue d’Alsace.
Berlin. Tout Israélite, porteur d’un prénom aryen, s’appellera dorénavant Israël, ou Sarah.
LES LIVRES
E. LUDWIG : la Nouvelle Sainte-Alliance (N.R.F.). — C’est l’alliance que formeraient les trois démocraties de l’Angleterre, de la France et des États-Unis. M. Ludwig nous assure qu’elle empêcherait à jamais la guerre. Peut-être.
SPECTACLES
AU THÉÂTRE SAINT-GEORGES : Duo, de Paul Géraldy. — Du roman manqué mais « nature » de Mme Colette, Paul Géraldy a tiré trois actes brillants, en trompe-l’œil. C’est un civet transformé en soufflé.
1. En fait, il semble que ce soit plus compliqué et que jusqu’à 1953, le pseudonyme ait servi parfois à d’autres auteurs. Quoi qu’il en soit, les extraits proposés ci-dessus portent incontestablement la griffe (c’est le cas de le dire) de Paulhan.
Un des noms de l’attention
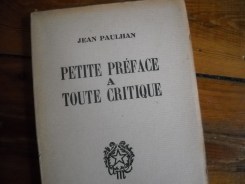
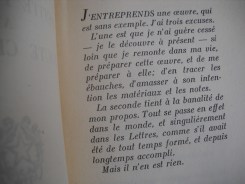
Édition originale (Minuit, 1951), acquise au Port de tête pour une dizaine d’euros. Paulhan a passé sa vie à semer des bombes à retardement, sous la forme de textes brefs, intempestifs, d’apparence limpide, et dont le sens pourtant mystérieusement se dérobe au moment où l’on croit s’en saisir. On avance en confiance, bercé par le ton aimable et modéré, les hésitations et les repentirs feints d’un causeur de bonne compagnie ; on ne voit rien venir et puis c’est trop tard : ce diable d’homme a retourné quelques vérités premières comme des gants et vous a tiré le tapis de sous les pieds.
L’ironie est sa seconde nature. Dans Petite Préface à toute critique, elle s’insinue dès l’avant-propos, qui annonce « trois excuses à ce livre », mais n’en formule que deux. (Fausse distraction : la troisième surviendra quelques chapitres plus loin.) En une centaine de pages, Paulhan se collette une fois encore avec son cher sujet, celui qu’il n’a cessé de triturer en l’envisageant chaque fois sous un angle différent, de Jacob Cow le pirate aux Fleurs de Tarbes : les équivoques du langage, le rapport problématique du mot et de l’idée, du signe et de la chose signifiée. Il le fait à sa manière sinueuse mais sûre, comme un chat matois qui fait patte de velours — mais la griffe est au bout. (Sartre en fait notablement les frais.)
[…] Car le poète ou le prosateur ne compose pas son œuvre sans se régler sur certains choix ou préférences, qui forment à la longue la raison et comme l’armature secrète du poème ou du roman. Tantôt les choix sont préparés de longue date, et tantôt subits. Mais que ce soit en dix ans ou en deux heures, la grande part du travail d’un auteur se passe en repentirs et retours, corrections, vérifications, retouches. D’un mot, en critiques — ai-je dit secrètes ? Elles ne le sont guère en tout cas de nos jours, où l’on ne trouve point de création qui ne se double d’un système critique. Observez plutôt Valéry, Proust, Gide, Claudel, Joyce, Breton, Sartre, et les autres : une bonne moitié de leur œuvre se dépense à prouver qu’ils ont eu raison d’écrire l’autre moitié.
[…] Or nous n’arrêtons guère plus haut d’évaluer les opinions, les propos, les événements mêmes, qui viennent à notre portée — et les hommes du même coup. Qui prononce sur la question sociale et la situation politique, ou décide seulement si le fond de l’air est chaud ou froid, fait de la critique, comme il fait de la prose, sans le savoir. Ce qu’on appelle penser, c’est à tout moment choisir, jauger, distinguer le vrai du faux et le valable du médiocre. Critique est l’un des noms de l’attention.
Deux autoportraits (2)
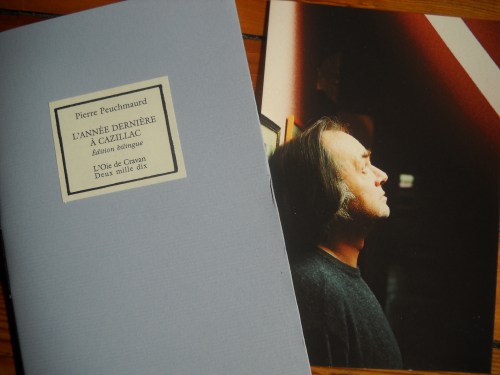
Peut-on reconnaître quelqu’un qu’on n’a pas connu ? C’est le sentiment troublant, et par moments poignant, qui nous étreint à la lecture des fragments autobiographiques réunis dans l’Année dernière à Cazillac. L’ensemble tient dans une vingtaine de pages, mais elles nous en disent plus long que de copieux mémoires en deux volumes. Pas de date ni de chronologie, pas de récit ni d’anecdotes. Plutôt une succession de moments où se révèlent un paysage mental, une manière de voir et d’être au monde : le lent réveil et le premier café, la quête du bois de chauffage, les cigarettes comme unité de mesure du temps (je lis une cigarette, je vais marcher deux cigarettes), les rituels et les superstitions intimes. Fondamentalement pessimiste et donc foncièrement disponible au merveilleux quotidien, au silence et à la rumeur du monde, Peuchmaurd est ce guetteur solitaire qui arpente son périmètre physique et imaginaire (c’est la même chose), s’invente des exercices de dépaysement dans la noiseraie entourant sa maison et n’en finit pas de se perdre pour mieux se retrouver. Ces fragments sont écrits à la troisième personne, par méfiance sans doute envers l’exercice autobiographique, pour le — et se — tenir à distance, pour marquer aussi ce que cette vie a d’ordinaire, comme toutes les autres. Il en résulte pourtant un surcroît de proximité, le sentiment très fort, la dernière page tournée, d’avoir rencontré quelqu’un.
 Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.
Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.
 L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.
L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.
Deux autoportraits (1)
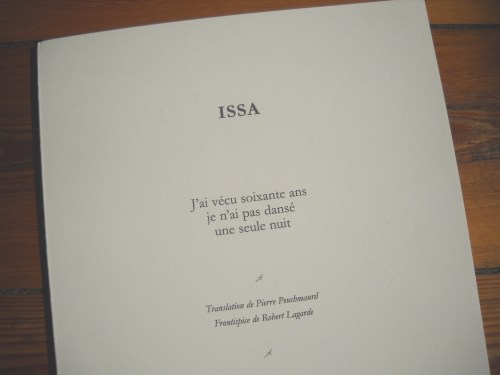
La meilleure manière de lire un auteur, c’est de le traduire, disait je ne sais plus qui. Il y a aussi la phrase célèbre de Proust : « Tout lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » On remue tout cela en lisant le recueil de haïkus d’Issa Kobayashi (1763-1828), J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit, publié à l’enseigne de La Morale merveilleuse. C’est un beau livre, parfaitement composé et imprimé par Stéphane Mirambeau. C’est un livre à deux voix superposées, où les vers d’Issa dessinent un portrait en creux de Pierre Peuchmaurd, à qui nous devons le texte français.
S’agit-il d’une traduction, d’une paraphrase, d’une transposition, d’une réappropriation, d’une réécriture ? On ne sait trop ; sans doute un peu tout cela à la fois. La couverture crédite curieusement Peuchmaurd d’une translation, jeu de mots franco-anglais qui laisse perplexe mais suggère en tout cas l’idée d’un déplacement — d’une langue à une autre, d’un univers dans l’autre, comme un jeu de vases communicants. De fait, nombreuses sont les passerelles sensibles entre ces haïkus revisités et les propres vers, les aphorismes de Peuchmaurd. Ce tercet, par exemple, pourrait être de lui : « Ce matin de printemps / on a procédé / à l’estimation de ma carcasse. » La présence lancinante en ces vers — quoique tempérée par l’ironie — de l’automne et du crépuscule, de la lente agonie de toute chose, de la vieillesse et de la mort se charge aussi pour nous d’une grande émotion — d’autant plus forte d’être murmurée à voix basse, à travers la voix d’un autre — si l’on songe que Peuchmaurd savait probablement déjà sa fin proche en préparant ce recueil.
Autre passerelle : il me semble que certains haïkus d’Issa répondent avec une jubilation contagieuse à cette interrogation de Peuchmaurd, qui surgissait tout à trac en dernière page du Bathyscaphe no 1 : « Comment faire partager poétiquement les sentiments d’un homme qui regarde le cadavre d’une tique s’enfoncer dans l’eau des toilettes où il est en train de pisser ? » Ne riez pas, c’est une vraie question. Que faire avec la trivialité ? Comment rendre un compte exact de ce peu de chose à la fois plaisant et dérisoire et saugrenu et enchanteur ? Sans tomber dans la dépréciation facile ni dans la plate vulgarité, et par pitié sans pohétiser. Eh bien, Issa a trouvé le la, la note juste, lui qui parvient à concilier avec un naturel désarmant la considération plaisante à ras de terre et le signe ascendant cher à Breton — et avec ça, sans jamais en faire un plat.
Il y a ainsi chez lui une manière réjouissante de tordre le cou au lieu commun poétique, au sein d’une forme, le haïku, que sa concision et sa simplicité trompeuse peuvent facilement faire verser dans la platitude sentimentale (comme en témoignent les innombrables succédanés produits depuis trente ans par tant de pohètes qui font du haïku comme on fait du macramé). Chez lui, quand les oies reviennent au printemps, c’est pour nous chier sur la tête.
Peuchmaurd dit tout cela bien mieux que moi. En reparcourant ses recueils de notes et d’aphorismes, je suis tombé sur ceci, dans le Pied à l’encrier : « La poésie d’Issa (ses haïku), la plus surbaissée et la plus accablante, et de ce fait la plus survolante et la plus survoltante. » Et puis sur ce raccourci à la fois très drôle et très juste : «Issa est le seul surréaliste belge japonais. » (Le Moineau par les cornes, Pierre Mainard, 2007.) C’est un fait qu’on songe parfois à Scutenaire devant cet alliage impeccable de mélancolie et d’humour, d’émerveillement et de dérision.
Pluie de printemps —
une jolie fille
passe en bâillant
Cette année encore
les oies sont venues
se faire massacrer dans les rizières
Ne regarde pas,
petit roitelet,
je vais chier dans l’herbe
Comment le saurais-je
que cette rosée
tombe pour moi ?
Oublie ça —
demain
il y aura la rosée de demain
Même
quand je sens le vin
je plais aux moustiques
Au crépuscule
l’épouvantail et moi
face à face, seuls
Et pour l’amour,
nuit après nuit
j’ai ma bouillotte
Neige et vent
dans le ciel de Shinano
Fini de rire
Matin midi, brouillard
Brouillard le soir
Et je vis là
Rien à attendre
sinon, peut-être,
la fin de l’année
Ah ! et puis on verra —
que l’année finisse
ou qu’elle ne finisse pas
Rien à dire, c’est parfait.
 ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.
ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.
 Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.
Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Frontispice de Robert Lagarde
Treehorn et ses ennuis
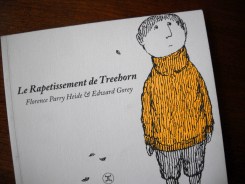

Treehorn rapetisse. Ses vêtements deviennent trop grands. À l’heure des repas, il arrive tout juste à voir au-dessus de la table. Ses efforts pour attirer l’attention sur cette embarrassante situation se heurtent à l’indifférence ou à l’incompréhension de son entourage, et tournent immanquablement au dialogue de sourds. Ses parents trouvent que Treehorn n’est pas raisonnable et qu’il devrait cesser de faire son intéressant ; et puis, qu’en diront les voisins ? Au surplus, ils ont des soucis d’adultes autrement plus importants : faire des économies (l’économie est le secret d’un ménage bien tenu, ne l’oublie pas mon garçon), surveiller la cuisson des gâteaux ou choisir un nouveau tissu d’ameublement. L’institutrice de son école tance gentiment Treehorn : ce n’est pas parce qu’on rapetisse qu’il faut se croire tout permis, et faire des bonds de cabri pour tenter d’atteindre l’abreuvoir. Le proviseur le félicite d’être venu le trouver : n’est-il pas là pour ça ? Puis il se lance dans un grand discours sur sa mission pédagogique avant d’inviter le garçon à repasser le voir si jamais il avait un problème. Les camarades de Treehorn ne lui sont d’aucune aide non plus et trouvent qu’il faut vraiment être débile pour en arriver là.
Parce que le personnage est aux prises avec un problème de taille (qu’il finira par résoudre de lui-même, au prix d’un nouvel inconvénient dont on vous laisse la surprise), on n’est pas loin de Lewis Carroll. Comme chez l’auteur d’Alice, l’humour nonsensique de l’argument et l’ironie understated de la narration se fortifient de satire sociale et d’une réflexion plus fondamentale sur le langage. « Avec les mots, disait Humpty Dumpty, l’important est de savoir qui est le maître. » Or, le maître, c’est le langage lui-même. Car avant même d’être inféodés aux convenances ou à leur position sociale, les proches de Treehorn sont prisonniers de discours tout faits qui les rassurent quant à leur existence et leur permettent de continuer à vivre les yeux fermés. C’est le secret des meilleurs livres anglo-saxons pour la jeunesse (on songe aussi à Winnie l’ourson d’A.A. Milne) que de pouvoir, en suggérant plusieurs niveaux d’interprétation, être lus à tout âge avec un enchantement égal.
Florence Parry Heide est née en 1919. Depuis Maximilien (1967), elle a publié une centaine d’ouvrages pour la jeunesse. Sa trilogie de Treehorn (dont le Rapetissement de Treehorn constitue le premier volet) est devenue un classique outre-Atlantique. Elle est illustrée, ce qui ne gâte rien, par l’aimable excentrique Edward Gorey, auteur de superbes romans graphiques cruels et macabres qui, malgré les efforts répétés de Patrick Mauriès aux éditions du Promeneur, semble voué à un succès de happy fews auprès du public francophone. Merci donc aux éditions Attila d’avoir pris le relais. Le second volet de la trilogie, le Trésor de Treehorn, vient de paraître (le troisième est annoncé pour le second semestre de cette année). Le point de départ en est moins original, mais le regard en coin de Florence Parry Heide et d’Edward Gorey, toujours aussi savoureux.
 Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.
Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.
 Attila, 2009 et 2010.
Attila, 2009 et 2010.
Dimanche en jazz 3
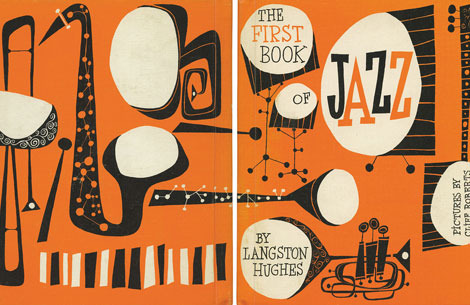
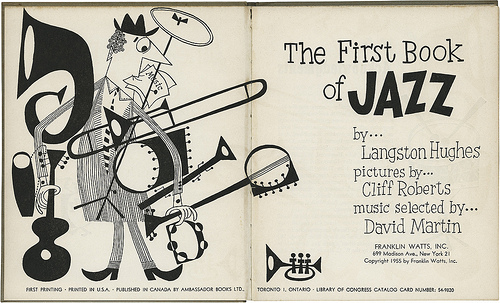
Connu surtout pour son travail de cartonniste à la télé (The Pink Panther, Mr. Magoo, puis Sesame Street et Scooby Doo), Cliff Roberts (1929-1979) illustra des livres pour enfants dans les années 1950, fit bouillir la marmite en dessinant et réalisant d’innombrables films publicitaires, éducatifs et industriels, et travailla à la pige pour de nombreux magazines, parmi lesquels Playboy et The New Yorker. Son graphisme dynamique et sa passion pour le Dixieland en faisaient l’illustrateur tout désigné de The First Book of Jazz de Langston Hughes (1955), où l’on reconnaît aisément sa patte.
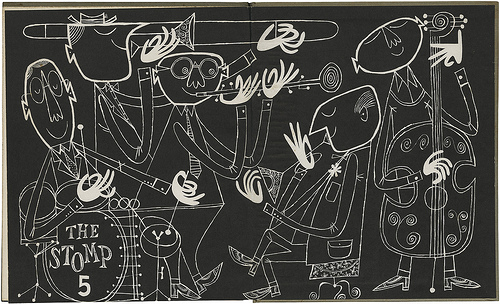
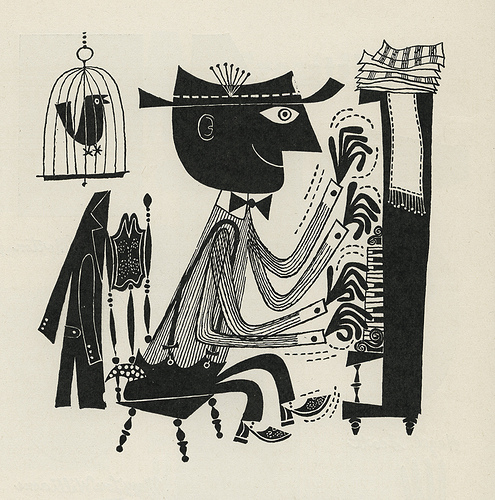
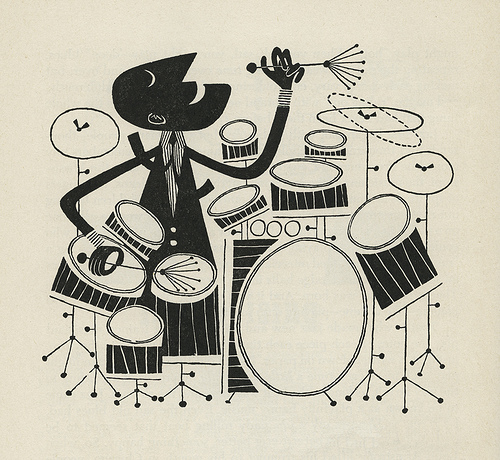
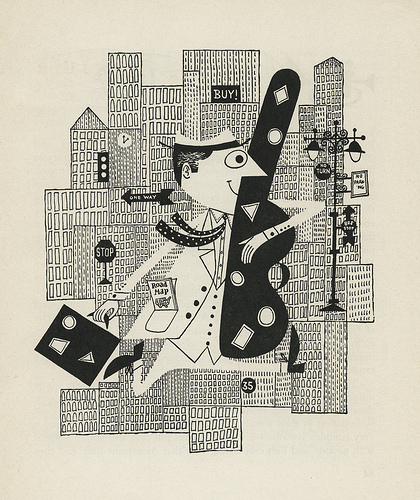
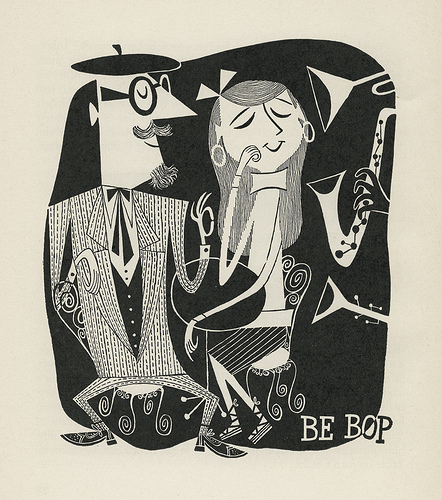
Biographie illustrée de Cliff Roberts ici (en anglais).
D’autres illustrations de The First Book of Jazz ici.
Ubikuité
Comment parler des livres qu’on aime à ceux qui ne les ont pas lus ? C’est en fait une question bien plus délicate que celle à laquelle s’est attelé Pierre Bayard il y a deux ans, avec le retentissement un rien snob qu’on sait. Comment convaincre un ami de lire « 53 jours » sans trahir le secret de ses ressorts textuels et lui gâcher la surprise ? Comment parler d’Ubik ?
Mystérieusement, je n’avais jamais lu ce roman, alors que j’aime beaucoup Philip K. Dick et qu’il s’agit de son livre le plus réputé. Il sommeillait sur mes rayons depuis — gasp — le 6 novembre 1990, date à laquelle je l’ai acquis à L’Échange, boulevard Mont-Royal, dans l’édition Laffont aux fameuses couvertures argentées (collection Ailleurs et Demain dirigée par Gérard Klein, traduction d’Alain Dorémieux : deux auteurs de SF publiés naguère par Éric Losfeld, comme on se retrouve). Et puis, avant-hier, j’ai été pris soudain du désir irrépressible de lire Ubik. Pourquoi ? Mystère. Les livres savent nous attendre le temps qu’il faut, et nous faire signe au bon moment. J’ai donc ouvert Ubik. Et je ne l’ai plus lâché.
Ce livre est extraordinaire. Totalement flippé, vertigineux, jubilatoire. Avec, comme il se doit, plusieurs niveaux de lecture enchevêtrés. Il y a des lustres que je n’avais pas dévoré un roman avec une telle excitation. Bon, toute cette rhétorique convenue de l’enthousiasme vous fait une belle jambe. Mais qu’en dire de plus pour faire envie sans déflorer le livre si peu que ce soit ? (Je ne parle même pas de la présomption qu’il y aurait à vouloir formuler un commentaire un tant soit peu original, s’agissant d’une œuvre qui a suscité des kilomètres de glose.) Par chance, j’en ignorais tout avant de l’ouvrir, et c’est tout le bonheur que je vous souhaite.
Qu’en dire alors ? Ceci, peut-être. On sait que Dick écrivait très vite. Mon intuition est que, pareil à Westlake, il ignorait où le mènerait son point de départ au moment d’introduire la première feuille dans le rouleau de sa machine à écrire, et qu’il a écrit le livre pour le découvrir. Les retournements qui explosent à la figure du lecteur, ce sont d’abord des défis que Dick lance à sa propre faculté d’invention (tiens, et de celui-là, comment vas-tu te sortir ?). Je peux me tromper. Mais quand bien même ce serait le cas, il resterait le sentiment très fort d’un livre qui s’invente à toute vitesse sous nos yeux tandis qu’alentour la réalité se désagrège et tombe en morceaux. Zut, je me tais. Lisez Ubik.
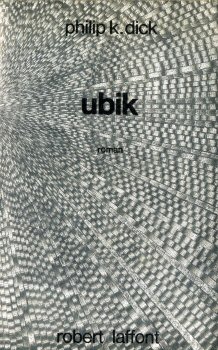






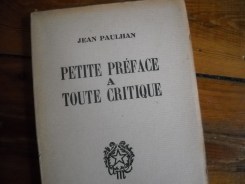
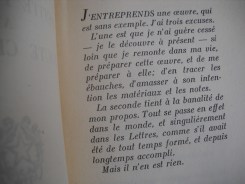
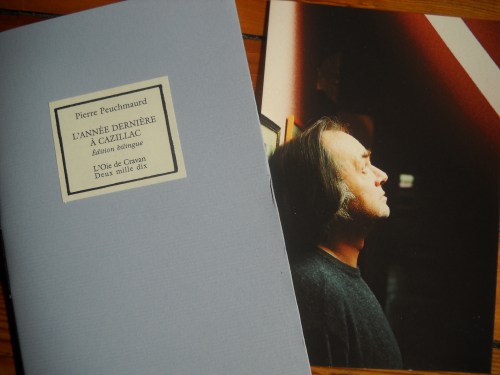
 Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.
Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput. L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.
L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.