Roger Tailleur
 En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson.
En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson.
Roger Tailleur est mort brusquement en 1985, des suites d’une leucémie aiguë. Il avait cinquante-huit ans. On ne sait pas assez qu’il fut l’un des meilleurs critiques de cinéma de sa génération. (Actes Sud a publié en 1997 un choix de ses articles, parus pour l’essentiel dans Positif. L’intelligence et l’érudition l’y disputent à l’alacrité.)
En 1968, Tailleur posa la plume, cessa de voir des films, revendit sa bibliothèque de cinéma et ne se consacra plus qu’à sa nouvelle passion : l’Italie.
Il entreprit de l’explorer région par région, province par province. Il mettait des mois à préparer ses itinéraires. Il détestait l’imprévu… Il mit à découvrir l’Italie le même acharnement, la même inépuisable érudition, le même souci du détail, le même bonheur enfin qu’il éprouvait, critique de cinéma, à tout savoir et tout retenir de la filmographie d’Henry King ou d’Humphrey Bogart.
Pour conjurer la disparition brutale de son ami, Frédéric Vitoux a écrit dans les mois qui suivirent sa mort ce récit qui est un petit chef-d’oeuvre d’émotion retenue. Il l’y fait si bien revivre qu’on a l’impression d’avoir nous aussi connu cet homme solitaire et secret, méthodique jusqu’à la manie, qui avait tourné le dos à son époque pour habiter un monde, un temps à lui, et avait élevé au rang des beaux-arts la collection – et la rédaction – de cartes postales ; son humour irrésistible, ses enthousiasmes et ses emportements, son merveilleux rire. Impossible désormais de penser à l’Italie sans penser à lui.
 Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p.
Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p.
 Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.
Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.

Double jeu
 Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.
Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.
Mathews raconte tout cela de fort drôle manière, en glissant insensiblement du récit vécu à la fiction fantasmatique. Tant que la frontière entre la réalité et la fiction reste incertaine, c’est brillant, enlevé, très réussi. Car le livre suggère finement, sans l’écrire en toutes lettres, une analogie entre le métier d’espion et celui d’écrivain : le romancier, au fond, est lui-même une sorte d’agent double du réel, qui s’inspire de la réalité, la truque et la manipule, pour en tirer une fiction, à la fois plus fausse et plus vraie. En outre, Mathews restitue avec humour et justesse le parfum de l’époque : fin de la guerre du Vietnam, Watergate, coup d’État au Chili, babacoolisme et mode de l’amour tantrique. Cependant, lorsque le livre, dans son dernier quart, bascule tout à fait dans la fiction rocambolesque, cela devient moins convaincant, et il arrive un moment où, malheureusement, on cesse d’y croire. Néanmoins, Mathews bat à plates coutures les représentants patentés de l’autofiction sur leur propre terrain. Le jeu, ici, en vaut la chandelle.
 Harry MATHEWS, Ma vie dans la CIA. Traduction de l’auteur, avec le concours de Marie Chaix. POL, 2005, 314 p.
Harry MATHEWS, Ma vie dans la CIA. Traduction de l’auteur, avec le concours de Marie Chaix. POL, 2005, 314 p.
(POL ferait bien de relire plus attentivement ses épreuves : peu de coquilles, mais énormes (deux fois j’avait) ; une traduction de bonne tenue, mais où subsistent deux ou trois calques de l’anglais spectaculaires.)
Ars nova
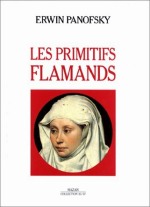 Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
L’introduction se penche sur le va-et-vient d’influences et d’emprunts réciproques entre l’Italie et la Flandre au XVe siècle, avec au passage un développement magistral sur l’avènement de la conception moderne de l’espace et l’invention de la perspective.
Les premiers chapitres analysent patiemment la lente transition qui conduit du gothique finissant à la Renaissance flamande proprement dite, traquée à la loupe à travers les livres d’heures et les miniatures franco-flamandes, l’art de la cour de Bourgogne et les écoles locales du Nord.
Tout aussi passionnant est le chapitre sur la réalité et le symbole dans la peinture flamande, où Panofsky montre par exemple, à propos de van Eyck, comment le symbolisme en vient à s’incorporer la totalité de la réalité représentée.
Suivent quatre grands chapitres consacrés aux grands maîtres de l’art flamand, le Maître de Flémalle, les van Eyck et Rogier van der Weyden. L’ouvrage se termine par une étude sur leurs continuateurs immédiats, Petrus Christus, Dirik Bouts, Geertgen tot Sint Jans, Hugo van der Goes, Gérard David, etc. Les peintres de cette génération ont conjuré l’héritage écrasant de van der Weyden en effectuant, chacun à leur manière, comme les Carrache un siècle plus tard, un retour aux sources pour mieux repartir de l’avant.
Panofsky unit la clarté de vues, l’érudition parfaitement dominée à un sens du détail au coup d’œil pénétrant, qui lui permet de retracer d’un peintre à l’autre la reprise et l’appropriation d’un motif. Chemin faisant, on apprend pourquoi van Eyck a commis une « faute » délibérée de proportion et de lumière dans sa Vierge de Berlin-Dahlem, quelle est la signification des fruits et de l’aiguière disposés dans les recoins d’une Annonciation, pourquoi l’âne baisse la tête tandis que le bœuf la lève dans une Nativité, quand s’est formulé le sentiment de la mélancolie au sens où nous l’entendons encore aujourd’hui, et bien d’autres choses encore. Bref, c’est le genre de lecture dont on sort en ayant appris à mieux voir, et c’est très stimulant.
 Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.
Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.
Paris ne finit jamais
 Sous couvert d’une conférence sur l’ironie, le narrateur évoque ses débuts littéraires à Paris, alors que, jeune écrivain un rien poseur et prétentieux, il tentait d’écrire, dans une chambre de bonne que lui avait louée Marguerite Duras, son premier roman, la Lecture assassine : l’histoire d’un livre ayant le pouvoir de tuer ses lecteurs. Ces souvenirs sont prétextes à digressions en chaîne sur la création littéraire, le Paris des écrivains passés et présents, la colonie des exilés espagnols…
Sous couvert d’une conférence sur l’ironie, le narrateur évoque ses débuts littéraires à Paris, alors que, jeune écrivain un rien poseur et prétentieux, il tentait d’écrire, dans une chambre de bonne que lui avait louée Marguerite Duras, son premier roman, la Lecture assassine : l’histoire d’un livre ayant le pouvoir de tuer ses lecteurs. Ces souvenirs sont prétextes à digressions en chaîne sur la création littéraire, le Paris des écrivains passés et présents, la colonie des exilés espagnols…
J’ai écrit « le narrateur » et pas « Vila-Matas », parce que le livre est écrit de façon telle qu’il suscite continuellement un doute déstabilisant sur la vérité de ce qui est raconté. L’auteur a-t-il vraiment participé, à Key West, à un concours de sosies d’Hemingway (!), à la consternation de son entourage (car en dépit de son intime conviction, il ne ressemble pas du tout à Hemingway) ? A-t-il croisé un matin dans la rue une Jean Seberg fantomatique ? Existait-il réellement à Paris une librairie clandestine dans laquelle un Noir prétendant être Georges Perec (!!) aurait prononcé une conférence ? Pouvait-on rencontrer, à la terrasse du Flore, un jeune millionnaire espagnol flanqué d’un secrétaire, prétendument attelé à la rédaction d’un livre dont il n’écrivit pas la première ligne, et pour lequel il salariait des dizaines d’étudiants pour effectuer des recherches en bibliothèque, lesquels l’escroquaient éhontément avec son plein consentement ? C’est par moments indécidable et c’est au point où même des événements indubitables (la mort de Franco) se colorent d’irréalité. Il en résulte un délicieux vertige borgesien, non dépourvu d’humour — les scènes avec Duras sont désopilantes — et bien accordé au propos secret du livre, méditation sur le vrai, le faux, le travestissement et l’imposture littéraire.
 Enrique VILA-MATAS, Paris ne finit jamais. Traduction d’André Gabastou. Christian Bourgois, 2004, 291 p.
Enrique VILA-MATAS, Paris ne finit jamais. Traduction d’André Gabastou. Christian Bourgois, 2004, 291 p.
Deux livres de Julian Barnes
 Recueil de chroniques sur la France, sa vie de province, sa gastronomie, ses courses cyclistes, sa littérature et son cinéma, ses peintres et ses chanteurs. Le chapitre sur Godard et Truffaut est assez décevant. Barnes est bien plus à son affaire lorsqu’il parle littérature : Baudelaire, Mallarmé, et surtout deux cents pages passionnantes sur Flaubert, évoqué à travers sa correspondance et ses carnets de travail. Le tout se conclut par un article épatant sur le statut du personnage secondaire au sein d’une composition romanesque, à travers l’exemple de la destinée du Justin de Madame Bovary, dont Barnes montre qu’elle est une sorte de miroir en réduction du roman tout entier, conçu pour passer pratiquement inaperçu, comme un détail caché dans une fresque et qui la résume tout entière. Un modèle de narratologie appliquée comme elle devrait toujours l’être : aussi passionnante qu’une enquête de Sherlock Holmes, attentive au texte, non jargonnante, et riche d’enseignements.
Recueil de chroniques sur la France, sa vie de province, sa gastronomie, ses courses cyclistes, sa littérature et son cinéma, ses peintres et ses chanteurs. Le chapitre sur Godard et Truffaut est assez décevant. Barnes est bien plus à son affaire lorsqu’il parle littérature : Baudelaire, Mallarmé, et surtout deux cents pages passionnantes sur Flaubert, évoqué à travers sa correspondance et ses carnets de travail. Le tout se conclut par un article épatant sur le statut du personnage secondaire au sein d’une composition romanesque, à travers l’exemple de la destinée du Justin de Madame Bovary, dont Barnes montre qu’elle est une sorte de miroir en réduction du roman tout entier, conçu pour passer pratiquement inaperçu, comme un détail caché dans une fresque et qui la résume tout entière. Un modèle de narratologie appliquée comme elle devrait toujours l’être : aussi passionnante qu’une enquête de Sherlock Holmes, attentive au texte, non jargonnante, et riche d’enseignements.
 Il y a, dans Quelque chose à déclarer, une page hilarante sur la difficulté de réussir une recette by the book ; on croirait se voir soi-même à l’oeuvre aux fourneaux. C’est tout le sujet d’Un homme dans sa cuisine, où Barnes raconte ses angoisses, ses réussites et ses échecs culinaires. Le titre anglais, The Pedant in the Kitchen, est beaucoup plus drôle et en accord avec le ton du livre. Car l’humour de ces chroniques vient de ce que le pédant en question est au fond victime d’une déformation professionnelle : celle du littéraire qui ne peut s’empêcher d’envisager une recette comme un texte, justiciable d’une lecture aussi serrée que, disons, un sonnet de Mallarmé — fatale erreur. Si vous êtes un anxieux obsessionnel ; si vous aimez faire la cuisine sans prédisposition particulière pour l’invention personnelle et que vous êtes donc obligé de confier votre sort à des livres de recettes ; si vous vous êtes régulièrement arraché les cheveux devant l’imprécision ou les contradictions flagrantes des dites recettes en essayant de les suivre à la lettre (la cuillerée, rase ou bombée ?), alors ce livre savoureux est pour vous.
Il y a, dans Quelque chose à déclarer, une page hilarante sur la difficulté de réussir une recette by the book ; on croirait se voir soi-même à l’oeuvre aux fourneaux. C’est tout le sujet d’Un homme dans sa cuisine, où Barnes raconte ses angoisses, ses réussites et ses échecs culinaires. Le titre anglais, The Pedant in the Kitchen, est beaucoup plus drôle et en accord avec le ton du livre. Car l’humour de ces chroniques vient de ce que le pédant en question est au fond victime d’une déformation professionnelle : celle du littéraire qui ne peut s’empêcher d’envisager une recette comme un texte, justiciable d’une lecture aussi serrée que, disons, un sonnet de Mallarmé — fatale erreur. Si vous êtes un anxieux obsessionnel ; si vous aimez faire la cuisine sans prédisposition particulière pour l’invention personnelle et que vous êtes donc obligé de confier votre sort à des livres de recettes ; si vous vous êtes régulièrement arraché les cheveux devant l’imprécision ou les contradictions flagrantes des dites recettes en essayant de les suivre à la lettre (la cuillerée, rase ou bombée ?), alors ce livre savoureux est pour vous.
 Julian BARNES, Quelque chose à déclarer. Traduction de Jean-Pierre Aoustin. Gallimard, Folio n° 4242, 2005, 410 p.
Julian BARNES, Quelque chose à déclarer. Traduction de Jean-Pierre Aoustin. Gallimard, Folio n° 4242, 2005, 410 p.
 Un homme dans sa cuisine. Traduction de Josette Chicheportiche. Mercure de France, 2005, 153 p.
Un homme dans sa cuisine. Traduction de Josette Chicheportiche. Mercure de France, 2005, 153 p.
Perecquiana

Nantis d’un appareil critique colossal mais jamais pesant, voici deux forts volumes qu’on dévore comme un roman policier. Un passionnant et émouvant work in progress, avec ses reprises, ses variantes, ses repentirs. On y voit Perec édifier pièce à pièce sa poétique, accéder à une maîtrise sereine de ses moyens, sans jamais se départir de la modestie vraie de l’artisan. Et, simultanément, la réception critique de l’écrivain évoluer au fil des ans, par le prisme des questions que lui posent ses interviouveurs.
Règles du jeu perecquien : ne jamais refaire le même livre, échafauder des constructions de plus en plus savantes où l’on introduit volontairement une erreur, un grain de sable, le petit « jeu » par où s’engouffrera la vie. Concevoir une œuvre comme un puzzle de mots qui trouvera sa place dans le vaste puzzle de la littérature (entre Verne et Queneau, Leiris et Roussel, Lowry, Melville, Flaubert et Kafka) ; comme une manière aussi de conjurer le vide de ses origines. Perec se voulait homme de lettres (les vingt-six de l’alphabet, précisait-il finement). Il rêva d’écrire un roman d’anticipation mettant en scène une société future où le jeu de scrabble aurait remplacé les échanges marchands (ce serait… « le capitalisme littéral » !). Il était aussi juif et orphelin (père tué sur le front le jour de l’Armistice, mère déportée à Auschwitz). « J’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture ; […] Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose. » Cependant, la judaïté ne signifiait pas pour lui l’allégeance à une croyance ou l’appartenance à une communauté, mais « un silence, une absence, une mise en question, un flottement, une inquiétude… » Être juif voulait dire « ne devoir la vie qu’au hasard et à l’exil. » Face au néant, Perec dut s’inventer un point de départ : ce fut la contrainte. Manière de se libérer du problème angoissant de l’expression en s’inventant de formidables stimulants à l’imagination, de repenser l’acte d’écrire en transformant un monde dénué de sens par l’intermédiaire du langage. De là la passion de l’infra-ordinaire (réapprendre à regarder la réalité qui nous entoure et que nous ne voyons plus). De là l’obsession de la liste et du dénombrement comme manière d’embrasser, d’épuiser la totalité du réel, en sachant que toujours subsisterait un vide, l’e absent de la Disparition ou la fameuse pièce manquante du puzzle de Bartlebooth.
Il y aurait mille choses à dire encore. N’en ajoutons qu’une : l’émotion singulière qui traverse ces pages. Elles font entendre non seulement la parole de l’écrivain mais quasiment le timbre de sa voix, comme pour mieux conjurer une mort prématurée – il débordait de projets –, que tous ses lecteurs ressentent encore une injustice.
 Georges PEREC, Entretiens et conférences. Édition établie par Dominique Bertelli et Mireille Ribière. Joseph K, 2003, deux volumes, 372 et 440 p.
Georges PEREC, Entretiens et conférences. Édition établie par Dominique Bertelli et Mireille Ribière. Joseph K, 2003, deux volumes, 372 et 440 p.
 En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson.
En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson. Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p.
Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p. Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.
Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.






 Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.
Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.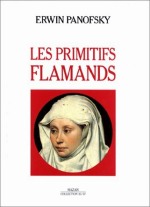 Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux. Sous couvert d’une conférence sur l’ironie, le narrateur évoque ses débuts littéraires à Paris, alors que, jeune écrivain un rien poseur et prétentieux, il tentait d’écrire, dans une chambre de bonne que lui avait louée Marguerite Duras, son premier roman, la Lecture assassine : l’histoire d’un livre ayant le pouvoir de tuer ses lecteurs. Ces souvenirs sont prétextes à digressions en chaîne sur la création littéraire, le Paris des écrivains passés et présents, la colonie des exilés espagnols…
Sous couvert d’une conférence sur l’ironie, le narrateur évoque ses débuts littéraires à Paris, alors que, jeune écrivain un rien poseur et prétentieux, il tentait d’écrire, dans une chambre de bonne que lui avait louée Marguerite Duras, son premier roman, la Lecture assassine : l’histoire d’un livre ayant le pouvoir de tuer ses lecteurs. Ces souvenirs sont prétextes à digressions en chaîne sur la création littéraire, le Paris des écrivains passés et présents, la colonie des exilés espagnols… Recueil de chroniques sur la France, sa vie de province, sa gastronomie, ses courses cyclistes, sa littérature et son cinéma, ses peintres et ses chanteurs. Le chapitre sur Godard et Truffaut est assez décevant. Barnes est bien plus à son affaire lorsqu’il parle littérature : Baudelaire, Mallarmé, et surtout deux cents pages passionnantes sur Flaubert, évoqué à travers sa correspondance et ses carnets de travail. Le tout se conclut par un article épatant sur le statut du personnage secondaire au sein d’une composition romanesque, à travers l’exemple de la destinée du Justin de Madame Bovary, dont Barnes montre qu’elle est une sorte de miroir en réduction du roman tout entier, conçu pour passer pratiquement inaperçu, comme un détail caché dans une fresque et qui la résume tout entière. Un modèle de narratologie appliquée comme elle devrait toujours l’être : aussi passionnante qu’une enquête de Sherlock Holmes, attentive au texte, non jargonnante, et riche d’enseignements.
Recueil de chroniques sur la France, sa vie de province, sa gastronomie, ses courses cyclistes, sa littérature et son cinéma, ses peintres et ses chanteurs. Le chapitre sur Godard et Truffaut est assez décevant. Barnes est bien plus à son affaire lorsqu’il parle littérature : Baudelaire, Mallarmé, et surtout deux cents pages passionnantes sur Flaubert, évoqué à travers sa correspondance et ses carnets de travail. Le tout se conclut par un article épatant sur le statut du personnage secondaire au sein d’une composition romanesque, à travers l’exemple de la destinée du Justin de Madame Bovary, dont Barnes montre qu’elle est une sorte de miroir en réduction du roman tout entier, conçu pour passer pratiquement inaperçu, comme un détail caché dans une fresque et qui la résume tout entière. Un modèle de narratologie appliquée comme elle devrait toujours l’être : aussi passionnante qu’une enquête de Sherlock Holmes, attentive au texte, non jargonnante, et riche d’enseignements. Il y a, dans Quelque chose à déclarer, une page hilarante sur la difficulté de réussir une recette by the book ; on croirait se voir soi-même à l’oeuvre aux fourneaux. C’est tout le sujet d’Un homme dans sa cuisine, où Barnes raconte ses angoisses, ses réussites et ses échecs culinaires. Le titre anglais, The Pedant in the Kitchen, est beaucoup plus drôle et en accord avec le ton du livre. Car l’humour de ces chroniques vient de ce que le pédant en question est au fond victime d’une déformation professionnelle : celle du littéraire qui ne peut s’empêcher d’envisager une recette comme un texte, justiciable d’une lecture aussi serrée que, disons, un sonnet de Mallarmé — fatale erreur. Si vous êtes un anxieux obsessionnel ; si vous aimez faire la cuisine sans prédisposition particulière pour l’invention personnelle et que vous êtes donc obligé de confier votre sort à des livres de recettes ; si vous vous êtes régulièrement arraché les cheveux devant l’imprécision ou les contradictions flagrantes des dites recettes en essayant de les suivre à la lettre (la cuillerée, rase ou bombée ?), alors ce livre savoureux est pour vous.
Il y a, dans Quelque chose à déclarer, une page hilarante sur la difficulté de réussir une recette by the book ; on croirait se voir soi-même à l’oeuvre aux fourneaux. C’est tout le sujet d’Un homme dans sa cuisine, où Barnes raconte ses angoisses, ses réussites et ses échecs culinaires. Le titre anglais, The Pedant in the Kitchen, est beaucoup plus drôle et en accord avec le ton du livre. Car l’humour de ces chroniques vient de ce que le pédant en question est au fond victime d’une déformation professionnelle : celle du littéraire qui ne peut s’empêcher d’envisager une recette comme un texte, justiciable d’une lecture aussi serrée que, disons, un sonnet de Mallarmé — fatale erreur. Si vous êtes un anxieux obsessionnel ; si vous aimez faire la cuisine sans prédisposition particulière pour l’invention personnelle et que vous êtes donc obligé de confier votre sort à des livres de recettes ; si vous vous êtes régulièrement arraché les cheveux devant l’imprécision ou les contradictions flagrantes des dites recettes en essayant de les suivre à la lettre (la cuillerée, rase ou bombée ?), alors ce livre savoureux est pour vous.