À Stockholm, au mitan des années 1960
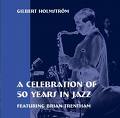 Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.
Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.
 Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.
Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.
Ken Vandermark
À moins de disposer de loisirs et de phynance illimités, suivre Ken Vandermark à la trace relève de la mission impossible. Fer de lance du renouveau de la scène chicagolaise, compositeur, poly-instrumentiste et chef de bande – mais bien moins leader en l’occurrence que meneur de jeu –, ce splendide quadragénaire anime ou participe à une quarantaine de groupes et de « projets » (c’est presque un gag) aux effectifs les plus variés : les uns ne connaissant qu’une existence ponctuelle, les autres à présent bien établis dans la durée, tel le Vandermark 5, sa formation la plus régulière, et peut-être le combo qu’on associera dans trente ans aux années 1990-2000, comme on associe les Jazz Messengers aux années 1950 et le second quintette de Miles à la décennie suivante.
Généreuse et tonique, la musique de Vandermark est un heureux carrefour dont la principale avenue reste le jazz, mais vers où convergent rock, rhythm’n’blues, free caressant ou torrentueux, et jusqu’aux contrepoints subtils de la West Coast, dans une synthèse hautement personnelle et jubilatoire. Un exemple parmi d’autres ? L’album 13 Cosmic Standards, qui alterne des compositions de Sun Ra et de George Funkadelic Clinton (il fallait y penser, et ça marche !). Là où d’autres refont le même disque chaque année, il est peu de musiciens aujourd’hui à proposer pareille variété de climats ; peu à couvrir un spectre d’une telle amplitude, depuis la composition la plus élaborée jusqu’à l’improvisation la plus radicale. Et l’on n’en voit pas d’autres pour fondre organiquement en un seul creuset le sérialisme d’un Evan Parker et la puissante assise rythmique d’un ténor musclé à la Eddie Lockjaw Davis. Vandermark, sans jeu de mots, connaît la musique. Cependant, la liste invraisemblable des dédicataires de ses pièces – qui va de Shelly Manne à Cecil Taylor en passant par Herbie Nichols et Pee Wee Russell, Stan Getz et Julius Hemphill, Albert Ayler et Witold Lutoslawski… – ne dessine ni un palmarès ni le programme d’études du parfait petit postmoderne. Elle est plus proche d’un inventaire festif à la Prévert, et témoigne qu’on peut payer un tribut paradoxal à la tradition sans cesser d’aller de l’avant.
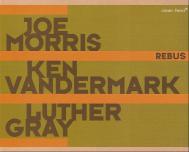 Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.
Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.
 Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).
Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).
1. Pour un avis plus favorable, lire la chronique du Grisli.
Discographie vandermarkienne très sélective :
Barrage Double Trio : Utility Hitter (Quinnah)
Vandermark 5 : Target or Flag ; Airport for Lights ; Simpatico ; Elements of Style, Exercices in Surprise (Atavistic)
School Days : In Our Time ; Crossing Division (Okkadisk)
NRG Ensemble : Bejazzo Gets a Face Lift (Atavistic)
Joe McPhee/Ken Vandermark : A Meeting in Chicago (Okkadisk).
Aaly Trio + Ken Vandermark : Stumble (Wobbly Rail)
Steelwool Trio : International Front (Okkadisk)
Spaceways Incorporated : 13 Cosmic Standards (Atavistic)
Sound in Action Trio : Design in Time (Delmark)
La griffe de Griffin

Un de mes premiers souvenirs radiophoniques de jazz, c’est un solo de ténor endiablé, phénoménal, sur un thème excitant de Gillespie, Wee ; emballé à toute allure mais imparablement tenu, et comme se consumant dans l’instant avec un brio étourdissant. Le pilote de ce bolide de course était un saxophoniste dont j’appris alors le nom, Johnny Griffin. Comme pour tant d’autres musiciens (Mal Waldron, Steve Lacy, Zoot Sims, Art Farmer,…) entendus à l’émission Jazz Soliloque de Gilles Archambault, qui aura constitué pour les gens de ma génération un cours du soir de jazz, il m’en est resté une affection durable qui est celle des premières découvertes.
Un des moments les plus drôles du film de Charlotte Zwerin, Straight, No Chaser, c’est une scène de coulisse d’un concert de Monk. On y voit Griffin entre deux sets se préparer un drink à sa façon : une bouteille de Coca dans une main, une topette de whisky dans l’autre, il se rince alternativement le gosier avec chacun de ces liquides en agitant la tête pour bien mélanger, avec une grimace irrésistible. Ailleurs, le film de Zwerin nous le montre très pro et concentré dans le travail, joyeux loustic le reste du temps – il faut le voir arborer fièrement un invraisemblable pantalon rayé sous l’œil goguenard de ses camarades de tournée.
Bref, le musicien débordait d’une vitalité contagieuse, tandis que l’homme inspirait une sympathie immédiate ; et si quatre-vingts ans est un âge respectable pour tirer sa révérence, c’est quand même avec un pincement au cœur qu’on apprend aujourd’hui la nouvelle de sa mort.
Griffin était un lion. Le hard-bopper par excellence, section Chicago, l’homme des duos-duels de ténors kolossaux avec Eddie Lockjaw Davis, mais aussi d’associations plus étonnantes (un disque en duo avec Martial Solal). Énergie, fougue et vélocité : ses meilleurs disques vous regonflent à bloc, on s’en sert une rasade au petit déjeuner et c’est une cure de vitamine C pour affronter les journées grises d’hiver.
Mais la puissance de feu, appuyée sur une technique à toute épreuve, dissimule à peine la finesse et l’humour d’un musicien bien plus futé qu’il n’y paraît. Elles en firent un partenaire de jeu aussi inattendu qu’idéal pour Thelonious Monk, «unperturbed by any idea that Monk’s music was difficult », écrivent joliment Cook et Morton. Sur les deux disques de leur concert au Five Spot, il s’empare des thèmes avec un panache flamboyant auquel s’ajoute une touche typique de malice et d’extravagance. J’ai toujours en mémoire ce moment délicieux où il transforme Evidence en ritournelle de garderie d’enfants, avant de repartir au quart de tour, en se jouant des passages d’accords anguleux de ce morceau particulièrement retors.
L’ami Tatum propose sur son blogue un superbe solo du Little Giant. Courez-y.
Valses pour Resnais
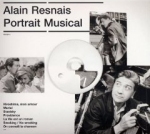 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Pas de metteur en scène plus passionné de musique que Resnais ; pas de cinéaste plus musical non plus. C’est musique que les célèbres travellings envoûtants et le montage contrapuntique, les dialogues psalmodiés d’Hiroshima ou pulvérisés de Muriel, le récitatif obsédant de Marienbad, le goût des accents étrangers, les acteurs qui se mettent à chanter avec leur voix (Muriel, La vie est un roman, Pas sur la bouche) ou celle des autres (On connaît la chanson). Providence est un grand opéra fantasmatique, l’Amour à mort un opéra de chambre viennois ; Stavisky… ne fonctionne que si on le reçoit comme un musical onirique sans chorégraphies.
D’Hiroshima mon amour à Cœurs, ce Portrait musical d’Alain Resnais propose un panorama presque exhaustif de ses longs métrages (dommage qu’on n’ait pas fait une petite place à Kander, le tableau aurait été complet). Il dessine, en treize compositeurs, un paysage d’une grande variété et d’une surprenante cohérence, hanté par une certaine qualité de rêverie inquiète que résume idéalement le fox-trot lancinant de Sondheim pour Stavisky…, et dont témoigne aussi la récurrence de valses à la fois ironiques et vénéneuses. Car si la musique au cinéma, selon Resnais, a notamment pour fonction « de faire mieux sentir la construction du film », celle qu’il obtient de ses compositeurs a aussi pour vertu d’en laisser le sens ouvert, comme en suspens dans l’air — à l’image des méduses d’On connaît la chanson —, d’en épanouir et d’en prolonger la résonance en nous.
 Alain Resnais, portrait musical. Universal.
Alain Resnais, portrait musical. Universal.
1. Avec ce trait de monomanie sympathique révélé par Bruno Fontaine, où se reconnaîtront les complétistes acharnés : « [Resnais] m’a aussi avoué son grand problème : ne pouvoir appréhender un compositeur que dans sa stricte intégralité. S’il commence à écouter Honegger, il lui faut acheter tout Honegger. Il a ce fonctionnement encyclopédique avec tous les sujets qui l’intéressent. »
Éloge de l’homme invisible (ou l’art du rebond)
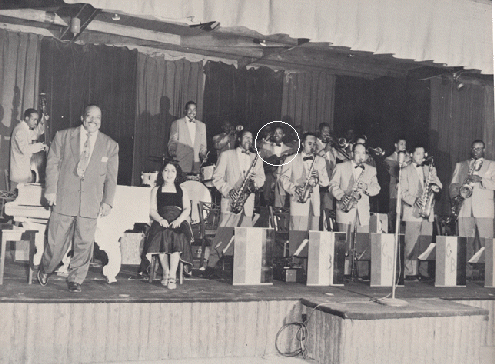
(photo de Popsie Randolph)
L’homme invisible en question, c’est le guitariste au fond de l’orchestre : c’est Freddie Green, qui fut quarante ans durant le pilier indéfectible du big band de Count Basie. Il faut se dévisser le cou pour l’apercevoir, assis derrière la section des saxos, son instrument posé presque à plat sur les genoux. Non seulement on ne le voit pas, mais au commencement on ne l’entend guère non plus. Sur les glorieuses faces Victor des années 1937-1939, enregistrements d’époque obligent, ses accords se fondent indistinctement dans la pulsation de ce qui fut la section rythmique de l’ère du swing — Walter Page à la contrebasse, Jo Jones aux baguettes —, unie comme un seul homme autour du piano de Basie, dont les relances et ponctuations sont aussi économes que judicieusement placées.

Freddie Green, Jo Jones, Walter Page et Count Basie (photo de Frank Driggs)
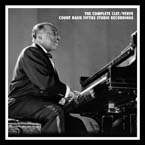 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Alors, on débouche une bouteille pour fêter ça, d’autant plus que ces faces sont un pur bonheur. Comme beaucoup d’autres patrons de bigs bands, Basie avait dû dissoudre son orchestre dans les années 1940, pour raisons économiques. Le voici à la tête d’une nouvelle formation, et c’est comme une seconde jouvence, placée sous le signe du renouveau dans la continuité. On reconnaît d’emblée les riffs enchanteurs, la prédilection pour le blues, la science de l’équilibre et des contrastes (ying et yang, ténor robuste contre ténor volatil, le tandem Eddie Lockjaw Davis/Paul Quinichette prenant le relais du tandem Hershel Evans/Lester Young) ; mais ils se déploient au sein d’une masse orchestrale plus dense et plus éclatante, tonifiée par les orchestrations d’une nouvelle génération d’arrangeurs (Neal Hefti, Nat Pierce, Johnny Mandel, Thad Jones). Côté chanteurs, ni Al Hibbler ni même Joe Williams ne font oublier le merveilleux Jimmy Rushing, mais Ella Fitzgerald est l’invitée-surprise de quatre morceaux, et ces deux-là, la chanteuse et l’orchestre, étaient nés pour jammer ensemble (ils remettront ça quelques années plus tard, sur l’excellent Ella and Basie!).
Le swing n’est pas affaire de vitesse mais de jeu sur le temps et le contretemps, un art de l’élan et du rebond. Comme pour en faire la démonstration, c’est sur tempo médium plutôt que sur tempo vif que l’orchestre ici nous ravit le plus. On dirait alors une magnifique cylindrée capable de tourner sans effort à plein régime, mais dont le moteur serait tenu en réserve de puissance ; un félin prêt à bondir à tout moment, et qui bondit parfois, mais préfère autrement avancer d’un pas souple et décontracté, en libérant au passage un swing idéalement élastique et euphorisant — l’antidote de rêve aux jours de cafard.
 The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
So long, Jimmy

Conversation en chambre : Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer et Jim Hall
Jimmy Giuffre, c’était d’abord un art de la conversation mezzo voce. Conversations avec soi-même, en des soliloques méditatifs qu’il accompagnait en tapant du pied. Duos sinueux avec l’excellent André Jaume, qui fut l’artisan de sa redécouverte à la fin des années 1980 ; on l’entendit aussi – sur des enregistrements rarissimes radiodiffusés naguère par Alain Gerber – dialoguer à la clarinette avec la rumeur urbaine, et même avec une goutte d’eau tombant du robinet dans l’évier, et c’était magnifique. Conversations à trois, enfin ou d’abord, puisque le trio – sans batterie de préférence – fut son format d’élection. Avec Jim Hall et Ralph Peña (auquel succéda Bob Brookmeyer), mais surtout avec Paul Bley et Steve Swallow, ce pionnier discret a renouvelé en profondeur l’art de l’improvisation libre. Sans grand succès public à l’époque (le trio avec Bley et Swallow s’est dissous à l’issue d’un concert dans un café new-yorkais où chaque musicien avait gagné la somme mirifique de 35 cents), mais avec un retentissement considérable auprès des musiciens, il a frayé la voie aux musiques improvisées des décennies suivantes.
Musicien phare du jazz West Coast, Giuffre fait la jonction entre les deux avenues principales de ce courant multiforme : la science de l’arrangement pour moyenne et grande formation ; l’expérimentation sur son versant cool, avec ses combinaisons instrumentales inédites (saxo/trompette/batterie ; clarinette/trombone/guitare ; clarinette/hautbois/basson/cor anglais/contrebasse, etc.). Arrangeur hors-pair rompu à l’art du contrepoint, du mariage des timbres et de la forme concertante, il compose à ses débuts, pour le big band de Woody Herman, le célèbre et toujours enchanteur Four Brothers, qui deviendra le thème emblématique du jazz californien. À Lee Konitz, Anita O’Day et quelques autres, il offre des orchestrations ensorcelantes, tapis volants déployés sous leurs pieds avec un art consommé de la dramaturgie sonore. Parallèlement, avec Shorty Rogers et Shelly Manne, puis au sein de ses trios successifs, il explore une autre manière de jouer free, loin des fureurs de la New Thing, en inventant un jazz de chambre tenté par l’abstraction évanescente et les climats debussyens, sans cesser d’être profondément enraciné dans le blues et les folk-songs du sud-ouest américain. Cet alliage de blues-based folk jazz (comme il aimait à dire) et de chambrisme à l’européenne donne à sa musique rêveuse une couleur unique, sans équivalent dans le jazz moderne – dont s’est peut-être souvenu le clarinettiste Michael Moore en enregistrant un superbe disque en trio sur des thèmes de Bob Dylan.
Jimmy Giuffre, c’était encore le compositeur merveilleux de The Train and the River, mais aussi de Gotta Dance, Jesus Maria, Emphasis, Cry Want, Me Too,… qui reviennent me hanter au moment où j’apprends avec retard et tristesse la nouvelle de sa mort, survenue le 24 avril dernier, à l’avant-veille de son quatre-vingt-septième anniversaire.
Le chaos fertile
Qu’est devenu le Mount Everest Trio ? demandions-nous voici quelque temps. Eh bien des nouvelles nous sont parvenues de Suède de manière inattendue, d’où il ressort que ses membres n’avaient en réalité jamais cessé d’être actifs sur la scène suédoise. Récemment, Conny Sjökvist a dû malheureusement poser ses baguettes pour raisons de santé ; mais Gilbert Holmström et Kjell Jansson continuent de se produire et d’enregistrer, ensemble ou séparément.
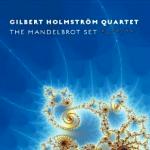 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
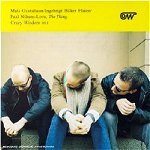 Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
 Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
 On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
 Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Gustafsson et Nilssen-Love ont aussi cosigné un réjouissant disque bruitiste dont le titre annonce la couleur : I Love It When You Snore (Smalltown Supersound). Courts extraits ici.
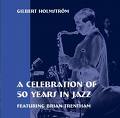 Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.
Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée. Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.
Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.





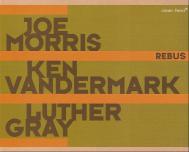 Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une
Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une 
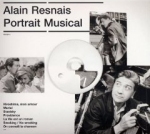 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 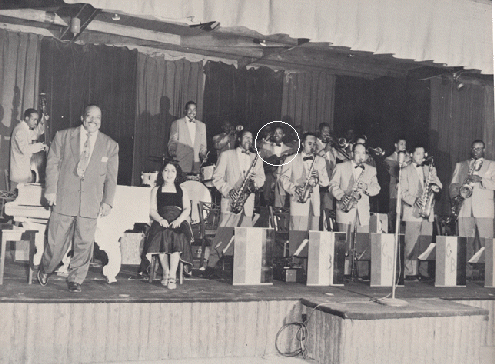

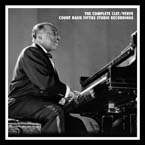 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
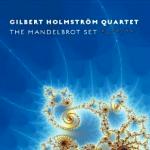 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou 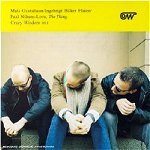 Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose. On peut écouter deux morceaux sur le
On peut écouter deux morceaux sur le