Richard Cook (1957-2007)
Certaines dépêches ne franchissent pas la Manche. C’est par hasard que je viens d’apprendre la mort de Richard Cook, survenue le 25 août dernier (un cancer foudroyant), et ça m’a flanqué un méchant coup de bourdon. Cinquante ans, ce n’est pas un âge pour casser sa pipe, et puis cela fait toujours un effet bizarre d’apprendre ce genre de nouvelles à retardement.
 Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.
Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.
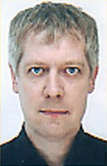 Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.
Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.
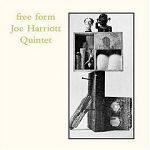 À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.
À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.
Car la curiosité de Cook, faite d’un goût personnel affirmé allié à une remarquable absence d’œillères, le portait bien au-delà des frontières du jazz. Elle embrassait pratiquement tous les genres musicaux, depuis les enregistrements d’opéra historiques jusqu’au rock, en passant par les groupes punk les plus ésotériques. Il écrivait avec autant de pertinence sur Charlie Parker, AMM, Nina Simone ou Frank Zappa. « I think writing about music is one of the hardest things you can do. Describing a piece of music in a way which isn’t either cliché-ridden or merely fanciful is desperately difficult. I suppose if I have any advice to offer, it’s the simple truth that you have to listen properly, and hard, and ask yourself what’s going on and why – like, what are these guys doing? » Alliant une information sans faille, des intuitions stimulantes et le sens de l’image concrète, Cook avait ce talent de saisir et restituer en peu de mots, de manière précise et vivante, le style d’un musicien, le développement organique d’une œuvre, le mouvement et le climat d’un solo. On s’en convaincra en lisant ses livres, car il trouva encore le temps d’en écrire trois (did he ever sleep?), tous de grand intérêt : un excellent dictionnaire, Richard Cook’s Jazz Encyclopedia (Penguin), une histoire du label Blue Note, Blue Note Records: A Biography (Justin, Charles, and Co.), et un essai sur Miles Davis, It’s About That Time: Miles Davis On and Off Record (Atlantic Press).
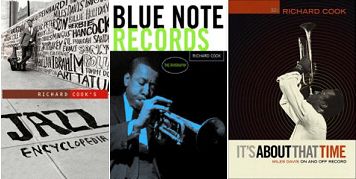
Les propos cités sont extraits d’un entretien avec Victor L. Schermer (AllAboutJazz).
À lire aussi, le bel article de Brian Morton, dans la revue en ligne Point of Departure.
Mingus at Cornell
 Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
 Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
(Merci à l’indispensable uburoi de m’avoir signalé cette parution.)
Made in Sweden
 Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
 Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Enregistrement en concert, avec une prise de son d’une grande présence dont le label Dragon semble avoir le secret (voir aussi Jazz du trio Abash, l’un des tout meilleurs live des années 1990, DRCD295).
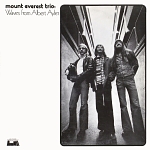 Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
 POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).
POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).
 MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).
MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).
Ganelin Trio
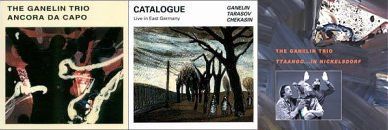
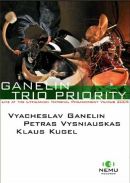 Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
 Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.
Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.
Simulacre
De la goujaterie médiatique. Rien ne remplace, dit-on, l’expérience du concert. Alors, foin de musique en conserve, bougeons nos fesses et allons voir le sextet de Machin au festival de Brol (pour lequel je me refuse à faire la moindre réclame même indirecte). Et là, juste avant l’entrée des musiciens en scène, un monsieur pincé de l’équipe du festival, aux allures de quinca branché travaillant dans la pub, vient nous informer que le concert sera filmé pour la télé et qu’en conséquence :
– le public est prié de remplir les places vacantes au devant du parterre pour que la salle n’ait pas l’air clairsemée, ça ferait mauvaise impression.
– les gens qui veulent quitter la salle (plusieurs concerts ont lieu simultanément et pas mal de gens « zappent » d’un concert à l’autre, c’est d’ailleurs désagréable) sont priés de ne pas le faire pendant les applaudissements parce qu’à ce moment-là les caméras seront tournées vers la salle et que ça ferait désordre aussi (genre : ce concert est nul, tout le monde se barre). Si vous voulez sortir, faites-le pendant les morceaux (là, ce sont les musiciens que ça risque de perturber, mais quelle importance ?)
Tout cela énoncé sans amabilité, sur un ton agacé d’une morgue invraisemblable. On croit rêver. En somme j’ai payé ma place pour faire de la figuration intelligente à la télé. Public, tu n’es pour ces gens-là que du bétail (heureusement, ledit bétail n’en fera qu’à sa tête). Et les musiciens sont logés à la même enseigne.
Durant toute la durée du concert, une caméra-robot posée sur rails se promène dans la fosse en balayant la scène d’un mouvement pendulaire hypnotisant. Une autre caméra montée sur grue plane au-dessus de nos têtes comme un oiseau de proie menaçant. Ambiance très Big Brother. Et quand le pianiste entame son solo, un caméraman se plante devant pour cadrer ses mains et bien nous boucher la vue. On aura quand même le plaisir de voir Machin s’énerver sur le deuxième caméraman accroupi dans le chemin, qui l’empêchait de revenir prendre à temps son solo au centre de la scène. N’empêche que ce déploiement technologique aura volé, par son parasitisme intempestif, la vedette de la soirée, et avec un côté : « ôtez-vous de là que je m’y mette, foutus musicos qui m’empêchez de faire mon travail. » Si bien que je n’aurai pas eu l’impression d’assister en direct à un concert, mais d’être déjà en différé, dans la diffusion future de la soirée à la télé – en somme, de participer à un simulacre. Un « live » déréalisé en temps réel, il fallait le faire. Eh bien merci beaucoup. La prochaine fois je resterai chez moi à écouter de la musique en conserve, ça nous fera gagner du temps.
Monk’s Casino
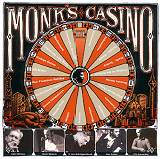 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
 Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Tina May
 A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
 Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).
Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).
 Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.
Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.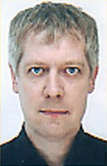 Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.
Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.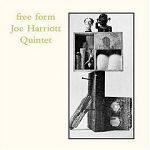 À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.
À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.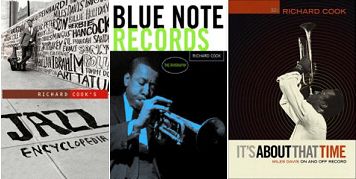






 Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance. Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note. Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation. Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.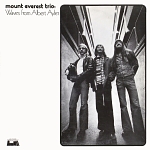 Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé. MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).
MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).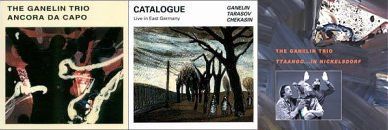
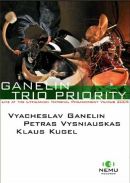 Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.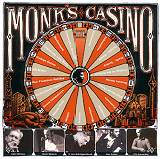 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman. A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !