Lennie’s Pennies
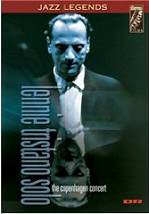 Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Le concert est filmé comme ils devraient toujours l’être. Quelques angles bien choisis, le visage, les mains, des plans longs et le plus souvent fixes, entièrement au service de la musique qui n’en devient que plus captivante.
 Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Anita O’Day (1919-2006)

Bien sûr il y a Ella, Billie, Sarah, sans oublier notre chère Helen Merrill… mais dans notre coeur il y avait, il y aura toujours une place spéciale pour Anita : sa classe et sa gouaille de délurée, ses scats acrobatiques, le grain sensuel de sa voix à tomber raide amoureux, sa science éblouissante du phrasé qui savait vous faire chavirer rien qu’en plaçant une note altérée en bout de phrase, son caractère en acier trempé: il fallait ça pour débuter adolescente dans les marathons dansants façon On achève bien les chevaux, avant de rejoindre le big band de Gene Krupa (elle refuse la robe du soir qui était alors l’apanage des chanteuses pour se produire en veston et jupe courte); et pour affronter bravement des parterres de crétins qui la sifflèrent et l’insultèrent grossièrement à Comblain-la-Tour en 1966 et Paris en 1970 parce qu’elle était blanche.
Elle resta étiquetée chanteuse de big band, et Verve la fit souvent enregistrer avec grand orchestre et arrangements profus, mais elle préférait le travail en petite formation et c’est dans ce contexte qu’elle aura donné le meilleur d’elle-même.
High Times, Hard Times, le titre de son autobiographie résume parfaitement une carrière en dents de scie. Mais cette battante aura survécu aux coups durs, à l’alcool et à la drogue, et continuait, à quatre-vingts ans passés, à se produire sur scène et à donner des interviews de grande dame indigne, réjouissantes d’humour et d’esprit.
Sa discographie disponible reste lacunaire, Verve ayant préféré, à quelques exceptions près, la saucissonner en compils (d’ailleurs bien composées) plutôt que rééditer les albums originaux (plusieurs d’entre eux furent repressés au Japon, mais sont à présent introuvables). Dans l’état actuel du catalogue, on se fera une bonne idée de l’étendue de son art en fréquentant les disques Anita Sings The Winners, Pick Yourself Up, Anita Sings the Most, Jazz Masters 1949 et Anita O’Day’s Finest Hour.
On peut enfin la voir dans Jazz on a Summer’s Day (festival de Newport, 1958), film aussi passionnant qu’agaçant en raison d’un montage absurde qui privilégie les vignettes d’ambiance sur les plaisanciers et les badauds mangeurs d’esquimaux glacés au lieu de se concentrer sur les musiciens. Mais enfin, Anita est là, en robe noire et sous un chapeau extravagant, qui détaille avec une gourmandise narquoise un Sweet Georgia Brown en crescendo avant d’emballer Tea for Two à toute vibure, jusqu’à une finale gag irrésistible. Quelle femme !
***
Addendum (mars 2008). Depuis que ces lignes furent écrites, certains Verve japonais sont à nouveau sporadiquement disponibles sous nos cieux. This Is Anita, Trav’lin’ Light, Waiter, Make mine Blues et Cool Heat (superbement arrangé par Jimmy Giuffre) sont tous d’excellents disques. Sous le titre Anita Sings for Oscar, Lonehill Jazz a réuni sur une seule galette Pick Yourself Up et Anita Sings the Most : excellente affaire (quoi qu’on pense des pratiques peu scrupuleuses de ce label). Néanmoins, il serait grand temps que Verve fasse à Anita l’honneur d’une intégrale soignée, sur le modèle de celles de Lester Young et de Billie Holiday.
Destination… Out !
Sous cet intitulé emprunté à l’un des meilleurs Blue Note de Jackie McLean se cache un excellent blogue consacré au free jazz, avec nombreux extraits en èmme-pé-trois de disques rares ou épuisés, qui restent accessibles une quinzaine de jours.
À ne pas manquer pendant que c’est en ligne, une pièce aussi brève que volcanique de Pharoah Sanders avec le Jazz Composers Orchestra, Preview, d’une montée en puissance impitoyable. On dirait la bande-son d’un de ces rêves où un désastre imminent va nous foudroyer sur place et qu’on reste paralysé, incapable d’arracher les pieds du sol.
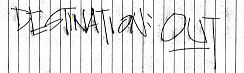
Braxton soliloque
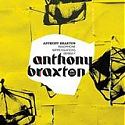 En février 1972, quatre ans après le coup d’éclat de For Alto, Anthony Braxton enregistre à Paris une nouvelle série d’improvisations au saxophone alto. Il y poursuit l’exploration méthodique des ressources de son instrument, en termes de tonalité, de phrasé, de structures, d’harmonie et de textures sonores. Dans l’intervalle, le discours a gagné en sérénité, et moins encore que For Alto (dont le caractère de manifeste radical avait parfois quelque chose de démonstratif), on ne saurait réduire les neuf pièces ici réunies à des exercices de laboratoire. À cheval sur l’improvisation libre et la musique contemporaine, tantôt saturant l’espace sonore et tantôt jouant de la parcimonie et du silence, Braxton s’absorbe le plus souvent dans une introspection à la fois réfléchie et rêveuse, en un soliloque inspiré et captivant de bout en bout.
En février 1972, quatre ans après le coup d’éclat de For Alto, Anthony Braxton enregistre à Paris une nouvelle série d’improvisations au saxophone alto. Il y poursuit l’exploration méthodique des ressources de son instrument, en termes de tonalité, de phrasé, de structures, d’harmonie et de textures sonores. Dans l’intervalle, le discours a gagné en sérénité, et moins encore que For Alto (dont le caractère de manifeste radical avait parfois quelque chose de démonstratif), on ne saurait réduire les neuf pièces ici réunies à des exercices de laboratoire. À cheval sur l’improvisation libre et la musique contemporaine, tantôt saturant l’espace sonore et tantôt jouant de la parcimonie et du silence, Braxton s’absorbe le plus souvent dans une introspection à la fois réfléchie et rêveuse, en un soliloque inspiré et captivant de bout en bout.

Anthony BRAXTON, Saxophone Improvisations Series F. Free America / Universal 087 345-2.
Youtuberie : Impressions (John Coltrane). Braxton (as), Chick Corea (p), Miroslav Vitous (cb), Jack DeJohnette (bt). Woodstock Jazz Festival, 19 septembre 1981.
Out of Nowhere
 Warne Marsh est mort sur scène en 1987, alors qu’il interprétait Out of Nowhere. Une fin étrangement emblématique pour un musicien dont le timbre sans vibrato, aussi singulier qu’immédiatement reconnaissable, semble en effet surgir de nulle part, et qui aura passé l’essentiel de sa vie dans les clubs de jazz en creusant son sillon dans une tranquille indifférence aux modes. Disciple de Lennie Tristano, Marsh est l’un des rares saxos de sa génération à avoir contourné l’influence écrasante de Charlie Parker pour s’inventer un langage totalement personnel, dont les harmonies obliques et subtiles se déploient en longues volutes aériennes. Sa discographie restant on ne peut plus lacunaire, toute réédition est la bienvenue, et celle de Ne Plus Ultra (1969) tout particulièrement puisqu’il s’agit d’un des meilleurs disques de ce grand unsung hero de l’histoire du jazz.
Warne Marsh est mort sur scène en 1987, alors qu’il interprétait Out of Nowhere. Une fin étrangement emblématique pour un musicien dont le timbre sans vibrato, aussi singulier qu’immédiatement reconnaissable, semble en effet surgir de nulle part, et qui aura passé l’essentiel de sa vie dans les clubs de jazz en creusant son sillon dans une tranquille indifférence aux modes. Disciple de Lennie Tristano, Marsh est l’un des rares saxos de sa génération à avoir contourné l’influence écrasante de Charlie Parker pour s’inventer un langage totalement personnel, dont les harmonies obliques et subtiles se déploient en longues volutes aériennes. Sa discographie restant on ne peut plus lacunaire, toute réédition est la bienvenue, et celle de Ne Plus Ultra (1969) tout particulièrement puisqu’il s’agit d’un des meilleurs disques de ce grand unsung hero de l’histoire du jazz.
De Lee Konitz à Pete Christlieb en passant par Art Pepper, Marsh a toujours affectionné le dialogue avec un second souffleur. Il trouve ici en l’excellent Gary Foster un coéquipier idéal. Leurs dialogues fugués où le ténor et l’alto se croisent, s’éloignent, se rejoignent et s’entremêlent sont merveilleusement grisants (cf. par exemple la superbe intro en apesanteur de You Stepped Out of a Dream). Le reste du programme comprend une poignée de chevaux de bataille sur lesquels Marsh a inlassablement improvisé toute sa vie, soit deux compositions de son maître Tristano, Lennie’s Pennies (sur les accords de Pennies From Heaven) et le toujours enchanteur 317 E. 32nd (dérivé, le revoici, de Out of Nowhere), et une pièce de son ex-partenaire Konitz, Subconscious-lee (réécriture de What Is This Thing Called Love), avant un grand morceau d’improvisation collective, Touch and Go (qui rappelle au passage que Marsh participa aux deux premiers morceaux free à avoir été gravés sur disque, Intuition et Digression, en 1949, avec Tristano). En brève coda, une Invention de Bach, où Marsh et Foster prennent congé sur un dernier canon qui est comme la quintessence de leur art : l’élégance et l’intelligence au service d’une émotion pure, filtrée de tout sentimentalisme.

Warne MARSH Quartet, Ne Plus Ultra. HatOLOGY 603.
Don Friedman
Avez-vous jamais remarqué que, quand vous entendez un nom
qui vous frappe, vous croyez pour un temps le retrouver sans cesse ?
John Buchan, la Centrale d’énergie
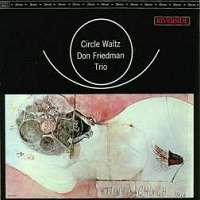 Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.
Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.

Don FRIEDMAN, Circle Waltz. Riverside/OJCCD 1885.
Les possibilités du dialogue
 Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.
Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.

Warren VACHÉ / Bill CHARLAP, 2gether. Nagel-Hayer 2011. La prise de son est splendide.
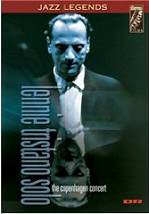 Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…). Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.






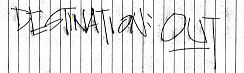
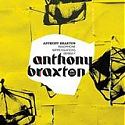 En février 1972, quatre ans après le coup d’éclat de For Alto, Anthony Braxton enregistre à Paris une nouvelle série d’improvisations au saxophone alto. Il y poursuit l’exploration méthodique des ressources de son instrument, en termes de tonalité, de phrasé, de structures, d’harmonie et de textures sonores. Dans l’intervalle, le discours a gagné en sérénité, et moins encore que For Alto (dont le caractère de manifeste radical avait parfois quelque chose de démonstratif), on ne saurait réduire les neuf pièces ici réunies à des exercices de laboratoire. À cheval sur l’improvisation libre et la musique contemporaine, tantôt saturant l’espace sonore et tantôt jouant de la parcimonie et du silence, Braxton s’absorbe le plus souvent dans une introspection à la fois réfléchie et rêveuse, en un soliloque inspiré et captivant de bout en bout.
En février 1972, quatre ans après le coup d’éclat de For Alto, Anthony Braxton enregistre à Paris une nouvelle série d’improvisations au saxophone alto. Il y poursuit l’exploration méthodique des ressources de son instrument, en termes de tonalité, de phrasé, de structures, d’harmonie et de textures sonores. Dans l’intervalle, le discours a gagné en sérénité, et moins encore que For Alto (dont le caractère de manifeste radical avait parfois quelque chose de démonstratif), on ne saurait réduire les neuf pièces ici réunies à des exercices de laboratoire. À cheval sur l’improvisation libre et la musique contemporaine, tantôt saturant l’espace sonore et tantôt jouant de la parcimonie et du silence, Braxton s’absorbe le plus souvent dans une introspection à la fois réfléchie et rêveuse, en un soliloque inspiré et captivant de bout en bout. Warne Marsh est mort sur scène en 1987, alors qu’il interprétait Out of Nowhere. Une fin étrangement emblématique pour un musicien dont le timbre sans vibrato, aussi singulier qu’immédiatement reconnaissable, semble en effet surgir de nulle part, et qui aura passé l’essentiel de sa vie dans les clubs de jazz en creusant son sillon dans une tranquille indifférence aux modes. Disciple de Lennie Tristano, Marsh est l’un des rares saxos de sa génération à avoir contourné l’influence écrasante de Charlie Parker pour s’inventer un langage totalement personnel, dont les harmonies obliques et subtiles se déploient en longues volutes aériennes. Sa discographie restant on ne peut plus lacunaire, toute réédition est la bienvenue, et celle de Ne Plus Ultra (1969) tout particulièrement puisqu’il s’agit d’un des meilleurs disques de ce grand unsung hero de l’histoire du jazz.
Warne Marsh est mort sur scène en 1987, alors qu’il interprétait Out of Nowhere. Une fin étrangement emblématique pour un musicien dont le timbre sans vibrato, aussi singulier qu’immédiatement reconnaissable, semble en effet surgir de nulle part, et qui aura passé l’essentiel de sa vie dans les clubs de jazz en creusant son sillon dans une tranquille indifférence aux modes. Disciple de Lennie Tristano, Marsh est l’un des rares saxos de sa génération à avoir contourné l’influence écrasante de Charlie Parker pour s’inventer un langage totalement personnel, dont les harmonies obliques et subtiles se déploient en longues volutes aériennes. Sa discographie restant on ne peut plus lacunaire, toute réédition est la bienvenue, et celle de Ne Plus Ultra (1969) tout particulièrement puisqu’il s’agit d’un des meilleurs disques de ce grand unsung hero de l’histoire du jazz.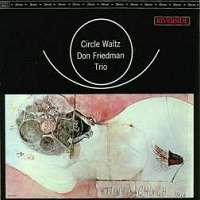 Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.
Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé. Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.
Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.