Lectures expresses
Andrea Camilleri, Indulgences à la carte (la Bolla di componenda, 1993). Traduit de l’italien par Louis Bonalumi. Le Promeneur, « le Cabinet des lettrés », 2002.
 Mariant l’histoire sociale, l’histoire des mentalités et le récit d’épisodes vécus, Andrea Camilleri examine dans ce court essai l’hypothèse selon laquelle la culture sicilienne de l’accommodement, des petits arrangements entre amis, de la compromission, sur quoi ont prospéré le brigandage et la mafia, aurait pour origine le système des indulgences de l’Église catholique. On laissera aux historiens le soin de trancher. La démonstration est d’autant plus plaisante que Camilleri essayiste ne cesse pas d’être le conteur savoureux que nous ont révélé ses romans, et que sa manière d’avancer par méandres et digressions est bien séduisante.
Mariant l’histoire sociale, l’histoire des mentalités et le récit d’épisodes vécus, Andrea Camilleri examine dans ce court essai l’hypothèse selon laquelle la culture sicilienne de l’accommodement, des petits arrangements entre amis, de la compromission, sur quoi ont prospéré le brigandage et la mafia, aurait pour origine le système des indulgences de l’Église catholique. On laissera aux historiens le soin de trancher. La démonstration est d’autant plus plaisante que Camilleri essayiste ne cesse pas d’être le conteur savoureux que nous ont révélé ses romans, et que sa manière d’avancer par méandres et digressions est bien séduisante.
Louise de Vilmorin, la Lettre dans un taxi. Gallimard, 1958. Rééd. « l’Imaginaire », 1998.
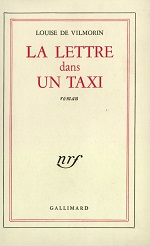 Comment l’oubli d’une lettre dans un taxi – lettre non réellement compromettante mais susceptible d’être mal interprétée – déclenche une tempête dans le cœur de l’héroïne, et comment ses efforts pour la récupérer, en l’obligeant à multiplier les demi-mensonges, l’enferrent dans une situation inextricable. Par touches rapides et légères, Louise de Vilmorin construit un suspense émotionnel où l’on pèse des œufs de mouche dans des toiles d’araignée, propre à séduire les amateurs du cinéma d’Éric Rohmer.
Comment l’oubli d’une lettre dans un taxi – lettre non réellement compromettante mais susceptible d’être mal interprétée – déclenche une tempête dans le cœur de l’héroïne, et comment ses efforts pour la récupérer, en l’obligeant à multiplier les demi-mensonges, l’enferrent dans une situation inextricable. Par touches rapides et légères, Louise de Vilmorin construit un suspense émotionnel où l’on pèse des œufs de mouche dans des toiles d’araignée, propre à séduire les amateurs du cinéma d’Éric Rohmer.
Typo des villes (73)
M A R S E I L L E



Notre vieille amie la Jackson.


N I C E



M E N T O N


On affectionne le contraste entre l’ambition de l’enseigne et la décrépitude de la façade.





Chambres

Liège, rue des Hirondelles

Marseille, hôtel Ibis Styles

Saint-Mandrier

Nice, hôtel Byakko
Lectures expresses
William Goldman, les Aventures d’un scénariste à Hollywood. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Rousselot, Capricci, 2022. Pas d’index.
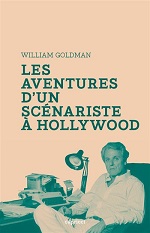 Il s’agit d’un choix d’une vingtaine de chapitres, effectué par le traducteur Jean Rousselot dans deux volumes de mémoires parus en 1983 et 2000. Romancier « entré dans l’univers du cinéma sur un malentendu total », William Goldman compte à son palmarès les scénarios de Harper, Butch Cassidy et le Kid, la Kermesse des aigles, Marathon Man, les Hommes du président (d’où il fut débarqué ; Pakula était apparemment coutumier du fait), l’Étoffe des héros (qu’il quitta de lui-même à la suite d’un différend de fond avec Kaufman), Princess Bride, Misery, Absolute Power et bien d’autres plus oubliables. Le cinéphile aussi bien que l’apprenti scénariste tireront autant de profit que d’agrément de la lecture de ses mémoires. Sur un ton familier et chaleureux multipliant les adresses au lecteur, Goldman raconte avec entrain, humour et franchise ses débuts dans la profession, ses réussites et ses échecs, également riches en enseignements. Outre les aperçus concrets sur la scénarisation – l’importance du point de vue, le moment clé de l’exposition, la construction d’un film, d’une scène, etc. –, son témoignage est instructif sur l’étape de la mise en chantier d’un projet et l’espèce de folie permanente qui règne dans le monde du cinéma : le producteur qu’il faut intéresser (et qui demande des réécritures), lequel se met en quête de vedettes et d’un metteur en scène (qui demandent à leur tour des réécritures), les querelles d’égos et d’argent de tout ce petit monde… C’est un tel parcours du combattant qu’on se demande, à le lire, par quel miracle un film parvient à voir le jour.
Il s’agit d’un choix d’une vingtaine de chapitres, effectué par le traducteur Jean Rousselot dans deux volumes de mémoires parus en 1983 et 2000. Romancier « entré dans l’univers du cinéma sur un malentendu total », William Goldman compte à son palmarès les scénarios de Harper, Butch Cassidy et le Kid, la Kermesse des aigles, Marathon Man, les Hommes du président (d’où il fut débarqué ; Pakula était apparemment coutumier du fait), l’Étoffe des héros (qu’il quitta de lui-même à la suite d’un différend de fond avec Kaufman), Princess Bride, Misery, Absolute Power et bien d’autres plus oubliables. Le cinéphile aussi bien que l’apprenti scénariste tireront autant de profit que d’agrément de la lecture de ses mémoires. Sur un ton familier et chaleureux multipliant les adresses au lecteur, Goldman raconte avec entrain, humour et franchise ses débuts dans la profession, ses réussites et ses échecs, également riches en enseignements. Outre les aperçus concrets sur la scénarisation – l’importance du point de vue, le moment clé de l’exposition, la construction d’un film, d’une scène, etc. –, son témoignage est instructif sur l’étape de la mise en chantier d’un projet et l’espèce de folie permanente qui règne dans le monde du cinéma : le producteur qu’il faut intéresser (et qui demande des réécritures), lequel se met en quête de vedettes et d’un metteur en scène (qui demandent à leur tour des réécritures), les querelles d’égos et d’argent de tout ce petit monde… C’est un tel parcours du combattant qu’on se demande, à le lire, par quel miracle un film parvient à voir le jour.
Chambres

Lille, Holiday Inn Express
Lectures expresses
Paul Morand, Flèche d’Orient. Paris, Gallimard, « les Rois du jour », 1932. Belle composition typographique aérée. Texte repris dans Nouvelles complètes, vol. 1, Bibliothèque de la Pléiade, 1992.
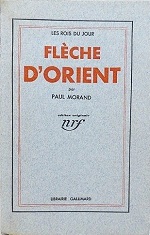 Paul Morand est un mélange désarmant d’intelligence et de sottise. Il sait admirablement voir les choses et les donner à voir. On aimerait qu’il s’en tienne là et nous épargne des considérations débiles sur l’âme des peuples et le destin des civilisations. Les cent soixante-dix pages de Flèche d’Orient s’avalent d’un trait. On peut en résumer l’argument comme suit. À la suite d’un pari mondain idiot, un Russe blanc exilé en France effectue un voyage éclair en Roumanie pour y faire l’emplette de caviar, ceci afin de prouver l’incomparable rapidité de la ligne aérienne Paris-Bucarest nouvellement ouverte. Sur place, rien ne passe comme prévu. Notre homme s’engourdit inexplicablement. Diverses rencontres l’entraînent à l’est, toujours plus à l’est, jusqu’à la frontière de son ancienne patrie où il sent retentir en lui l’appel éternel de l’âme slave. Dimitri ne rentrera pas en France.
Paul Morand est un mélange désarmant d’intelligence et de sottise. Il sait admirablement voir les choses et les donner à voir. On aimerait qu’il s’en tienne là et nous épargne des considérations débiles sur l’âme des peuples et le destin des civilisations. Les cent soixante-dix pages de Flèche d’Orient s’avalent d’un trait. On peut en résumer l’argument comme suit. À la suite d’un pari mondain idiot, un Russe blanc exilé en France effectue un voyage éclair en Roumanie pour y faire l’emplette de caviar, ceci afin de prouver l’incomparable rapidité de la ligne aérienne Paris-Bucarest nouvellement ouverte. Sur place, rien ne passe comme prévu. Notre homme s’engourdit inexplicablement. Diverses rencontres l’entraînent à l’est, toujours plus à l’est, jusqu’à la frontière de son ancienne patrie où il sent retentir en lui l’appel éternel de l’âme slave. Dimitri ne rentrera pas en France.
Ah ouiche. Passons sur cette fin aussi idiote qu’artificieuse tant elle paraît plaquée sur le récit à des fins de démonstration. Auparavant, et heureusement pour nous, le romancier Morand s’est montré plus inspiré que l’idéologue. Le récit, comme souvent chez lui, s’articule autour d’une série de moments, qui abondent en images rapides, saisissantes de justesse : une soirée mondaine tournoyante dans un grand salon parisien ; la peinture de la misère effrayante des pêcheurs d’esturgeons dans des paysages déprimants de désolation ; et surtout la traversée aérienne de l’Europe, où l’écriture de Morand communique admirablement à son lecteur la sensation physique du voyage dans une carlingue assourdissante et secouée par les trous d’air. Morand est toujours à son affaire dans ces épisodes-là (cf. Lewis et Irène). La vitesse était décidément son cher sujet.
Selon les déductions de l’annotateur de la Pléiade Michel Collomb, Morand n’avait pas encore effectué le vol Paris-Bucarest lorsqu’il écrivit Flèche d’Orient. C’est quelques semaines après la première parution du texte dans la Revue de Paris qu’il embarqua dans un appareil de la CIDNA (Compagnie internationale de navigation aérienne). Nouvelle preuve de ce que la réalité imite l’imagination.
Chambres

Paris, hôtel Ibis Styles République
 Mariant l’histoire sociale, l’histoire des mentalités et le récit d’épisodes vécus, Andrea Camilleri examine dans ce court essai l’hypothèse selon laquelle la culture sicilienne de l’accommodement, des petits arrangements entre amis, de la compromission, sur quoi ont prospéré le brigandage et la mafia, aurait pour origine le système des indulgences de l’Église catholique. On laissera aux historiens le soin de trancher. La démonstration est d’autant plus plaisante que Camilleri essayiste ne cesse pas d’être le conteur savoureux que nous ont révélé ses romans, et que sa manière d’avancer par méandres et digressions est bien séduisante.
Mariant l’histoire sociale, l’histoire des mentalités et le récit d’épisodes vécus, Andrea Camilleri examine dans ce court essai l’hypothèse selon laquelle la culture sicilienne de l’accommodement, des petits arrangements entre amis, de la compromission, sur quoi ont prospéré le brigandage et la mafia, aurait pour origine le système des indulgences de l’Église catholique. On laissera aux historiens le soin de trancher. La démonstration est d’autant plus plaisante que Camilleri essayiste ne cesse pas d’être le conteur savoureux que nous ont révélé ses romans, et que sa manière d’avancer par méandres et digressions est bien séduisante.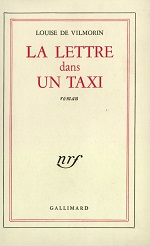 Comment l’oubli d’une lettre dans un taxi – lettre non réellement compromettante mais susceptible d’être mal interprétée – déclenche une tempête dans le cœur de l’héroïne, et comment ses efforts pour la récupérer, en l’obligeant à multiplier les demi-mensonges, l’enferrent dans une situation inextricable. Par touches rapides et légères, Louise de Vilmorin construit un suspense émotionnel où l’on pèse des œufs de mouche dans des toiles d’araignée, propre à séduire les amateurs du cinéma d’Éric Rohmer.
Comment l’oubli d’une lettre dans un taxi – lettre non réellement compromettante mais susceptible d’être mal interprétée – déclenche une tempête dans le cœur de l’héroïne, et comment ses efforts pour la récupérer, en l’obligeant à multiplier les demi-mensonges, l’enferrent dans une situation inextricable. Par touches rapides et légères, Louise de Vilmorin construit un suspense émotionnel où l’on pèse des œufs de mouche dans des toiles d’araignée, propre à séduire les amateurs du cinéma d’Éric Rohmer.
























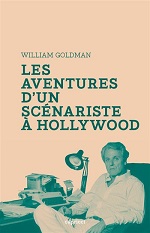 Il s’agit d’un choix d’une vingtaine de chapitres, effectué par le traducteur Jean Rousselot dans deux volumes de mémoires parus en 1983 et 2000. Romancier « entré dans l’univers du cinéma sur un malentendu total », William Goldman compte à son palmarès les scénarios de Harper, Butch Cassidy et le Kid, la Kermesse des aigles, Marathon Man, les Hommes du président (d’où il fut débarqué ; Pakula était apparemment coutumier du fait), l’Étoffe des héros (qu’il quitta de lui-même à la suite d’un différend de fond avec Kaufman), Princess Bride, Misery, Absolute Power et bien d’autres plus oubliables. Le cinéphile aussi bien que l’apprenti scénariste tireront autant de profit que d’agrément de la lecture de ses mémoires. Sur un ton familier et chaleureux multipliant les adresses au lecteur, Goldman raconte avec entrain, humour et franchise ses débuts dans la profession, ses réussites et ses échecs, également riches en enseignements. Outre les aperçus concrets sur la scénarisation – l’importance du point de vue, le moment clé de l’exposition, la construction d’un film, d’une scène, etc. –, son témoignage est instructif sur l’étape de la mise en chantier d’un projet et l’espèce de folie permanente qui règne dans le monde du cinéma : le producteur qu’il faut intéresser (et qui demande des réécritures), lequel se met en quête de vedettes et d’un metteur en scène (qui demandent à leur tour des réécritures), les querelles d’égos et d’argent de tout ce petit monde… C’est un tel parcours du combattant qu’on se demande, à le lire, par quel miracle un film parvient à voir le jour.
Il s’agit d’un choix d’une vingtaine de chapitres, effectué par le traducteur Jean Rousselot dans deux volumes de mémoires parus en 1983 et 2000. Romancier « entré dans l’univers du cinéma sur un malentendu total », William Goldman compte à son palmarès les scénarios de Harper, Butch Cassidy et le Kid, la Kermesse des aigles, Marathon Man, les Hommes du président (d’où il fut débarqué ; Pakula était apparemment coutumier du fait), l’Étoffe des héros (qu’il quitta de lui-même à la suite d’un différend de fond avec Kaufman), Princess Bride, Misery, Absolute Power et bien d’autres plus oubliables. Le cinéphile aussi bien que l’apprenti scénariste tireront autant de profit que d’agrément de la lecture de ses mémoires. Sur un ton familier et chaleureux multipliant les adresses au lecteur, Goldman raconte avec entrain, humour et franchise ses débuts dans la profession, ses réussites et ses échecs, également riches en enseignements. Outre les aperçus concrets sur la scénarisation – l’importance du point de vue, le moment clé de l’exposition, la construction d’un film, d’une scène, etc. –, son témoignage est instructif sur l’étape de la mise en chantier d’un projet et l’espèce de folie permanente qui règne dans le monde du cinéma : le producteur qu’il faut intéresser (et qui demande des réécritures), lequel se met en quête de vedettes et d’un metteur en scène (qui demandent à leur tour des réécritures), les querelles d’égos et d’argent de tout ce petit monde… C’est un tel parcours du combattant qu’on se demande, à le lire, par quel miracle un film parvient à voir le jour.
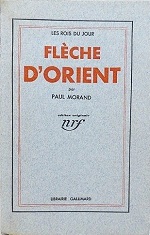 Paul Morand est un mélange désarmant d’intelligence et de sottise. Il sait admirablement voir les choses et les donner à voir. On aimerait qu’il s’en tienne là et nous épargne des considérations débiles sur l’âme des peuples et le destin des civilisations. Les cent soixante-dix pages de Flèche d’Orient s’avalent d’un trait. On peut en résumer l’argument comme suit. À la suite d’un pari mondain idiot, un Russe blanc exilé en France effectue un voyage éclair en Roumanie pour y faire l’emplette de caviar, ceci afin de prouver l’incomparable rapidité de la ligne aérienne Paris-Bucarest nouvellement ouverte. Sur place, rien ne passe comme prévu. Notre homme s’engourdit inexplicablement. Diverses rencontres l’entraînent à l’est, toujours plus à l’est, jusqu’à la frontière de son ancienne patrie où il sent retentir en lui l’appel éternel de l’âme slave. Dimitri ne rentrera pas en France.
Paul Morand est un mélange désarmant d’intelligence et de sottise. Il sait admirablement voir les choses et les donner à voir. On aimerait qu’il s’en tienne là et nous épargne des considérations débiles sur l’âme des peuples et le destin des civilisations. Les cent soixante-dix pages de Flèche d’Orient s’avalent d’un trait. On peut en résumer l’argument comme suit. À la suite d’un pari mondain idiot, un Russe blanc exilé en France effectue un voyage éclair en Roumanie pour y faire l’emplette de caviar, ceci afin de prouver l’incomparable rapidité de la ligne aérienne Paris-Bucarest nouvellement ouverte. Sur place, rien ne passe comme prévu. Notre homme s’engourdit inexplicablement. Diverses rencontres l’entraînent à l’est, toujours plus à l’est, jusqu’à la frontière de son ancienne patrie où il sent retentir en lui l’appel éternel de l’âme slave. Dimitri ne rentrera pas en France.