Déstockage


Les livres débordent de partout. Les piles croissent et se multiplient. On ne sait plus où les entasser, on met parfois deux jours à retrouver celui dont on a besoin — ça n’arrivait jamais avant —, signe que le seuil critique a depuis longtemps été dépassé. Au bout d’un an de tergiversations, on se résout à faire le tri. Le plus facile à liquider : les livres auxquels plus rien ne nous attache, pas même une valeur sentimentale qui nous les ferait conserver comme des fétiches en sachant pourtant qu’on ne les rouvrira plus ; les livres jamais lus dont la valeur résidait dans la seule nouveauté, ceux-là qui furent achetés avec un enthousiasme aussitôt retombé, avant d’être impitoyablement chassés de la table de chevet par de plus frais arrivages ; les pas vraiment désirés (services de presse non sollicités, cadeaux mal choisis, X a oublié qu’il m’avait offert ça, il y a prescription) ; des tombereaux de polars. Plus difficile : des paquets de Losfeld et de Pauvert, passionnément traqués des années durant, à l’époque où l’on ambitionnait de réunir la totalité de leur production ; ça nous a passé, malgré notre attachement intact pour ces deux éditeurs ; notre fièvre accumulatrice s’est orientée depuis vers de nouveaux secteurs, il y a des lustres qu’on n’a plus mis le nez là-dedans, ça prend vraiment trop de place, d’ailleurs on conservera la crème de leur catalogue ; mais tout de même, ça pince le cœur, c’est une part de soi qui s’en va, adieu mon cher passé, tout ça. Bref. On entasse le tout dans des cartons. Le pire, c’est que ça ne libère pas tant d’espace que ça. Les trous dans les rayonnages sont vite comblés, il traîne encore des satanés bouquins dans tous les coins puisque, n’est-ce pas, on ne cesse pas pour autant de faire des acquisitions. Rebref.
Un an plus tard encore, on se décide à faire venir un ami bouquiniste. Et voilà où je veux en venir. C’est une chose de voir partir ses chers trésors dans la voiture du libraire ; on s’était fait à l’idée, c’est presque une libération. C’en est une autre de les retrouver, quinze jours plus tard, disposés avec soin dans la vitrine dudit libraire, à nouveau désirables. Choc : « Eh, mais ce sont mes livres ! Exposés à la vue de tous ! Et d’autres vont mettre leurs sales pattes dessus ! » J’ai failli tout racheter.


Plaisirs pervers du roman-photo


Découverte tardive de Colloque de chiens (1977). Il s’agit, comme la Jetée, d’un ciné-roman-photo narré en voix off, mais d’un esprit évidemment très différent du film de Marker. Non seulement ce court métrage est formidablement drôle et jubilatoire, mais il apparaît a posteriori comme le condensé programmatique de toute la période française de Raoul Ruiz.




Établi depuis trois ans à Paris, Ruiz met simultanément en place une stratégie de production (mener plusieurs films de front et toujours avoir un projet de secours en réserve : Colloque de chiens fut réalisé à la sauvette pendant l’interruption du tournage de la Vocation suspendue) et une stratégie narrative. Plaisir de jouer avec les poncifs des « mauvais genres » — entre le mélo à la Nous deux et le fait divers sordide façon Détective — pour mieux en dévoiler le contenu latent, fait de crime, de sexe et de sang : couples impossibles, fausses identités, enfants adoptés, déchéance et prostitution, viols et meurtres, changement de sexe, cadavre découpé en morceaux qu’on disperse aux quatre coins de la ville. Plaisir, surtout, des récits en boucle pervers, à la façon d’un ruban de Moebius, fondés sur la reprise et la permutation de quelques motifs narratifs — comme un jeu dont on redistribuerait les cartes dans un ordre toujours différent qui leur confèrerait à chaque retour une signification nouvelle. Entre la première et la dernière réplique du film (« Celle que tu appelles maman n’est pas ta vraie maman » / « Celle que tu appelles ma mère n’est pas ma vraie mère »), le récit paraît revenir à son point de départ mais la situation s’est à la fois inversée et déplacée. On songe à ces textes de jeunesse de Raymond Roussel qui s’ouvrent et se ferment par une phrase presque identique dont le sens est pourtant totalement différent.
Et puis, aux trois quarts de la projection, voici que surgit une série d’images incongrue, aberrante, comme si aux plans du film s’étaient mêlés par erreur ceux d’un autre film.



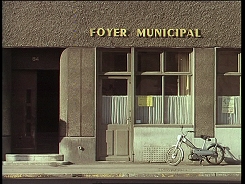






Cet intermède documentaire sur la signalétique urbaine (dont l’irruption m’a d’autant plus étonné qu’il rejoint mes propres manies), on peut bien sûr le rapporter aux errances des personnages dans la ville, y voir un écho au piège topographique qui perdra l’un des héros du film (« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui »). De même qu’il est possible de faire une lecture «symbolique» des plans de chiens qui ponctuent le film à intervalles irréguliers (en y voyant par exemple un commentaire ironique à la fiction, un rappel de la part animale de l’espèce humaine, dont la prétention au langage articulé serait aussi risible qu’un concert d’aboiements). Mais ces explications raisonnables, et donc rassurantes, n’ont pas grand intérêt. Elles ne peuvent être que réductrices. Car ce qui séduit dans ces plans, c’est bien plutôt leur caractère arbitraire, erratique, délié de toute nécessité dramatique, la manière dont ils viennent perturber la bonne marche du récit — en rappelant au passage qu’un film est beaucoup plus que la mise en images de son scénario, et que le cinéma nous est précieux par tout ce qu’il saisit au vol de fugitif et d’informulé, dans ses à-côtés et ses arrière-plans.


« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui. »
Figures du mixte
Architectes, décorateurs, peintres, écrivains, amateurs. Dans le disparate essentiel de leur réunion, ces personnages auront eu en commun d’avoir eux-mêmes été, singulièrement, activement, disparates : mercuriels et versatiles, instables et touche-à-tout ; inaptes à se ranger sous une catégorie ou un genre consacré, peintres et littérateurs, décorateurs et architectes, mondains et excentriques ; figures du mixte ou du composite.
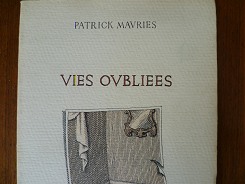 Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
À l’époque de ma première lecture, je ne connaissais que Filippo de Pisis (via Mandiargues), Mario Praz et Christian Bérard. Point d’internet alors. Aussi notait-on, en vue d’une recherche future, les autres noms sur un pense-bête, qu’on oubliait d’emporter à la bibliothèque et qu’on finissait par égarer. Aujourd’hui, un simple clic permet de découvrir les polaroids érotiques de Carlo Mollino ou encore la réalisation qu’on dit la plus célèbre de Gio Ponti, l’étonnante tour Pirelli à Milan (1956) — laquelle semble de face une HLM massive et sans grâce mais de profil prend soudain l’allure d’un monolithe kubrickien, moderne cousin des immeubles plats du XVe qu’affectionnait Roger Caillois et que son imagination se plaisait à peupler de fantômes.

 Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Une secte impossible

Peut-être d’ailleurs Fornasetti a-t-il d’abord été positivement, substantiellement, un collectionneur. Sa maison milanaise — constellée de séries d’assiettes anglaises — proclamait avec force cette passion : le mur de façade en avait été percé pour installer une collection de verres en cristal taillé et coloré. L’espace des pièces était dévoré par le témoignage d’une autre obsession : celle de l’imprimé, sous toutes ses formes, du livre à la revue et à l’image, aberration ravageuse — et assez répandue — dont Fornasetti ne manquait jamais de se moquer ironiquement. Héros de cette secte impossible des dévorateurs de papier qui, de loin en loin sur la planète, absorbent quotidiennement catalogues et magazines, livres de mode et ouvrages d’architecture, histoire du design et chroniques de tous ordres ; secte dont les membres se ressembleraient tous, se jetant sur les mêmes livres, adulant les mêmes auteurs, tout en s’ignorant les uns les autres, prêts à se jalouser, courant à l’unique ou à l’inédit, aspirés vers l’absolu de leur obsession ; monomanes ballottés de catalogue en catalogue, de notice en bulletin, n’ayant de cesse d’avoir, tel De Quincey, rendu impraticables chambres et couloirs, oxygénés qu’ils sont chaque jour par le renouvellement salvateur des publications, poussés à franchir le barrage des langues et des cultures, ne pouvant rapidement se contenter d’une langue propre, tel, donc, Fornasetti qui avouait ne plus avoir accès à sa propre archive.
Patrick Mauriès, Fornasetti, designer de la fantaisie,
Thames & Hudson, 2006.
Fin de phrase contredite dix pages plus loin, tant le démon de l’accumulation n’exclut pas l’obsession d’un ordre impossible :
Jusqu’à la fin de sa vie, il pouvait ainsi désigner sans erreur la place du moindre de ses treize mille projets, dûment étiquetés et catalogués.
Fornasetti est-il ce F. dont parle Mauriès dans les Lieux parallèles (Plon, 1989), et dont l’image m’a longtemps hanté ? (On suppose que oui, l’initiale B. correspondant au prénom de son fils, Barnaba.)
F. mort, sa femme avoue qu’elle n’a qu’une hâte: fare ordine, débarrasser tables, sols et divans des magazines, quotidiens, livres et tracts en toutes langues amoncelés par son mari soixante ans durant, et dont il interdisait farouchement qu’on déplaçât le moindre atome. Elle peut enfin, après cette longue attente, s’approprier un espace : en le vidant. Son fils, quant à lui, se décide à franchir le tabou : il me conduit dans les pièces que F. condamnait jalousement, de peur de se livrer d’une manière ou d’une autre ; et le petit pavillon urbain se révèle alors donner, fantastiquement, sur un dédale d’ateliers et de couloirs aux murs implacablement saturés d’objets et de collections de tous ordres (dont des maquettes sous verre exécutées en filaments de fromage ; certaines, me dit B., grouillant de vers…), quand il ne s’agit pas d’imprimés de tous formats, âges ou couleurs.
Collectionneur exemplaire, c’est-à-dire effrayant, F. était aussi méthodique : pas une collection de Vogue ou de Maison et Jardin qui ne soit étiquetée, répertoriée, analysée — tout en étant impraticable, étouffée sous la poussière d’un demi-siècle. Spectacle toujours poignant — mais prévisible, naturel pour qui connaissait F. — que cette moisissure gagnant jusqu’au moindre centimètre possible. Et son fils — qui avait eu des velléités d’évasion, était parti plusieurs années avant de revenir — me montre fièrement sa chambre tout là-haut, qui aurait pu être un jardin suspendu, et où seul un mauvais sommier et un réchaud se détachent sur un fond noirci d’Illustrazione italiana et de vieux livres, dont certains rarissimes. Il n’en a assurément pas ouvert un seul, se contente de savoir qu’ils peuvent avoir de la valeur, se satisfait maintenant de vivre dans le voisinage enveloppant de ce gigantesque cadavre.
André Schiffrin à Liège

Communiqué : « Fils du créateur de la Bibliothèque de la Pléiade Jacques Schiffrin, André Schiffrin s’est d’abord illustré à la direction, pendant trente ans, des éditions Pantheon à New York. Suite à un renouvellement de l’actionnariat, il s’est retiré de cette maison pour fonder The New Press en 1991 et instaurer un nouveau mode d’édition sans but lucratif et porteur de hautes exigences intellectuelles.
De l’Édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999) à l’Argent et les Mots (2010) en passant par le Contrôle de la parole (2005), sans compter de nombreuses publications dans diverses revues de sciences littéraires et sociales, André Schiffrin s’est signalé aussi comme un des meilleurs spécialistes des rouages de l’édition contemporaine et des contraintes diverses qui, émanant de l’État ou du marché, sont susceptibles de s’exercer sur les industries culturelles et la production du savoir. »







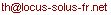













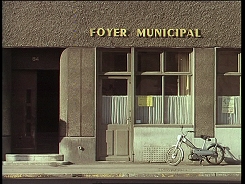








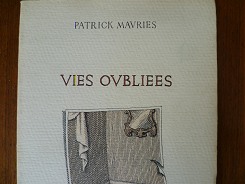 Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène :
Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : 
 Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.










