Lectures expresses
Arnold Bennett, le Grand Hôtel Babylon (The Grand Babylon Hotel, 1902). Traduit de l’anglais par Lise Capitan. Les Moutons électriques, 2014. Rééd. 10/18, 2020.
 Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.
Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.
Le roman d’Arnold Bennett prend place dans un vaste hôtel de luxe londonien (inspiré du Savoy), fréquenté par une clientèle select et fortunée, qui y trouve confort capitonné, service stylé et discrétion. Bien entendu, son dédale infini de corridors (incluant un passage secret) abrite un nœud d’intrigues internationales, comme ne va pas tarder à le découvrir son nouveau propriétaire, millionnaire américain ayant acquis le palace sur un coup de tête pour satisfaire un caprice de sa fille (c’est la grande scène d’ouverture du livre et elle est délectable).
Mêlant mystère, satire sociale, romance et comédie loufoque, Bennett use de l’hôtel à la fois comme d’un décor, dont il exploite fort bien les ressources, et d’un théâtre, propice à l’observation de sa population mélangée : clientèle et personnel, contraste entre les mœurs anglaises et américaines. Sa verve narrative imprime un allant et un humour joyeux à une intrigue fertile en rebondissements : kidnapping et séquestration, assassinat, tentative d’empoisonnement, identités d’emprunt, poursuite sur les eaux de la Tamise. Le roman nous rend enfin témoins d’un changement d’ère au tournant du XXe siècle. Les vieilles fortunes aristocratiques européennes cèdent le pas aux millionnaires du nouveau monde, ayant édifié leur richesse à coups de chemins de fer et de boursicotage. Les courses-poursuites se font encore en voitures à chevaux (« Cocher, suivez cette calèche ! ») mais la vitesse nouvelle des moyens de transport permet d’embarquer au débotté dans un paquebot pour rejoindre d’un bond Ostende.
Entrées et sortie
Richard Monckton Milnes – lord Houghton – vécut de ses rentes, siégea comme parlementaire – en s’intéressant en particulier aux questions de copyright et à la situation des maisons de correction pour mineurs –, présida la Royal Statistical Society. Il publia des vers semble-t-il oubliables mais prisés de son vivant, s’adonna au mécénat littéraire, soutint la cause des femmes, courtisa en vain Florence Nightingale, fréquenta assidument les lieux en vue de la bonne société victorienne entre l’Angleterre, l’Italie et la France, collectionna les livres licencieux et éleva le commérage au rang des beaux-arts.
L’occupation principale de sa vie fut d’observer les autres et de faire des commentaires sur eux sans aucun égard ; il voyait l’histoire sous un angle personnel et anecdotique, comme un sommaire de biographies individuelles, il avait un bon mot pour chacun, goût et curiosité pour tout. D’ailleurs, comme tous ceux qui ont beaucoup de rapports avec les hommes, il se faisait bien peu d’illusions sur eux, et sous le masque du dilettante, il cachait un certain sens de la vanité de toute chose et une bonne dose de pessimisme, sans pourtant exagérer même en cela […]
Il fit de son mieux pour jouir de la vie et pour en faire jouir les autres ; il fut un gourmet héroïque qui, prévenu par sa goutte, pronostiqua par un jeu de mots : « My exit will be the result of too many entrées. »
Mario Praz, « Sauvetage d’un dilettante »,
dans le Pacte avec le serpent, vol. 2
(Il Patto col serpente, 1972).
Traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali.
Christian Bourgois, 1990.

À la brocante

À la brocante, inquiétante étrangeté des portraits de famille d’antan. Ces jumelles quelque peu flippantes nous évoquent les enfants démoniaques de certains romans et films fantastiques. Elles auraient pu décrocher un rôle dans le Village des damnés.
L’art de la chute (2)
Comme peintre, [Dante Gabriel Rossetti] ne fut certes pas un innovateur […]. Ses premières idoles avaient été Van Eyck et Memling, mais ce précieux réalisme était insurmontable et certains efforts des Préraphaélites pour reproduire le vrai à la perfection produisaient parfois des effets tragi-comiques : tel Millais qui, pour représenter Ophélie noyée, plaça son modèle, miss Sidal, dans la baignoire, pour rendre plus naturel l’effet des vêtements dans l’eau. L’eau était maintenue à la même température par des lampes sous la baignoire, mais une fois, alors que le tableau était presque terminé, les lampes s’éteignirent à l’insu de l’artiste absorbé dans son travail ; la pauvre miss Sidal resta dans l’eau jusqu’à l’engourdissement, mais ne se plaignit pas, elle contracta seulement un rhume terrible qui probablement lui fut fatal. Aujourd’hui, l’art ne requiert d’autres victimes que le public.
Mario Praz, le Pacte avec le serpent, vol. 1
(Il Patto col serpente, 1972).
Traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali.
Christian Bourgois, 1989.
L’art de la chute (1)
Quoique s’en défendant, Georges Pompidou était assez bluffé par les numéros de virtuosité du ministre lors des débats budgétaires. Giscard récitait de mémoire plus de trois cents chiffres comme on déclame des vers. Évidemment, ses admirables démonstrations n’étaient pas destinées à l’usage exclusif des 487 députés, mais au pays tout entier, qu’en toute modestie il voulait convaincre de son mérite exceptionnel. En Conseil des ministres, tous ses exposés en trois points et quatre propositions étaient toujours incroyablement précis : l’inflation sera de 5,384 % et la croissance de 4,328 %. Ses collègues, comme hypnotisés, demeuraient bouche bée. Parfois l’un d’eux – Joseph Fontanet, en particulier – osait lever la main pour souligner que les faits s’étaient permis de donner tort à ses belles prédictions. Aussitôt interpellé, le ministre en question se cabrait et, le regard noir, submergeait le fâcheux de calculs et de taux qui le laissaient coi jusqu’à la sortie du Conseil où il maugréait devant quelques journalistes : « Giscard est infaillible dans l’erreur. »
Catherine Nay, Souvenirs souvenirs… Robert Laffont, 2019.
Les années Reprise

Les albums de Duke Ellington enregistrés au début des années 1960 pour Reprise – le label de Frank Sinatra – forment un curieux mélange, reflet d’une époque de transition où Ellington cherchait à se relancer après la fin de son contrat chez Columbia. Les temps devenaient durs pour les derniers big bands survivants de l’ère du swing (Count Basie, Woody Herman…). Entretenir un grand orchestre coûtait cher, il fallait enchaîner les tournées épuisantes. Or le jeune public dansant se détournait des rythmes du jazz pour leur préférer ceux du rock and roll.
Le programme des albums reflète cela, qui alterne projets ambitieux et tentatives de décrocher un hit dans les juke-boxes en enregistrant des succès pop du moment, et même les chansons du film Mary Poppins !
Ces albums peuvent se classer en trois catégories :
1. L’ambition. Dans le sillage de projets antérieurs pour Columbia, Ellington et son alter ego compositeur et orchestrateur Billy Strayhorn (qu’il faut considérer comme le co-auteur de tous les albums de la période) poursuivent leur ambition d’élargir le langage du jazz en œuvrant dans le format de la suite étendue aux dimensions d’un 33 tours entier. Afro-Bossa, très belle séquence de douze miniatures orfévrées avec invention, se hausse au niveau des meilleures réussites du tandem dans le genre. Ce disque négligé mériterait d’avoir une réputation égale à celle de Far East Suite, New Orleans Suite ou The Afro-Eurasian Eclipse. Quant à The Symphonic Ellington, c’est un rare exemple convaincant de mariage entre un orchestre de jazz et un orchestre symphonique. Ces deux albums sont les plus accomplis de la période. À côté de quoi, les Jazz Violin Sessions, avec pour solistes Svend Asmuden, Stéphane Grappelli et Ray Nance, se révèlent quelque peu soporifiques.

2. La rétrospection. Simultanément, Ellington et Strayhorn jettent un regard rétrospectif en enregistrant avec de nouveaux arrangements les grands classiques de l’ère du swing. L’idée même d’une telle entreprise et le titre des albums sont significatifs d’un basculement d’époque : Will Big Bands Ever Come Back? et Recollections of the Big Band Era. Une page de l’histoire du jazz est en train de se tourner *. L’ère des big bands lance ses derniers feux, ses artisans n’en ont que trop conscience et revisitent une dernière fois un passé glorieux.

3. La prospection d’un nouveau public plus jeune et/ou plus populaire, dont témoignent en premier lieu deux albums « commerciaux » de pop covers, Ellington ’65 et Ellington ’66, d’intérêt fort inégal. Si elles s’écoutent sans déplaisir, ces séances confirment qu’en règle générale, une chanson pop ou de variété offre des possibilités harmoniques limitées de développement d’une improvisation de jazz, au-delà de la simple paraphrase. Curieusement, c’est l’improbable Duke Ellington Plays with the Original Score from Walt Disney’s Mary Poppins qui se révèle le plus intrigant et le plus réussi du lot grâce à la science d’arrangeur de Strayhorn, illustrant sa conviction intime que tout matériau musical, fût-il le plus quelconque, est susceptible d’être transcendé **.
Il est difficile de décider avec certitude à qui revient l’initiative de telles séances, si elle émanait d’Ellington lui-même (toujours soucieux, tout en menant ses projets personnels, de décrocher des succès de vente pour assurer la matérielle) ou des producteurs de Reprise. Dans le cas de Mary Poppins, on sait que c’est Walt Disney en personne qui commandita les séances d’enregistrement comme on s’offre un cadeau royal, en déclarant : « Je me fiche de savoir si nous allons vendre un seul disque, je veux juste entendre ce que vous allez faire de cette musique. »


La signature d’un contrat avec Reprise avait été annoncée en grande pompe. Ellington aurait carte blanche, à la fois pour enregistrer ses propres disques et pour jouer un rôle de talent scout. À considérer le calendrier des enregistrements, il est évident qu’il prit ce double rôle à cœur, déployant une activité intense en studio tout en produisant quelques albums d’autres musiciens (dont un Bud Powell enregistré à Paris). Mais il paraît non moins évident que cette initiative s’essouffla rapidement, si bien que cette rencontre entre un tout grand musicien et un excellent label indépendant (mais dont les cadres, à l’évidence, doués pour produire et mettre en marché de bons albums de variétés, avaient peu d’affinités avec le jazz) fait l’effet d’une occasion manquée.
Le corpus Reprise en son entier, dans ses inégalités mêmes, intéresse néanmoins parce qu’il témoigne d’un moment particulier à la fois dans la carrière d’Ellington et dans l’histoire du jazz. Et, ce n’est pas négligeable, il dispense de bout en bout un pur plaisir d’écoute grâce au talent des techniciens de chez Reprise. Rarement le son incomparable de l’orchestre d’Ellington, la richesse de sa texture auront été aussi bien captés par des microphones. C’est en soi une source de volupté, même lorsque l’orchestre exerce son talent sur un matériau indifférent.
* Une page de l’histoire de la culture populaire américaine, pourrait-on ajouter. C’est grosso modo à la même époque que le système des studios hollywoodiens se disloque, et qu’on peut dater la fin du grand cinéma américain classique.
** Strayhorn : « If I’m working on a tune, I don’t want to think it’s bad. It’s just the tune, and I have to work with it. It’s not a matter of wether it’s good or bad… You still have to say something wether you’re doing pop tunes, Mary Poppins, or anything else. You have to say what you feel about this tune to the people, so that when they hear it they say, “I know that’s Duke Ellington. I know that sound – it’s distinct and different from anybody else’s.” » (Entretien avec Stanley Dance, 1966.)
 Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.
Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.
Non repris dans le coffret : 1. Un album oubliable avec la chanteuse suédoise Alice Babs, Serenade to Sweden. 2. L’agréable Francis A. & Edward K., qui est avant tout un album de Frank Sinatra accompagné par l’orchestre d’Ellington.

 Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.
Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

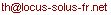











 Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.
Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.