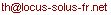« Du goût fâcheux de trop embrasser »
Marcel Ray à Valery Larbaud, le le 5 avril 1935.
Je n’admets pas qu’on classe les écrivains d’une époque suivant la place qu’ils auront faite, dans leurs ouvrages, aux « grands problèmes » de cette époque ; je comprends même que certains d’entre eux, parmi les meilleurs, se détournent volontairement de ces problèmes, soit qu’ils les aient déjà résolus pour leur usage, soit qu’ils les subordonnent, même pour leurs méditations privées, à d’autres qui les touchent davantage, soit enfin qu’ils en laissent l’examen à des philosophes, à des moralistes ou à des historiens plus qualifiés. C’est même, à mon jugement, un des signes d’une médiocre ou d’une basse époque que de vouloir que tous s’occupent de tout et d’exiger d’un peintre ou d’un musicien ou d’un cordonnier autre chose que de la peinture, de la musique ou de belles crépides. […]
Du goût fâcheux de trop embrasser nous vient, entre autres calamités, le déluge de romans-fleuves à la manière de Jules Romains succédant à Zola et Romain Rolland, de Lacretelle, Chardonne et autres émules de Jules Romains, enfin des candidats aux prix littéraires ou lauréats de ces prix, dont les noms et les œuvres sont déjà en poussière. […] Le cas de Romains est spécialement embarrassant et douloureux ; j’ai lu quatre volumes de ses Hommes de bonne volonté (sur huit) et j’y trouve des pages, voire des chapitres splendides dans un fatras inimaginable. Je crois que c’est la gloire de Proust, plus que le souvenir de Zola et de Romain Rolland, qui les empêche de dormir. Mais Proust restait dans son domaine et ne tranchait pas de toutes choses. Il y a eu aussi la réussite de Galsworthy et l’échec de Martin du Gard, essoufflé au sixième tome. Que je vous admire de ne point promener Barnabooth dans l’esthétique, la politique étrangère, la pathologie, la finance et le calcul différentiel !
Valery Larbaud, Marcel Ray, Correspondance, vol. III : 1921-1937. Gallimard, 1980.
Qu’est-ce qu’une œuvre vivante ?
Valery Larbaud à Marcel Ray, le 16 octobre 1911.
Ce que vous dites du livre de Jules Romains ne vaut pas ce que vous dites à propos de lui. Vous en faites un éloge immérité, à mon avis. Je l’ai parcouru (dans l’exemplaire que vous avez laissé chez moi). C’est une chose préméditée, c’est-à-dire développée, avec un plan, et l’amplification, chaque case remplie et chaque fil dévidé jusqu’au bout, comme nos fameux devoirs de français des classes. On sent que l’auteur s’est dit : « Je vais faire un roman unanimiste (!) et allons-y ! » Le résultat m’a ennuyé et repoussé. Votre critique de Mort de quelqu’un est bien plus intéressante que Mort de quelqu’un. C’est une œuvre empaillée, et non pas vivante. Une œuvre vivante est une création dont l’auteur est dieu : il la crée tout entière d’un seul coup, mais il lui laisse son libre arbitre. Grossièrement : il sait tout ce que son œuvre sera, mais il ne la découvre en détail qu’à mesure qu’il l’écrit. Pour ma part, je n’ai jamais jugé dignes d’être publiées les choses que j’avais bâties sur un plan tracé d’avance. Ce sont celles que j’ai découvertes à mesure que je les écrivais que je crois dignes d’être lues par d’autres que moi. C’est une exploration et non un développement. Le développement est en réalité le contraire de notre art, qui consiste à ramener et à séparer, et à rejeter beaucoup de choses.
Valery Larbaud, Marcel Ray, Correspondance, vol. II : 1910-1920. Gallimard, 1980.
Larbaud invente le GPS
— On t’a livré une nouvelle voiture ?
— Une machine ! longue, fine, tranquillement puissante. […] tous les cadrans s’éclairent et les petites lampes ont chacune son écran, et il y a un système que j’ai imaginé, qui permet de dérouler la carte routière, qu’on a ainsi constamment sous les yeux ; […] je voudrais rendre ce système automatique. Un mouvement d’horlogerie. Mais réglable à volonté. La carte se déroulerait sous les yeux du chauffeur en même temps que la route sous les roues de la voiture.
Valery Larbaud, Allen, 1927.
Impasses
Il nous faut dire un mot à propos des impasses. On peut vivre dans le quartier et en ignorer l’existence. Parfois, les maisons s’écartent en certains endroits, de quelques dizaines de centimètres, pour laisser passer une femme de peine, un valet de pied. Si les façades de la rue sont disposées d’une habile façon, les entrées des ruelles peuvent n’être visibles que sous un angle précis, en un lieu de la rue. Si l’impasse est surmontée d’une voûte plus ou moins ouvragée et d’un pan de mur, comment la distinguer d’une porte de maison ? Si la ruelle braque au bout de deux mètres à angle droit, comment la différencier d’une impasse ? Certaines impasses finissent sur une porte, cette porte s’ouvre sur un long couloir qui traverse une maison, puis une cour d’immeuble, puis un long couloir, qui traverse une autre maison, puis une porte et l’extrémité d’une autre impasse, à l’autre bout du quartier. Des hommes ont bâti autour, à droite, à gauche et par-dessus certaines ruelles, ainsi qu’on fabrique les souterrains des citadelles. Des hommes ont creusé des tunnels dans le fond de certaines impasses. Des amants ont acheté deux maisons éloignées et tous les terrains qui les séparaient, ensuite ils ont relié les jardins de ces deux maisons par un long et zigzagant chemin, très étroit, flanqué de deux hauts murs de briques, puis ont fait construire des bâtiments sur les terrains entre les deux maisons, fait aménager des jardins pour chacun de ces bâtiments avec, dans le fond de ces jardins, un mur de briques surmonté de vigne vierge, d’aubépine, de rosiers. En quelques années de patience et d’efforts, ces amants avaient un passage entre leurs deux maisons, qui serpentait invisible à travers tout un quartier. Des maisons ont été agrandies en englobant une ruelle adjacente, qui est devenue un couloir, sauf pour l’homme qui se souvient de la ruelle. Car la ville a sa vie propre et les hommes meurent si vite, les hommes sont les mouches de la ville, trois générations d’hommes ne suffisent pas à intégrer une semaine dans la vie d’une ville, qui pousse en hauteur et en profondeur, s’étend, détruit ou englobe ses âges précédents, cache dans la paroi Ouest d’une cave un fragment de mur d’enceinte, étouffe sous le tarmac les débris d’un quartier tout entier qu’elle a taillé pour tirer une avenue et respirer plus large.
Nicolas Marchal, les Faux Simenon.
Weyrich, 2019.
Rue Manin
Demain, lundi, quand je serai rentré, quand la nuit se sera écoulée dans la demi-chambre qui est la mienne chez mes parents, tout près d’une piscine et du jardin des Buttes-Chaumont […] ; tout près aussi du Chalet Édouard, Noces et Banquets où, chaque fois que je suis passé par là, allant, par la rue Manin, vers l’avenue Secrétan et la station de métro Bolivar, j’ai croisé Fantômas.
Jacques Roubaud, Peut-être ou la Nuit de dimanche.
Seuil, « Librairie du XXIe siècle », 2018.
Regard-caméra

[…] Hitchcock cleverly teases the audience with the first screen appearance of Grace Kelly as Lisa Fremont. When she surprises the slumbering James Stewart (Jeff), the words she whispers are the first shot in direct-address mode in the movie, and this shot breaks the rules in more than one way. Jeff is asleep — unless the shot suggests that he is only faking — but since the whole film elaborates on the metaphorical relationship between character, director, and spectator, as well as on the many uses of the point-of-view shot, we suspect that Kelly is really returning Stewart’s subjective shot and that she is really looking at him, that is, at us spectators and not at the camera, which is supposed to remain invisible. Obviously, the lack of verisimilitude of the filmic montage puts forward the idea that what Grace Kelly is looking at is also the camera and thus the director, and not just Stewart or the spectators in the theater. Kelly’s first direct-address appearance can thus be understood as an ironic, possibly even sadistic hint from the director to the spectator, as if the former was murmuring to the latter: dear spectator, don’t believe that you “are” the Jimmy Stewart character, for he will get the girl and you will get nothing.
Jan Baetens, The Film Photonovel.
University of Texas Press, 2019.
Damnatio memoriae
When the Commons of England sentenced King Charles I to death in 1649, they sat upon his own seat of judgment ; and after they had executed him, they broke the seat and buried it under the floor so that no king could ever sit there again. When, in 1789, the revolutionaries violated the secret boudoir of Marie-Antoinette, they stole the locks and smashed the mirrors in which the queen used to gaze at her reflection. When the Great Exhibition came to an end in 1851, all of its contents, including the Crystal Palace itself, were sold on the very open market the exhibition had been designated to celebrate. Damnatio memoriae, the Romans called it — “the damnation of memory”. They used to bury the houses of men whose memory they wished to condemn, insuring, inadvertently, their preservation for posterity. Even the act of deliberate destruction is a memorial to the thing it is designed to destroy.
Edward Hollis, The Memory Palace. A Book of Lost Interiors.
Portobello Books, 2013.