Verne et Roussel
« On dit que je suis dadaïste ; je ne sais même pas ce que c’est que le dadaïsme », disait en riant Raymond Roussel à Michel Leiris. Et à Lugné-Poé il avoue que les surréalistes, qui lui envoient leurs œuvres, lui paraissent « un peu obscurs 1 ».
Roussel est sans doute flatté de l’intérêt que lui portent de jeunes écrivains d’avant-garde, lui qui n’avait récolté au mieux qu’indifférence, au pire que des sifflets et quolibets scandalisés lorsqu’il avait entrepris de porter à la scène Impressions d’Afrique et Locus Solus (une exception inattendue, tout de même : Robert de Montesquiou, qui lui consacre une étude d’une grande pénétration à sa date). Mais si la plupart de ses contemporains ne voient en lui qu’un millionnaire un peu zinzin écrivant des romans bizarres, lui-même ne s’est probablement jamais perçu comme un excentrique, et en aucun cas il ne se considérait comme un écrivain d’avant-garde.
Roussel est au contraire un homme soucieux de respectabilité littéraire (et de respectabilité tout court). C’est dans le très conservateur Gaulois qu’il publie ses premiers poèmes (les lecteurs ont dû se frotter les yeux). C’est à Lemerre, l’éditeur des Parnassiens, qu’il confie le soin d’éditer (à ses frais) ses livres. Et l’on sait que son goût littéraire le porte vers Hugo, Coppée, Pierre Loti, Edmond Rostand et, par-dessus tout, Jules Verne, auquel il voue un culte idolâtre 2, et dont l’influence sur lui est indéniable.
On trouve en effet maint écho de l’œuvre de Verne dans les romans et les pièces de Roussel, ne fût-ce que leur passion commune pour les cryptogrammes. (Les jeux de langage n’étaient pas non plus inconnus à Verne, qui baptisa l’un de ses héros Hector Servadac — Servadac, palindrome de « cadavres ».) À Verne, il me semble aussi que Roussel a demandé des leçons de style, tant il y a, de l’un à l’autre, une évidente parenté d’écriture. Au fond, je me demande si Roussel n’a pas cru candidement écrire des romans d’aventures à la manière de son maître. La construction bipartite d’Impressions d’Afrique (première partie : l’exposé de mystères qui se succèdent sous nos yeux à la façon des tableaux d’une revue théâtrale ; deuxième partie : leur explication minutieuse) n’est pas sans rappeler celle de certains romans de Verne, le Château des Carpathes par exemple.
Mais surtout, de l’Île mystérieuse à Deux Ans de vacances, des Indes noires à Une ville flottante, en passant par l’Île à hélices et Vingt Mille Lieues sous les mers, il y a, constante chez Verne, une obsession de l’insularité, des cités modèles, des exilés volontaires, des communautés de naufragés vivant coupées du monde, en parfaite autarcie ; et ce trait ne pouvait manquer de toucher profondément Roussel. L’auteur d’Impressions d’Afrique avait conçu sa vie et son œuvre comme un monde autonome, où poursuivre ses rêves enfantins de « gloire » ; réciproquement, beaucoup de romans de Verne pourraient s’intituler Locus Solus.
NOTES
1. François Caradec, Raymond Roussel. Fayard, 1997, p. 219.
2. À son chargé d’affaires Eugène Leiris (le père de Michel), il écrit ceci, en 1921 :
« Demandez-moi ma vie, mais ne me demandez pas de vous prêter un Jules Verne ! J’ai un tel fanatisme pour ses œuvres que j’en suis “jaloux”. Si vous les relisez, je vous supplie de ne jamais m’en parler, de ne jamais, même, prononcer son nom devant moi, car il me semble que c’est un sacrilège de prononcer son nom autrement qu’à genoux. C’est Lui, et de beaucoup, le plus grand génie littéraire de tous les siècles ; il “restera” quand tous les autres auteurs de notre époque seront oubliés depuis longtemps. C’est d’ailleurs aussi monstrueux de le faire lire à des enfants que de leur faire apprendre les Fables de La Fontaine, si profondes que déjà bien peu d’adultes sont aptes à les apprécier. »
Et dans Comment j’ai écrit certains de mes livres :
« Je voudrais aussi, dans ces notes, rendre hommage à l’homme d’incommensurable génie que fut Jules Verne. Mon admiration pour lui est infinie. Dans [certaines de ses pages], il s’est élevé aux plus hautes cimes que puissent atteindre le verbe humain […] »
La Flèche noire
 La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).
La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).
Et cependant, voici un roman d’action qui critique la possibilité de l’action (celle-ci, fût-elle inspirée des meilleures intentions, se payant toujours de conséquences désastreuses pour des innocents) ; un roman d’apprentissage marqué au sceau de la désillusion ; un roman d’amour d’une rare fraîcheur placé pourtant sous le signe d’une troublante confusion des sexes ; un roman d’aventures enfin qui n’en finit pas de miner les lois du genre sur lequel il s’appuie. Maître de l’ambivalence, Stevenson s’emploie à saper tout confort moral en brouillant si bien la ligne de partage entre le bien et le mal, les bons et les méchants, qu’il rend inextricable le conflit de la loyauté et de la trahison. La Flèche noire, ou de l’impossibilité d’opter avec certitude pour le « bon camp ».
Plombier dézingueur
 Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
En témoigne un travail serré sur la langue, faussement orale mais en réalité très écrite : la phrase claque, c’est admirablement scandé. En fait foi aussi la manière dont la narration est soutenue par une abondance de détails techniques sur la pose des conduites sanitaires, la soudure sur cuivre, les raccords trois pièces et les joints de dilatation, que l’habileté d’écriture de l’auteur réussit à rendre passionnants. Cet aspect documentaire n’est pas là pour faire pittoresque. C’est par l’accumulation de détails concrets et de faits saignants (le chantier ubuesque de la BNF) que le livre finit par en dire long sur la réalité quotidienne du capitalisme sauvage – dont les combines du bâtiment ne sont qu’un des nombreux visages -, et plus largement sur la servitude volontaire et la dégradation générale des conditions de l’existence. Vous croyez que Dan (le narrateur) explique les mérites relatifs des perceuses chinoises et des mèches en tungstène allemandes, mais en réalité il décrit l’âge de la falsification dont parlait Paul Lafargue et qui, au-delà du monde de la marchandise, pourrit les relations humaines et atteint jusqu’au coeur même du langage.
C’est en cela que, si l’aspect polar de l’intrigue reste très embryonnaire, Bleu de chauffe se rapproche malgré tout du roman noir. On regrettera d’autant plus la fin décevante, en porte-à-faux, du livre. À ce bémol près, c’est épatant.
Paludes
« On peut dire de Paludes que c’est au roman ce que le Critique de Sheridan est au théâtre, une analyse spirituelle et une dénonciation satirique de toute entreprise littéraire sans dessein, de toute attitude littéraire dérisoire », écrit Larbaud dans Lettres de Paris. On peut même aller plus loin : Paludes sape toute entreprise littéraire, quelle qu’elle soit, y compris bien entendu… Paludes lui-même. En s’y prenant de manière telle qu’on peut lire et relire ce réjouissant petit livre avec le même plaisir et le sentiment qu’au bout du compte, son « sens ultime » nous glisse entre les doigts — soit que son secret toujours se dérobe en paraissant s’offrir, soit que le secret en question, « c’est qu’il n’y en a pas ». Gide nous a à tous les coups.
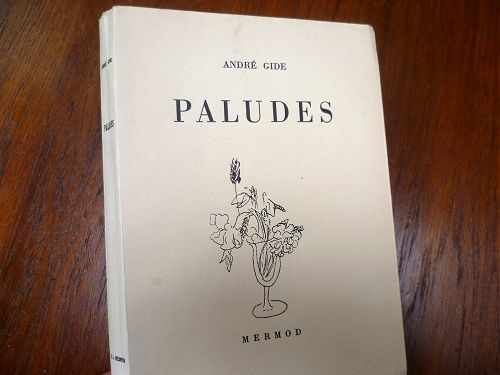
Air de Paris
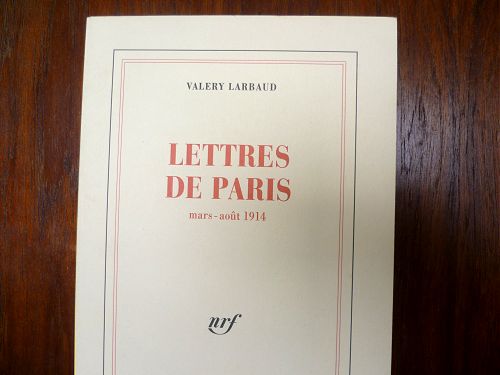
Écrivain et lecteur cosmopolite par excellence, Valery Larbaud a joué un rôle essentiel d’intercesseur dans la vie littéraire de son temps. Grand découvreur et porte-parole des lettres étrangères en France, il a contribué à y faire connaître, par son activisme inlassable, ses essais, ses traductions, ses préfaces, ses conférences ou son rôle officieux de conseiller auprès des éditeurs et des directeurs de revue, Joyce, Borges, Unamuno, Italo Svevo, Eugenio Montale, Samuel Butler, Ramón Gomez de la Serna, Faulkner, Walt Whitman, William Carlos Williams, Logan Pearsall Smith, Alfonso Reyes, Ricardo Guirades et l’on en passe, excusez du peu. En sens inverse, par ses articles écrits directement en anglais pour le New Weekly de Londres ou en espagnol pour la Nación de Buenos Aires, il s’est employé à présenter aux lecteurs étrangers la littérature française classique et contemporaine. Le plurilinguisme de Larbaud et sa connaissance approfondie des autres cultures en faisaient un correspondant idéal, capable d’effectuer, en comparatiste né, des rapprochements avec le propre environnement culturel de son lectorat pour mieux lui faire appréhender une œuvre étrangère. Un « passeur », dirait-on aujourd’hui.
Lettres de Paris réunit ses chroniques parues dans le New Weekly de mars à août 1914. Il y est bien entendu question de littérature (Barrès et Péguy discutés, Anatole France éreinté, Gide loué pour les Caves du Vatican, Fargue, Perse), mais aussi de la vie des revues, de musique (Ravel, les premières auditions du Sacre du printemps de Stravinsky), de théâtre (Copeau, Claudel), de peinture (Monet, Carrière, Valloton et les post-impressionnistes), et encore de mode ou d’une exposition d’insectes et d’oiseaux tropicaux au Jardin d’acclimatation. En somme, c’est toute la vie culturelle de l’immédiat avant-guerre, avec ses querelles et ses débats, qui revit en ces pages dans ses aspects durables ou périssables, rapportée par un témoin de premier plan ; témoin curieux de tout, réceptif et ouvert, mais néanmoins engagé dans la défense éclairée de l’esprit rive gauche, par opposition au vieil esprit rive droite — dichotomie qui vient tout juste d’apparaître dans le débat culturel et que Larbaud s’empresse d’expliquer à ses lecteurs anglais. À lire ces billets, on respire l’air de Paris, millésime 1914.
 Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
Notre agent à la Havane
 Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.
Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.
En 250 pages alertes, Graham Greene imbrique magistralement une parodie irrésistible de récit d’espionnage et des moments de vrai suspense à un questionnement plus large sur le monde et la condition humaine. Le roman baigne dans une irréalité tour à tour euphorisante et inquiétante, qui restitue remarquablement le climat des années 1950, sur fond de guerre froide et de terreur atomique. Écrivain catholique ayant travaillé dans le renseignement durant la guerre, Greene est donc le mieux placé pour se moquer du catholicisme autant que des services secrets, qui fonctionnent comme n’importe quelle entreprise : l’obsession du cloisonnement se retourne contre elle-même, les grands chefs de Londres, totalement coupés des réalités, sont d’une extraordinaire incompétence et principalement occupés à se tirer dans les pattes ; et, comme dans toutes les compagnies, la meilleure façon de se débarrasser d’un incapable est de lui offrir une promotion. Utterly enjoyable.
P.-S. L’analogie entre espion et romancier, suggérée dans Ma vie dans la CIA d’Harry Mathews, figure déjà ici et donne lieu à de jolies pages.
John Le Carré, qui n’a jamais caché son admiration pour Greene, s’est manifestement inspiré de ce roman pour écrire le Tailleur de Panama.
Cryptogrammes

la grille de Mathias Sandorf
Dans les passionnants Entretiens de Julien Gracq (José Corti, 2002), il est question de littérature, de musique, de cinéma (un peu), de la géographie qu’il enseigna au lycée Louis-le-Grand (on aurait voulu avoir un pareil professeur), du merveilleux, de la création romanesque, de ses méthodes de travail,… et de Jules Verne, sa grande passion d’enfance, avant la découverte de Poe au lycée, puis de Breton. « La lecture de Jules Verne avait donné naissance pour moi à deux objets véritablement fétiches qui m’ont fasciné très longtemps. Il y a le boomerang, et puis l’autre c’est, dans Mathias Sandorf… la grille, qui permet de crypter un message. » Ces lignes ont fait naître un petit frisson tant je pourrais les faire miennes. Et je me demande si ce n’est pas à Sandorf que je dois le goût des cryptogrammes qui ont fasciné mon enfance ; fascination que j’assouvis par la suite avec Arsène Lupin et des séries d’espionnage pour la jeunesse comme Langelot et Kim Carnot (série concurrente de Bob Morane). Récemment, dans une brocante, j’ai racheté le premier Kim Carnot dans l’édition Marabout avec la couverture de Joubert, parce qu’il contenait une de ces grilles en annexe.
Dans le Très Curieux Jules Verne (Gallimard, 1969), livre fondamental qui modifia en profondeur la perception de l’auteur de l’Ile mystérieuse, Marcel Moré se penchait sur cette récurrence des cryptogrammes dans son œuvre (notamment dans la Jangada). Leur influence paraît certaine sur Raymond Roussel.
Gracq poursuit : « J’étais tout à fait captivé par cette idée… c’était là vraiment l’anneau de Gygès, on pouvait écrire des choses pour certains et les occulter aux autres. On pouvait devenir invisible à volonté ; si bien que, à ce moment (j’étais à l’école primaire), j’ai fabriqué immédiatement une grille. Dans l’édition Hetzel, il y avait la reproduction des quatre positions successives de la grille et, à l’école primaire, on s’envoyait toute la journée des messages cryptés… » Encore une fois, je pourrais contresigner ces lignes.
Tout lecteur de Jules Verne, de Roussel, de Perec est forcément amateur de cryptogrammes. Il trouvera son bonheur sur le site clair et très complet de Didier Müller. Au sommaire : une histoire et un lexique de la cryptologie, une description des principales techniques de chiffrage, une bibliographie commentée ainsi qu’une page de liens.







 La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).
La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall). Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.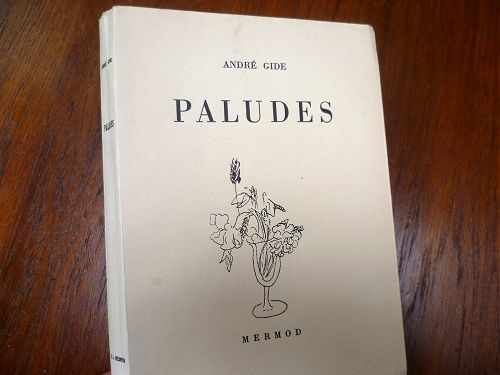
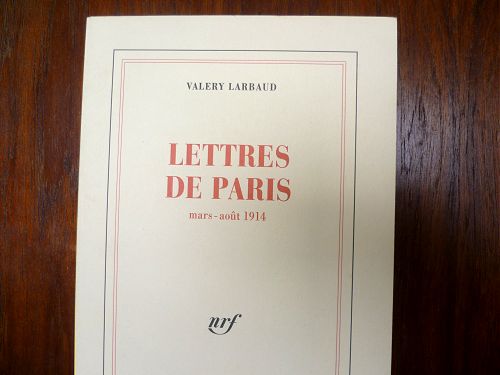
 Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001. Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.
Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.
