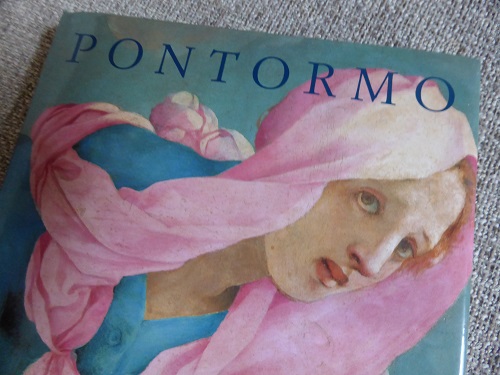Lectures expresses
Agatha Christie, l’Affaire Prothero (Murder at the Vicarage, 1930). Traduction de Claude Pierre-Langers. Librairie des Champs-Élysées, « Club des Masques », 1967.
 Il est toujours difficile de rendre un compte précis d’un whodunit sans en éventer l’intrigue. Voici donc quelques remarques périphériques.
Il est toujours difficile de rendre un compte précis d’un whodunit sans en éventer l’intrigue. Voici donc quelques remarques périphériques.
1. L’Affaire Prothero est le premier roman mettant en scène Miss Marple. Par coïncidence ou non, la clé du mystère obéit au même schéma que celle de la Mystérieuse Affaire de Styles, première enquête d’Hercule Poirot.
2. Le personnage de Miss Marple y apparaît plus vinaigré que l’image qu’on s’en fait. La vieille fille et commère de village, toujours furetant et surgissant au moment le moins opportun, n’est pas entièrement sympathique – par moments légèrement inquiétante – et casse gentiment les pieds à son entourage. C’est intéressant (et ici encore, un parallèle à faire avec l’insupportable Poirot). Il me semble qu’Agatha Christie a par la suite pastellisé son personnage pour en faire l’archétype de la vieille dame excentrique et malicieuse de province.
3. Agatha Christie appartient à la troisième génération – au moins – d’auteurs de romans policiers. Elle a une conscience très nette de sa place dans l’histoire d’un genre déjà constitué. De là, notamment : a) un certain goût pour le pastiche, par exemple dans le recueil Le crime est notre affaire dont chaque nouvelle est un hommage à un prédécesseur ou un contemporain. La possibilité d’un tel exercice suppose à sa date (1929) une culture partagée du genre par la romancière et son lectorat. b) le désir d’élargir le cadre du genre en proposant constamment de nouveaux prototypes (par exemple : Dix Petits Nègres, le Meurtre de Roger Ackroyd, le Crime de l’Orient-Express, La mort n’est pas une fin 1).
Cette conscience se répercute dans la fiction : les personnages de Christie ont lu, eux aussi, des romans policiers ! et y font souvent allusion (quand ils ne s’en inspirent pas pour commettre un crime, par exemple dans le Vallon). Dans l’Affaire Prothero, reviennent comme un refrain des propos tels que (en substance) « Nous ne sommes pas dans un roman policier » ou « Cela se passe ainsi dans les romans policiers mais il n’en va pas de même dans la réalité » – manière habile de renforcer l’effet de réalité, comme lorsque le narrateur d’une fiction romanesque affirme : « C’est une histoire vraie que je raconte. »
1. La mort n’est pas une fin est situé dans l’Égypte antique. Agatha Christie invente, quelques années avant Robert Van Gulik, un sous-genre, le roman policier historique, promis des décennies plus tard à un grand succès populaire et commercial.
Archéologie du frivole
Il y a quelques années, au cours d’un entretien radiophonique, Patrick Mauriès s’était qualifié d’« écrivain à l’œuvre diffuse ». On ne saurait mieux dire. Outre une cinquantaine de livres publiés (dont certains sont rassemblés, dans les listes « du même auteur », sous l’appellation charmante et parlante de « petits écrits »), l’œuvre de Mauriès consiste en effet en une quantité impressionnante de préfaces et de contributions à des catalogues d’expositions, ainsi qu’en d’innombrables articles dispersés dans des journaux et des revues souvent éphémères. Cette partie enfouie de l’iceberg ne peut qu’exciter la fibre du chasseur de trésors qui sommeille en tout lecteur – car Patrick Mauriès est de ces auteurs dont on a envie de tout lire. C’est donc un beau cadeau que nous fait L’Éditeur singulier en exhumant un corpus oublié de premier choix, sous le titre larbaldien de Pages arrachées à un journal de mode.
Cet élégant petit volume réunit les éditoriaux publiés en ouverture du mensuel le Jardin des modes entre 1989 et 1994. Quoique nés d’une commande, ces textes n’ont rien d’alimentaire et l’on y trouvera maint écho aux carnets qu’a publiés Mauriès dans l’intervalle, les Lieux parallèles et Fragments d’une forêt. Aussi, qu’il s’intéresse aux chiffons ou qu’il les tienne pour négligeables, tout lecteur épris de littérature prendra plaisir à ces miniatures orfévrées d’une plume légère et sûre.
L’éditorial est une forme d’écriture à contrainte. Sa longueur, toujours identique, est mesurée au mot près par des impératifs de mise en pages. Il doit tout à la fois indiquer la teneur du numéro qu’il introduit et l’inscrire dans un horizon plus large en se faisant chronique de cette chose impalpable qu’on nomme l’air du temps. Il lui incombe aussi de faire avec fraîcheur un sort aux sempiternels marronniers, tels que le changement des saisons ou le retour de la période des soldes.
Mauriès, qui excelle à capturer l’esprit du moment dans son délicat filet à papillons, se tire à merveille de cet exercice de style. Il était la personne tout indiquée pour s’y livrer, considérant son intérêt pour les objets d’art éphémères ou fragiles, les fluctuations du goût et de la sensibilité, les œuvres et les courants qualifiés de mineurs et longtemps rejetés aux marges de l’historiographie, la construction des « mythologies » contemporaines (au sens que Barthes prêtait à ce mot), dont les phénomènes de mode sont à la fois le sismographe et les grands pourvoyeurs. N’en déplaise au proverbe, les apparences même les plus frivoles ne sont pas trompeuses mais révélatrices. L’enveloppe est un signe, le vêtement dit tout de la personne qui le porte et de l’époque où elle vit. C’est au fond ce que suggèrent ces chroniques qui envisagent la mode à juste distance : sans enthousiasme niais, il va sans dire, mais sans l’ironie dédaigneuse des moralistes grincheux ; avec un alliage de curiosité vraie et de sympathie malicieuse. Considérant, mois après mois, l’avènement de nouvelles « tendances » ou le retour cyclique de certains phénomènes – le mouvement de la mode étant fait de ce double battement –, l’éditorialiste est tout autant attentif aux « éléments de langage » qui les portent – car le féru de rhétorique qu’est Mauriès 1 n’ignore pas que la mode est inséparable du discours sur la mode.
Trente années nous séparent de la première parution de ces éditoriaux. Leur réunion ressuscite le parfum d’un monde encore proche et déjà lointain. À distance, il apparaît qu’ils chroniquaient sans le savoir la fin d’une époque – aussi bien celle d’un certain régime de la mode que d’un segment éditorialement soigné de la presse spécialisée chargée d’en rendre compte et susceptible d’accueillir de tels écrits. Les impératifs commerciaux n’y excluaient pas encore un « joyeux climat d’improvisation et de bricolage ». À bien des égards, un fossé plus large sépare les années 1990 des années 2020 que des années 1930. Dans une postface substantielle, Mauriès analyse avec acuité les traits de ce changement d’ère, depuis l’absorption des dernières maisons de couture indépendantes dans de vastes conglomérats hégémoniques, source d’une uniformisation sans précédent à l’échelle du globe, jusqu’à l’omnipotence des médias numériques.
1. « Rien de moins naturel que le naturel ; rien qui échappe au trope. » Position qui prend valeur de manifeste en un temps qui se fait vertu de l’expression sans filtre de son petit soi, au nom d’une « authenticité » tonitruante.
 Patrick MAURIÈS, Pages arrachées à un journal de mode. L’Éditeur singulier, 2022, 109 p.
Patrick MAURIÈS, Pages arrachées à un journal de mode. L’Éditeur singulier, 2022, 109 p.

Lectures expresses
Pierre Nora, Une étrange obstination. Gallimard, 2022.
 Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés.
Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés.
En 2011, Pierre Nora avait réuni sous le titre d’Historien public un copieux choix d’articles assortis de chapeaux qui les replaçaient dans leur contexte et en nuançaient ou en corrigeaient, le cas échéant, certaines affirmations. L’ensemble composait une autobiographie intellectuelle où l’historien, beaucoup mieux à mon sens que dans Une étrange obstination, se faisait historien de lui-même. C’est ce volume qu’on suggère en priorité à qui voudrait se faire une idée de son parcours.
Lectures expresses
Jay McInerney, les Jours enfuis (Bright, Precious Days, 2016). Traduction de Marc Amfreville. L’Olivier, 2017.
 Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama.
Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama.
De temps à autre, on se dit qu’il faut bien lire un gros roman mainstream américain, et pour finir cela ressemble exactement à l’idée qu’on peut s’en faire sans l’avoir ouvert. Jay McInerney a sans conteste un talent de narrateur et d’observateur. Ce talent n’est pas donné à tout le monde, si l’on considère le nombre de romans qui vous tombent des yeux au bout de trois paragraphes quand on les feuillette en librairie. Néanmoins, son livre permet de mesurer le fossé qui sépare le storytelling de la littérature. L’un des symptômes en est un effet d’aplatissement qui réduit au même niveau tous les éléments de la narration, qu’ils soient signifiants ou adventices. Lire un roman de ce genre, même non dénué de mérites, fait l’effet de visionner une série télé sans la cinégénie, la lumière, les décors, les comédiens qui lui apporteraient le supplément de leur incarnation.
Lectures expresses
Pere Gimferrer, Interlude bleu (Interludio azul, 2006). Traduit de l’espagnol par Christophe David. Le Promeneur, 2009.
 Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :
Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :
Les rues nous emmènent à la rencontre de nous-mêmes, comme si la nuit barcelonaise était la nuit antillaise de tabac et de tambours de Vaudou de Jacques Tourneur, comme si le plein jour barcelonais était cette aube « claire et belle », avec le silence aujourd’hui inconcevable de l’aubade médiévale, dans laquelle Tirant sort à la recherche peut-être de Camesina, parce que notre histoire est aussi un roman de chevalerie, et nous marchons, hypnotisés par nous-mêmes – par ce que nous sommes, et par nos mots, dits comme s’ils étaient des talismans –, sans pesanteur à travers les trottoirs, transportés, hallucinés et pourtant, en même temps, horriblement lucides : c’est C., c’est moi, c’est nous deux, côte à côte, main dans la main, enveloppés dans la coquille noire de la nuit, dans la lumière fausse des néons, dans le masque de cire ou le grand masque de liège de la tombée du jour. Il commence à faire sombre : en même temps en 1969 et aujourd’hui.
Benoît Duteurtre, Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années folles. Plon, 2022.
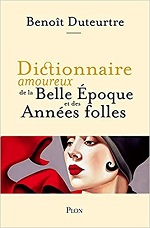 Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale.
Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale.
Lectures expresses
Agatha Christie, le Couteau sur la nuque (Lord Edgware Dies, 1933). Traduction de Louis Postif. Librairie des Champs-Élysées, « Le Masque », 1939.
 Agatha Christie recourt fréquemment au principe de substitution : le meurtrier s’est grimé pour se faire passer pour un autre ; la victime – éventuellement défigurée – n’est pas celle qu’on croyait. Ce principe, la romancière n’en est pas l’inventrice : Conan Doyle, Chesterton et la baronne Orczy l’avaient mis en œuvre avant elle. Mais, fidèle à son habitude, elle s’est attachée à en tirer des variations inédites. Dans le Couteau sur la nuque, la révélation de la substitution n’est ni le fruit d’un coup de théâtre ni celui d’un patient travail d’enquête : il est avéré d’emblée que A s’est fait passer pour B. Là gît précisément l’astuce : ce mystère étant éventé d’entrée de jeu, notre attention s’oriente vers d’autres pistes sans en creuser davantage les implications. À savoir que si A s’est fait passer pour B, cela signifie en retour que B s’est fait passer pour A, et que leur place respective sur l’échiquier n’était pas là où on les croyait. La permutation de A et de B est moins une fausse piste que la tache aveugle du récit. La vérité était si flagrante que nous ne l’avons point vue. Ajoutons que l’histoire se déroule dans le monde du théâtre, royaume par excellence du faux-semblant.
Agatha Christie recourt fréquemment au principe de substitution : le meurtrier s’est grimé pour se faire passer pour un autre ; la victime – éventuellement défigurée – n’est pas celle qu’on croyait. Ce principe, la romancière n’en est pas l’inventrice : Conan Doyle, Chesterton et la baronne Orczy l’avaient mis en œuvre avant elle. Mais, fidèle à son habitude, elle s’est attachée à en tirer des variations inédites. Dans le Couteau sur la nuque, la révélation de la substitution n’est ni le fruit d’un coup de théâtre ni celui d’un patient travail d’enquête : il est avéré d’emblée que A s’est fait passer pour B. Là gît précisément l’astuce : ce mystère étant éventé d’entrée de jeu, notre attention s’oriente vers d’autres pistes sans en creuser davantage les implications. À savoir que si A s’est fait passer pour B, cela signifie en retour que B s’est fait passer pour A, et que leur place respective sur l’échiquier n’était pas là où on les croyait. La permutation de A et de B est moins une fausse piste que la tache aveugle du récit. La vérité était si flagrante que nous ne l’avons point vue. Ajoutons que l’histoire se déroule dans le monde du théâtre, royaume par excellence du faux-semblant.
Denis Cosnard, le Paris de Georges Perec. La Ville mode d’emploi. Parigramme, 2022.
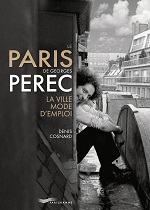 En attendant la parution annoncée d’une nouvelle biographie de Georges Perec par Claude Burgelin, voici un album bien documenté et fort agréablement rédigé sur le lien profond qui unissait l’écrivain à sa ville (le possessif n’est pas trop fort). « La ville n’est pas qu’un décor. De texte en texte, Perec la prend comme cadre de ses récits, mais aussi comme terrain de jeu, d’expérimentation, un “petit bout d’espace” qui mérite d’être examiné, cartographié méthodiquement, questionné jusqu’à l’épuisement. » L’ouvrage est conçu comme un inventaire chronologique des lieux-clés de la vie et de l’œuvre de Perec : domiciles, établissements scolaires, lieux de travail, places, cafés, brasseries et cinémas de prédilection, domiciles des compagnes et des amis… incluant bien sûr les douze sites élus pour le vaste chantier de Lieux, projet finalement abandonné mais qui n’a cessé d’irriguer souterrainement d’autres livres. Il ne s’agit pas seulement d’un parcours biographique. Chaque livre de Perec paru de son vivant est analysé chemin faisant sous l’angle parisien, en des notices alliant la pertinence à la concision. L’œuvre entière de l’écrivain se voit placée justement sous le double signe du manque et du faux. La très belle iconographie parachève la réussite de l’ensemble.
En attendant la parution annoncée d’une nouvelle biographie de Georges Perec par Claude Burgelin, voici un album bien documenté et fort agréablement rédigé sur le lien profond qui unissait l’écrivain à sa ville (le possessif n’est pas trop fort). « La ville n’est pas qu’un décor. De texte en texte, Perec la prend comme cadre de ses récits, mais aussi comme terrain de jeu, d’expérimentation, un “petit bout d’espace” qui mérite d’être examiné, cartographié méthodiquement, questionné jusqu’à l’épuisement. » L’ouvrage est conçu comme un inventaire chronologique des lieux-clés de la vie et de l’œuvre de Perec : domiciles, établissements scolaires, lieux de travail, places, cafés, brasseries et cinémas de prédilection, domiciles des compagnes et des amis… incluant bien sûr les douze sites élus pour le vaste chantier de Lieux, projet finalement abandonné mais qui n’a cessé d’irriguer souterrainement d’autres livres. Il ne s’agit pas seulement d’un parcours biographique. Chaque livre de Perec paru de son vivant est analysé chemin faisant sous l’angle parisien, en des notices alliant la pertinence à la concision. L’œuvre entière de l’écrivain se voit placée justement sous le double signe du manque et du faux. La très belle iconographie parachève la réussite de l’ensemble.
Serendipity
Si je n’avais pas été voir un mauvais film sur la foi de critiques laudatrices, je ne serais jamais passé par cette rue à l’écart de mes circuits et ne serais pas entré dans cette minuscule librairie d’un autre âge, dont l’aimable tenancière paraissait avoir depuis longtemps renoncé à dompter l’invraisemblable désordre. Je n’y aurais pas trouvé le catalogue raisonné de l’œuvre de Pontormo, traqué en vain depuis des années, les rares exemplaires en circulation étant proposés à des prix de spéculation délirants sur internet.
J’adresse donc ma gratitude aux critiques de cinéma qui recommandent de mauvais films. Vous avez fait mon année.
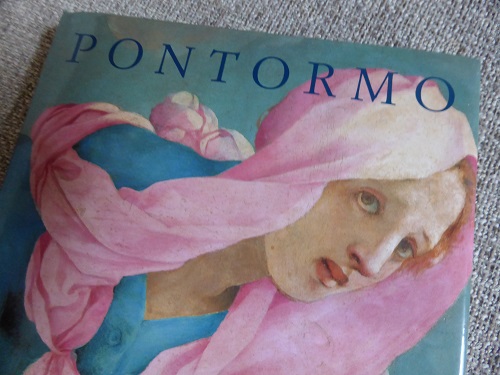
 Il est toujours difficile de rendre un compte précis d’un whodunit sans en éventer l’intrigue. Voici donc quelques remarques périphériques.
Il est toujours difficile de rendre un compte précis d’un whodunit sans en éventer l’intrigue. Voici donc quelques remarques périphériques.

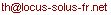



 Patrick MAURIÈS,
Patrick MAURIÈS, 
 Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés.
Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés. Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama.
Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama. Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :
Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :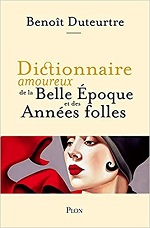 Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale.
Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale. Agatha Christie recourt fréquemment au principe de substitution : le meurtrier s’est grimé pour se faire passer pour un autre ; la victime – éventuellement défigurée – n’est pas celle qu’on croyait. Ce principe, la romancière n’en est pas l’inventrice : Conan Doyle, Chesterton et la baronne Orczy l’avaient mis en œuvre avant elle. Mais, fidèle à son habitude, elle s’est attachée à en tirer des variations inédites. Dans le Couteau sur la nuque, la révélation de la substitution n’est ni le fruit d’un coup de théâtre ni celui d’un patient travail d’enquête : il est avéré d’emblée que A s’est fait passer pour B. Là gît précisément l’astuce : ce mystère étant éventé d’entrée de jeu, notre attention s’oriente vers d’autres pistes sans en creuser davantage les implications. À savoir que si A s’est fait passer pour B, cela signifie en retour que B s’est fait passer pour A, et que leur place respective sur l’échiquier n’était pas là où on les croyait. La permutation de A et de B est moins une fausse piste que la tache aveugle du récit. La vérité était si flagrante que nous ne l’avons point vue. Ajoutons que l’histoire se déroule dans le monde du théâtre, royaume par excellence du faux-semblant.
Agatha Christie recourt fréquemment au principe de substitution : le meurtrier s’est grimé pour se faire passer pour un autre ; la victime – éventuellement défigurée – n’est pas celle qu’on croyait. Ce principe, la romancière n’en est pas l’inventrice : Conan Doyle, Chesterton et la baronne Orczy l’avaient mis en œuvre avant elle. Mais, fidèle à son habitude, elle s’est attachée à en tirer des variations inédites. Dans le Couteau sur la nuque, la révélation de la substitution n’est ni le fruit d’un coup de théâtre ni celui d’un patient travail d’enquête : il est avéré d’emblée que A s’est fait passer pour B. Là gît précisément l’astuce : ce mystère étant éventé d’entrée de jeu, notre attention s’oriente vers d’autres pistes sans en creuser davantage les implications. À savoir que si A s’est fait passer pour B, cela signifie en retour que B s’est fait passer pour A, et que leur place respective sur l’échiquier n’était pas là où on les croyait. La permutation de A et de B est moins une fausse piste que la tache aveugle du récit. La vérité était si flagrante que nous ne l’avons point vue. Ajoutons que l’histoire se déroule dans le monde du théâtre, royaume par excellence du faux-semblant.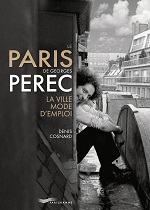 En attendant la parution annoncée d’une nouvelle biographie de Georges Perec par Claude Burgelin, voici un album bien documenté et fort agréablement rédigé sur le lien profond qui unissait l’écrivain à sa ville (le possessif n’est pas trop fort). « La ville n’est pas qu’un décor. De texte en texte, Perec la prend comme cadre de ses récits, mais aussi comme terrain de jeu, d’expérimentation, un “petit bout d’espace” qui mérite d’être examiné, cartographié méthodiquement, questionné jusqu’à l’épuisement. » L’ouvrage est conçu comme un inventaire chronologique des lieux-clés de la vie et de l’œuvre de Perec : domiciles, établissements scolaires, lieux de travail, places, cafés, brasseries et cinémas de prédilection, domiciles des compagnes et des amis… incluant bien sûr les douze sites élus pour le vaste chantier de Lieux, projet finalement abandonné mais qui n’a cessé d’irriguer souterrainement d’autres livres. Il ne s’agit pas seulement d’un parcours biographique. Chaque livre de Perec paru de son vivant est analysé chemin faisant sous l’angle parisien, en des notices alliant la pertinence à la concision. L’œuvre entière de l’écrivain se voit placée justement sous le double signe du manque et du faux. La très belle iconographie parachève la réussite de l’ensemble.
En attendant la parution annoncée d’une nouvelle biographie de Georges Perec par Claude Burgelin, voici un album bien documenté et fort agréablement rédigé sur le lien profond qui unissait l’écrivain à sa ville (le possessif n’est pas trop fort). « La ville n’est pas qu’un décor. De texte en texte, Perec la prend comme cadre de ses récits, mais aussi comme terrain de jeu, d’expérimentation, un “petit bout d’espace” qui mérite d’être examiné, cartographié méthodiquement, questionné jusqu’à l’épuisement. » L’ouvrage est conçu comme un inventaire chronologique des lieux-clés de la vie et de l’œuvre de Perec : domiciles, établissements scolaires, lieux de travail, places, cafés, brasseries et cinémas de prédilection, domiciles des compagnes et des amis… incluant bien sûr les douze sites élus pour le vaste chantier de Lieux, projet finalement abandonné mais qui n’a cessé d’irriguer souterrainement d’autres livres. Il ne s’agit pas seulement d’un parcours biographique. Chaque livre de Perec paru de son vivant est analysé chemin faisant sous l’angle parisien, en des notices alliant la pertinence à la concision. L’œuvre entière de l’écrivain se voit placée justement sous le double signe du manque et du faux. La très belle iconographie parachève la réussite de l’ensemble.