Alice crime
 « Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
« Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
 Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.
Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.
Roger Tailleur
 En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson.
En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch de Samson Raphaelson.
Roger Tailleur est mort brusquement en 1985, des suites d’une leucémie aiguë. Il avait cinquante-huit ans. On ne sait pas assez qu’il fut l’un des meilleurs critiques de cinéma de sa génération. (Actes Sud a publié en 1997 un choix de ses articles, parus pour l’essentiel dans Positif. L’intelligence et l’érudition l’y disputent à l’alacrité.)
En 1968, Tailleur posa la plume, cessa de voir des films, revendit sa bibliothèque de cinéma et ne se consacra plus qu’à sa nouvelle passion : l’Italie.
Il entreprit de l’explorer région par région, province par province. Il mettait des mois à préparer ses itinéraires. Il détestait l’imprévu… Il mit à découvrir l’Italie le même acharnement, la même inépuisable érudition, le même souci du détail, le même bonheur enfin qu’il éprouvait, critique de cinéma, à tout savoir et tout retenir de la filmographie d’Henry King ou d’Humphrey Bogart.
Pour conjurer la disparition brutale de son ami, Frédéric Vitoux a écrit dans les mois qui suivirent sa mort ce récit qui est un petit chef-d’oeuvre d’émotion retenue. Il l’y fait si bien revivre qu’on a l’impression d’avoir nous aussi connu cet homme solitaire et secret, méthodique jusqu’à la manie, qui avait tourné le dos à son époque pour habiter un monde, un temps à lui, et avait élevé au rang des beaux-arts la collection – et la rédaction – de cartes postales ; son humour irrésistible, ses enthousiasmes et ses emportements, son merveilleux rire. Impossible désormais de penser à l’Italie sans penser à lui.
 Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p.
Frédéric VITOUX, Il me semble désormais que Roger est en Italie. Actes Sud, 1986. Rééd. Babel n° 335, 55 p.
 Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.
Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.

L’imprévu
Un lapin ne nous effraie point ; mais le brusque départ d’un lapin inattendu peut nous mettre en fuite.
Ainsi en est-il de telle idée, qui nous émerveille, nous transporte, pour nous être soudaine, et devient, peu après – ce qu’elle est…
L’homme insoucieux, l’imprévoyant, est moins accablé et démonté par l’événement catastrophique que le prévoyant.
Pour l’imprévoyant, le minimum d’imprévu. – Quoi d’Imprévu pour qui n’a rien prévu ?
Les causes véritables sont souvent des faits ou des circonstances auxquels il serait SUPRÊMEMENT ABSURDE de songer a priori, tant ils sont hors du sujet, – hors de toute prévision.
Les causes à quoi l’on songe sont, au contraire, de celles qu’on trouve parce qu’on les a déjà trouvées. Rien n’est plus vain.
En y pensant un peu trop, on en viendrait à faire dépendre la probabilité d’une cause… de son imprévu.
Paul Valéry, Tel Quel.
Chapeau bas
19h45, place du 8-Mai-1945 à Saint-Denis, arrêt de bus, je porte un manteau en cuir noir et un chapeau d’homme gris. Je sens quelqu’un qui cherche à m’aborder. Je me retourne. Un jeune des banlieues sensibles, issu de je ne sais quelle génération de travailleurs d’Afrique du Nord. Avec capuche…
– Madame, je peux vous poser une question ?
– Bien sûr.
– Ça a quelle signification votre chapeau ?
– C’est pour faire joli.
– Mais non ! Ça a quelle signification votre chapeau ?
– ???…
– Vous êtes juive ou chrétienne ?
– ??? !!! Je suis athée.
– C’est quoi AT ?
– A-thée, c’est sans dieu…
Et je suis montée dans l’autobus.
Plus tard je suis allée au cinéma sans chapeau.
Brigitte Lesaffre (Saint-Denis)
Courrier des lecteurs du Monde, 11 mars 2006.
John Crosby
Qu’attend-on d’un bon polar ? Une intrigue serrée, évidemment, et qui tient en haleine, comme on dit. Mais au-delà, un regard décapant sur le monde actuel et ses turpitudes, porté par une écriture, un ton original. Avec John Crosby, on est royalement servi. Horatio Cassidy, son héros récurrent, est l’un des personnages les plus originaux de la série « grands détectives » de 10/18. Cassidy est un ex-agent de la CIA qui s’est fait virer de cette auguste maison pour des motifs mal élucidés. La vérité est que cet Irlandais brillant et cultivé est un idéaliste sans illusions, si l’on peut dire, qui ne croit ni en dieu ni en diable, un franc-tireur qui ne mâche pas ses mots. Autant de péchés qui ne pardonnent pas dans le monde peu reluisant de l’espionnage. Fin lettré, il enseigne à présent l’histoire médiévale. La CIA fait ponctuellement appel à ses services pour des affaires auxquelles elle ne veut pas être officiellement mêlée, en la personne de Hugh Alison, l’homme qui a survécu à toutes les guéguerres internes de l’Agence parce qu’il maîtrise comme pas un l’art de mouiller les autres en passant lui-même entre les gouttes. Le portrait de ce fonctionnaire de l’espionnage hypocrite et onctueux et fiéffé salopard est particulièrement réussi, et ses échanges à fleurets mouchetés avec Cassidy valent leur pesant de cacahuètes – car Crosby est un dialoguiste hors-pair. C’est aussi un amateur d’intrigues touffues, crédibles sur le fond et peuplées cependant de personnages excentriques et de péripéties hénaurmes, que Cassidy débrouille à sa manière inorthodoxe : à la fois érudit et homme d’action, ce pédagogue anticonformiste puise régulièrement dans ses connaissances en histoire antique et médiévale des leçons de stratégie pour mener à bien les guerres contemporaines. Ce regard surplombant de l’Histoire fait le sel de ces romans qui composent en sous-main une épopée à la fois cruelle, violente et dérisoire de notre temps – ou du temps d’avant-hier, puisque, écrits entre 1979 et 1985, ils se déroulent sur fond de guerre froide finissante, mais les choses ont-elles tellement changé [1]? Le Clou de la saison dépeint notamment la décadence des riches cloîtrés dans un immeuble-bunker pourvu de tous les gadgets de surveillance dernier cri (et bientôt pris d’assaut par des armadas de terroristes). Dans Tu paies un canon ?, un rafiot bourré d’engins explosifs sophistiqués, oublié en rade dans le port de New York, excite la convoitise de puissances diverses (la Syrie, Israël, l’OLP et bien entendu la mafia). Pas de quartier ! s’en prend au trafic de la drogue, fondement de l’économie de régimes latino-américains corrompus jusqu’à la moelle où l’on torture et tue à tout-va – et accessoirement fer de lance de la Realpolitik américaine (la CIA et jusqu’à la Maison Blanche sont mouillées jusqu’au cou). Mais avec tout ça, j’oublierais presque l’essentiel, qui est que ces livres formidablement drôles sont un régal pour l’intelligence, et que leur humour cinglant est source d’une intense jubilation.

1. « Il avait choisi pour sujet la sorcellerie et la place qu’elle occupait dans les sociétés médiévales. Il projetait de ranger le christianisme parmi ces superstitions, classification qui lui avait valu quantité d’ennuis par le passé et qui ne pourrait que lui en valoir davantage encore en cette époque de fanatisme religieux à outrance. Le président des États-Unis n’avait-il pas déclaré qu’il considérait que chaque mot de la Bible était d’inspiration divine ? Il faudra que je rappelle à mes petits monstres, songea Cassidy, que la Bible est la traduction de la traduction d’une traduction et qu’une bonne partie de son contenu a, en fait, été empruntée aux religions païennes par les chrétiens qui en ont fait leur miel au gré de leur fantaisie. » (Tu paies un canon ?).
Écrit sous Reagan, encore plus vrai sous Bush, Jr.
« – Je voulais simplement tenir [le président] au courant. L’opération a commencé. – Il ne veut pas le savoir, dit-elle en lui raccrochant brutalement au nez. Alison rougit et raccrocha à son tour. La nouvelle diplomatie. Le droit de savoir avait constitué le privilège suprême. Sous Reagan était apparu un privilège encore plus grand, celui de ne pas savoir. (Sous Reagan, les États-Unis avaient véritablement entamé des pourparlers avec l’OLP sans en avertir le président. S’ils avaient abouti, le mérite en aurait rejailli sur lui. Sinon, il n’avait jamais été au courant. Mieux encore, il ne s’était rien passé. » (Pas de quartier !)
Celle qui raccroche au nez d’Alison, c’est Harriet Van Fleet, conseillère du président et sosie prémonitoire de Condoleezza Rice (le roman, rappelons-le, a été écrit en 1985).
***
Par ordre de préférence : le Clou de la saison et Pas de quartier ! Ensuite : À la volée. L’intrigue de Tu paies un canon ? est plus faible mais le livre reste d’une lecture plaisante.
Le Clou de la saison et Tu paies un canon ? ont d’abord été publiés par la Série noire avant d’être réédités dans la série « grands détectives » de 10/18, où ont paru directement les deux autres.
Henry « Red » Allen
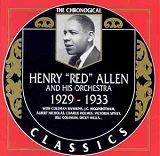 Une très chouette découverte. La réputation de Henry « Red » Allen (deuxième meilleur trompettiste de son temps après Louis Armstrong) n’est pas usurpée. L’influence d’Armstrong, qui régnait alors sans partage, est inévitable (quel musicien ne l’a pas subie en son temps ?), mais Allen s’en est tôt affranchie pour voler de ses propres ailes, en cultivant une excentricité dont les traits imprévisibles tiennent l’oreille en alerte. Il se produit ici en petite formation avec d’autres membres de l’orchestre de Luis Russel, en particulier le merveilleux tromboniste J.C. Higginbotham et un altiste épatant, Charlie Holmes, qu’on dirait le petit frère de Johnny Hodges. Tout n’est pas égal, c’est le revers des intégrales – et il faut notamment se farcir quelques chanteurs/trices catastrophiques. Mais il y a là-dedans une poignée de perles pleines de fraîcheur et de vivacité. Les quatre premières plages en particulier (It Should Be You, Biff’ly Blues, Feeling Drowsy et Swing Out) sont des petits chefs-d’œuvre, superbement conçus et exécutés.
Une très chouette découverte. La réputation de Henry « Red » Allen (deuxième meilleur trompettiste de son temps après Louis Armstrong) n’est pas usurpée. L’influence d’Armstrong, qui régnait alors sans partage, est inévitable (quel musicien ne l’a pas subie en son temps ?), mais Allen s’en est tôt affranchie pour voler de ses propres ailes, en cultivant une excentricité dont les traits imprévisibles tiennent l’oreille en alerte. Il se produit ici en petite formation avec d’autres membres de l’orchestre de Luis Russel, en particulier le merveilleux tromboniste J.C. Higginbotham et un altiste épatant, Charlie Holmes, qu’on dirait le petit frère de Johnny Hodges. Tout n’est pas égal, c’est le revers des intégrales – et il faut notamment se farcir quelques chanteurs/trices catastrophiques. Mais il y a là-dedans une poignée de perles pleines de fraîcheur et de vivacité. Les quatre premières plages en particulier (It Should Be You, Biff’ly Blues, Feeling Drowsy et Swing Out) sont des petits chefs-d’œuvre, superbement conçus et exécutés.
 Henry « Red » ALLEN and His Orchestra 1929-1933. Classics 540.
Henry « Red » ALLEN and His Orchestra 1929-1933. Classics 540.
Catherine Binet (1944-2006)
Catherine Binet est morte hier à Paris. Elle avait soixante et un ans. Celle qui fut la compagne de Georges Perec avait réalisé en 1980 un fascinant film-ovni qui mériterait d’être mieux connu, les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz, inspiré du très beau texte d’Unica Zurn, Sombre Printemps.
Elle ne réussit pas à monter son projet suivant, l’adaptation d’un texte exhumé par Michel Foucault, Herculine Barbin, dite Alexina B. Mais tourna néanmoins des courts métrages sur l’art, Trompe-l’oeil (1982), les Passages parisiens (1982), Jacques Carelman (1983), que je n’ai pas vus, – et réalisa en 1990 ce qui reste à ce jour le meilleur documentaire sur Georges Perec, Te souviens-tu de Gaspard Winkler ?
Elle avait publié il y a quelques mois un intéressant livre carnet de bord, les Fleurs de la Toussaint (paru chez un éditeur, Champtin, qui a malheureusement travaillé comme un cochon).
Voilà. Tristesse.
 « Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
« Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout. Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.
Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.





 En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et
En le voyant dans la vitrine d’une librairie d’occasion, je suis entré pour le racheter. C’est un petit livre que je relis souvent, que j’aime offrir – l’un des plus beaux qu’ait inspiré l’amitié, avec le Verger de Harry Mathews et  Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.
Roger TAILLEUR, Viv(r)e le cinéma. Actes Sud/Institut Lumière, 1997, 474 p.

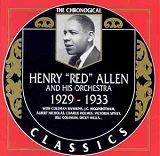 Une très chouette découverte. La réputation de Henry « Red » Allen (deuxième meilleur trompettiste de son temps après Louis Armstrong) n’est pas usurpée. L’influence d’Armstrong, qui régnait alors sans partage, est inévitable (quel musicien ne l’a pas subie en son temps ?), mais Allen s’en est tôt affranchie pour voler de ses propres ailes, en cultivant une excentricité dont les traits imprévisibles tiennent l’oreille en alerte. Il se produit ici en petite formation avec d’autres membres de l’orchestre de Luis Russel, en particulier le merveilleux tromboniste J.C. Higginbotham et un altiste épatant, Charlie Holmes, qu’on dirait le petit frère de Johnny Hodges. Tout n’est pas égal, c’est le revers des intégrales – et il faut notamment se farcir quelques chanteurs/trices catastrophiques. Mais il y a là-dedans une poignée de perles pleines de fraîcheur et de vivacité. Les quatre premières plages en particulier (It Should Be You, Biff’ly Blues, Feeling Drowsy et Swing Out) sont des petits chefs-d’œuvre, superbement conçus et exécutés.
Une très chouette découverte. La réputation de Henry « Red » Allen (deuxième meilleur trompettiste de son temps après Louis Armstrong) n’est pas usurpée. L’influence d’Armstrong, qui régnait alors sans partage, est inévitable (quel musicien ne l’a pas subie en son temps ?), mais Allen s’en est tôt affranchie pour voler de ses propres ailes, en cultivant une excentricité dont les traits imprévisibles tiennent l’oreille en alerte. Il se produit ici en petite formation avec d’autres membres de l’orchestre de Luis Russel, en particulier le merveilleux tromboniste J.C. Higginbotham et un altiste épatant, Charlie Holmes, qu’on dirait le petit frère de Johnny Hodges. Tout n’est pas égal, c’est le revers des intégrales – et il faut notamment se farcir quelques chanteurs/trices catastrophiques. Mais il y a là-dedans une poignée de perles pleines de fraîcheur et de vivacité. Les quatre premières plages en particulier (It Should Be You, Biff’ly Blues, Feeling Drowsy et Swing Out) sont des petits chefs-d’œuvre, superbement conçus et exécutés.