Bilan annuel
Livres lus : 87 (+ 4 par rapport à 2005)
Films vus : 113 (- 26)
Séries : 15 (pour un total de 19 saisons, soit 11 saisons complètes, 6 saisons en cours et 2 abandons)
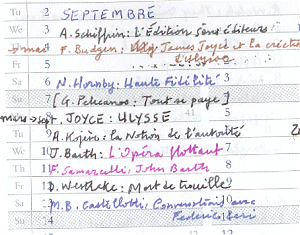
Locus Solus s’honore d’une moyenne de 580 visiteurs par mois. Beaucoup d’entre eux, soyons juste, atterrissent en ces lieux par erreur, aiguillés par l’humour impénétrable des moteurs de recherche à la suite d’étranges requêtes, dont voici un florilège :
casquette fantaisie double visière – sosie de Condolezza Rice – soudure sur cuivre – mystère insoluble – entretien de la barbe – monter une escroquerie – dimension alvéoles de bibliothèque – nymphomanie – fonctionnement du bélinographe – film pianiste maladie mentale – peinture d’amoureux dans un bistro – décoration fenêtre blanc d’Espagne – techniques de narration du roman classique – la signification du chapeau – autocar transformé – inventions entre 1966 et 1969 Woodstock – portrait psychologique George Bush – vêtement anticonformiste – où est l’amitié dans le mensonge ? – rayonnages sur fils tendus – escroquerie à l’héritage assurances vie – le dépucelage par une professionnelle – textes pour écrire une invitation à l’inauguration d’un film – toque fourrure véritable – poème pour ma soeur jumelle gratuit – éloge funèbre alcoolique – conserves de cornichons – saccage pâtisserie – excréments Queneau – choix d’un verbe rare – sosie milliardaire – peinture toile vieille fontaine – farce dont la victime est le narrateur – quelle guerre vient de se terminer quand Edmond Rostand naît ? – murder party scénario gaulois – sans papier ni stylo – scène compromettante télé – baleine échouée plage David – faire la fête au palace Paris 1990 – poème débutant hard et cru – arnaques magouilles – raccords trois pièces – la grille mystérieuse avec dramatisation – envoûtement télépathique – Flaubert sa frustration – joint de dilatation détail technique – ancêtre du télécopieur- qu’est-ce que la sincérité ?
Dans un réseau de lignes entrecroisées
Sur écoute (The Wire), première saison
David Simon, HBO, 2002.

Certainement l’une des plus grandes séries de ces dernières années. Dense, complexe, anti-spectaculaire, avec une approche semi-documentaire, une richesse sociologique et une ampleur qui en font sans exagération l’égale des meilleurs romans noirs contemporains (outre des journalistes et des ex-policiers, l’équipe de scénaristes compte d’ailleurs deux romanciers, Dennis Lehane et George Pelecanos). Au contraire de la plupart des séries policières, qui bouclent mécaniquement une affaire par épisode, c’est une seule longue enquête qui occupe les treize heures de la première saison 1. Et à contre-courant du style coup de poing adopté par tant d’autres, pour le meilleur (The Shield) ou pour le pire (24 heures chrono), Sur écoute parie sur la durée, en prenant le temps d’installer un univers moralement complexe, de nombreux personnages et des intrigues parallèles — au sein desquelles le spectateur, d’abord délicieusement égaré, trouve peu à peu ses repères.
L’échiquier : Baltimore, qui est au fond le personnage principal de la série (l’ancrage géographique précis est décidément l’une des grandes forces des fictions américaines, à l’écrit comme à l’écran). Les joueurs : une cellule d’enquête composée de membres de la brigade criminelle et d’agents des stups, chargée de démanteler un gang de trafiquants de drogue ayant mainmise sur un quartier de la ville — et d’emblée mal vue de sa hiérarchie. De part et d’autre de la barrière, ni des super-flics ni des super-dealers, mais des gens ordinaires, des compétents et des incapables, des têtes brûlées et des bras cassés, des paumés, des futés et des parfaits crétins. La partie : un va-et-vient entre flics et malfrats, un fascinant puzzle dont les pièces se mettent très lentement en place, chaque nouvelle pièce redessinant la configuration de l’ensemble. Une peinture remarquable du travail ingrat, routinier, répétitif des enquêteurs, auxquels leurs supérieurs mettent autant sinon plus de bâtons dans les roues que les trafiquants : manque de moyens criant, locaux inadéquats attribués de manière vexatoire, tracasseries bureaucratiques, querelles de précellence et conflits d’intérêt, arrière-pensées carriéristes des chefs de division, qui exigent des résultats rapides et superficiels pour gonfler les statistiques et parader dans les médias, quitte à compromettre le travail de fond de l’enquête (surtout lorsque celle-ci menace d’éclabousser quelques notables). En face, un tableau non moins juste du monde des petits trafiquants, qui a lui aussi son organisation, ses lois, sa hiérarchie. En somme, deux systèmes parallèles qui jouent au chat et à la souris, deux stratégies qui s’affrontent et interagissent, chaque avancée de l’enquête amenant les dealers à revoir en conséquence leur modus operandi — et réciproquement.
Ainsi se dessine, épisode après épisode, un réseau aux ramifications tentaculaires, où tout communique avec tout. Écoutes téléphoniques, intérêts croisés, circulation de l’argent qui, depuis le trafic de drogue, irrigue souterrainement la ville, du financement occulte des partis politiques jusqu’au marché de l’immobilier. Pas de happy end, évidemment. Au bout du compte, ce patient travail de Pénélope n’aboutira qu’à un procès décevant, tronqué par des marchandages préalables entre avocats et procureurs — tandis que, dans les cités de Baltimore Ouest, le trafic reprend de plus belle. Ce dénouement amer en forme de « tout ça pour ça » laisse suffisamment de pistes ouvertes pour suggérer que cette saison est elle-même la première pièce d’un ensemble plus vaste, sur lequel les chapitres suivants apporteront un nouvel éclairage. À suivre, donc.
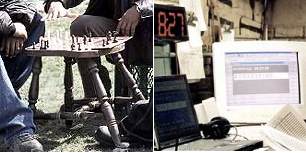
L’échiquier et le réseau : deux métaphores possibles de Sur écoute.
1 Il n’y a qu’un précédent à ma connaissance, c’est Murder One (1995), qui consacrait toute une saison à la résolution d’une seule grande affaire, de la découverte du crime au verdict du procès (série produite par Steve Bochco, dont on n’a pas fini de mesurer le rôle de pionnier dans le renouvellement de la fiction policière de ces vingt dernières années).
Ping-pong. Pour un point de vue approfondi sur les trois premières saisons, cf. Exit option. La quatrième saison est encore inédite en DVD.
Aimer, lire, écrire
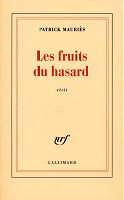 Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?
Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?
 Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.
Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.
Le coffret du mois
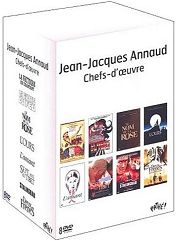
Encore un que la modestie étouffe.
En porte-à-faux
 Les magouilles immobilières occupent également l’une des deux intrigues croisées de The Detective (Gordon Douglas, 1968), film qui jouit en son temps d’un certain renom et dont j’attendais la découverte depuis vingt ans. Well, c’est une franche déception. Malgré une construction ingénieuse – dont les articulations sont bien lourdement soulignées cependant -, le film s’est démodé, comme beaucoup d’autres de la même époque qui prétendaient profiter de l’assouplissement de la censure pour aborder de manière «sérieuse» et «adulte» des sujets «dérangeants» : l’homosexualité (traitée de manière caricaturale), la nymphomanie (pauvre Lee Remick !), la maladie mentale (l’Actor’s Studio fait des ravages), le statut d’une autorité frappée de désuétude par la libération des mœurs. Il en résulte un porte-à-faux bizarre entre ce que veut dire le film et ce qu’il donne à voir, entre un propos empreint de critique sociale (peinture plutôt réussie de la brutalité et de la connerie policière ordinaire, dénonciation des préjugés racistes et homophobes) et sa représentation, qui s’abîme dans le stéréotype et le ridicule.
Les magouilles immobilières occupent également l’une des deux intrigues croisées de The Detective (Gordon Douglas, 1968), film qui jouit en son temps d’un certain renom et dont j’attendais la découverte depuis vingt ans. Well, c’est une franche déception. Malgré une construction ingénieuse – dont les articulations sont bien lourdement soulignées cependant -, le film s’est démodé, comme beaucoup d’autres de la même époque qui prétendaient profiter de l’assouplissement de la censure pour aborder de manière «sérieuse» et «adulte» des sujets «dérangeants» : l’homosexualité (traitée de manière caricaturale), la nymphomanie (pauvre Lee Remick !), la maladie mentale (l’Actor’s Studio fait des ravages), le statut d’une autorité frappée de désuétude par la libération des mœurs. Il en résulte un porte-à-faux bizarre entre ce que veut dire le film et ce qu’il donne à voir, entre un propos empreint de critique sociale (peinture plutôt réussie de la brutalité et de la connerie policière ordinaire, dénonciation des préjugés racistes et homophobes) et sa représentation, qui s’abîme dans le stéréotype et le ridicule.
Cela dit, Sinatra est parfait en flic tourmenté d’un autre âge ; le côté chronique dédramatisée du film (qui aurait pu devenir réellement passionnant entre des mains plus expertes) tranche agréablement sur les westerns policiers de la même période du genre Coogan’s Bluff, et l’amertume des tout derniers plans, qui voient Leland/Sinatra s’enfoncer dans sa nuit, reste émouvante. Mais à distance, la principale curiosité de The Detective tient peut-être à ce que sa description de la vie quotidienne d’un commissariat en fait à son insu une charnière entre le cinéma criminel classique et les séries télé policières qui prendront ultérieurement le relais.
Un goût de cendres
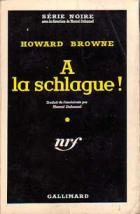 Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Payne ressemble effectivement à Marlowe comme un frère. Détective privé de Chicago, il enquête dans la petite ville voisine d’Olympic Heights sur la disparition d’un collègue, et se voit mettre les bâtons dans les roues par la police locale, beaucoup trop polie pour être honnête, et fort empressée à camoufler un meurtre en suicide pour protéger du scandale une famille de notables aux rejetons dégénérés. Chantages, combines immobilières et secrets de famille se partagent une intrigue convenablement enchevêtrée, où l’on croise des édiles imbibés, des mafieux au coup de poing facile et quelques mouquères diablement ambiguës. Et tout ce petit monde se dispute un McGuffin dont, ironiquement, la teneur ne sera pas dévoilée. De la première ligne à l’épilogue, Browne se montre tout à fait digne de Chandler et signe un roman noir d’excellente facture, qui mériterait la réédition en Folio policier.
 Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.
Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.
Contribution à une Anthologie du métrage
(private joke à destination de trois personnes)
Un verrou coulissa à l’intérieur et la porte s’entrouvrit juste assez pour découvrir un métrage de tablier bleu, un nez pointu et un œil inquisiteur derrière une paire d’épaisses lunettes à double foyer.
Howard Browne, À la schlague !, Série noire n° 470.
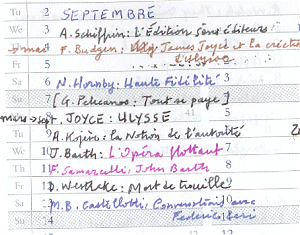







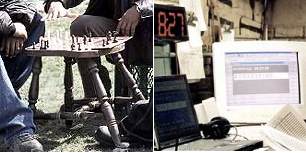
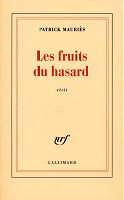 Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?
Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ? Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.
Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.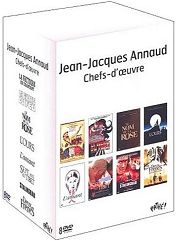
 Les magouilles immobilières occupent également l’une des deux intrigues croisées de The Detective (Gordon Douglas, 1968), film qui jouit en son temps d’un certain renom et dont j’attendais la découverte depuis vingt ans. Well, c’est une franche déception. Malgré une construction ingénieuse – dont les articulations sont bien lourdement soulignées cependant -, le film s’est démodé, comme beaucoup d’autres de la même époque qui prétendaient profiter de l’assouplissement de la censure pour aborder de manière «sérieuse» et «adulte» des sujets «dérangeants» : l’homosexualité (traitée de manière caricaturale), la nymphomanie (pauvre Lee Remick !), la maladie mentale (l’Actor’s Studio fait des ravages), le statut d’une autorité frappée de désuétude par la libération des mœurs. Il en résulte un porte-à-faux bizarre entre ce que veut dire le film et ce qu’il donne à voir, entre un propos empreint de critique sociale (peinture plutôt réussie de la brutalité et de la connerie policière ordinaire, dénonciation des préjugés racistes et homophobes) et sa représentation, qui s’abîme dans le stéréotype et le ridicule.
Les magouilles immobilières occupent également l’une des deux intrigues croisées de The Detective (Gordon Douglas, 1968), film qui jouit en son temps d’un certain renom et dont j’attendais la découverte depuis vingt ans. Well, c’est une franche déception. Malgré une construction ingénieuse – dont les articulations sont bien lourdement soulignées cependant -, le film s’est démodé, comme beaucoup d’autres de la même époque qui prétendaient profiter de l’assouplissement de la censure pour aborder de manière «sérieuse» et «adulte» des sujets «dérangeants» : l’homosexualité (traitée de manière caricaturale), la nymphomanie (pauvre Lee Remick !), la maladie mentale (l’Actor’s Studio fait des ravages), le statut d’une autorité frappée de désuétude par la libération des mœurs. Il en résulte un porte-à-faux bizarre entre ce que veut dire le film et ce qu’il donne à voir, entre un propos empreint de critique sociale (peinture plutôt réussie de la brutalité et de la connerie policière ordinaire, dénonciation des préjugés racistes et homophobes) et sa représentation, qui s’abîme dans le stéréotype et le ridicule.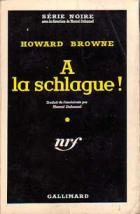 Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !