Contributions au Dictionnaire de la bêtise
« Être prêt [pour la « révolution » du livre numérique], cela suppose bien sûr d’avoir des titres numérisés, mais également de travailler à leur enrichissement. Car de la même façon qu’un film en DVD est vendu avec des bonus, le roman, l’essai ou le document qu’on pourra lire demain sur tablette sera très certainement accompagné de contenus multimédias […]. Une façon de donner de la profondeur au livre et de développer le plaisir de la lecture » (Diane Wulweck, Le Monde 2, 18 novembre 2006).
C’est un fait que l’Éducation sentimentale ou Ulysse m’ont toujours paru manquer singulièrement de profondeur. Heureusement, le livre numérique va bientôt remédier à cette criante lacune. On vit une époque formidable.
« Sélection de nouveautés et de classiques high-tech ou la liste des courses pour Noël ! L’occasion de constater que le numérique est devenu le deuxième oxygène de notre quotidien » (Télé-Moustique, 2 décembre 2006, souligné par eux).
Lennie’s Pennies
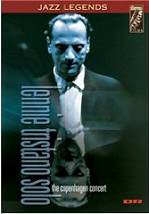 Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Le concert est filmé comme ils devraient toujours l’être. Quelques angles bien choisis, le visage, les mains, des plans longs et le plus souvent fixes, entièrement au service de la musique qui n’en devient que plus captivante.
 Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Anita O’Day (1919-2006)

Bien sûr il y a Ella, Billie, Sarah, sans oublier notre chère Helen Merrill… mais dans notre coeur il y avait, il y aura toujours une place spéciale pour Anita : sa classe et sa gouaille de délurée, ses scats acrobatiques, le grain sensuel de sa voix à tomber raide amoureux, sa science éblouissante du phrasé qui savait vous faire chavirer rien qu’en plaçant une note altérée en bout de phrase, son caractère en acier trempé: il fallait ça pour débuter adolescente dans les marathons dansants façon On achève bien les chevaux, avant de rejoindre le big band de Gene Krupa (elle refuse la robe du soir qui était alors l’apanage des chanteuses pour se produire en veston et jupe courte); et pour affronter bravement des parterres de crétins qui la sifflèrent et l’insultèrent grossièrement à Comblain-la-Tour en 1966 et Paris en 1970 parce qu’elle était blanche.
Elle resta étiquetée chanteuse de big band, et Verve la fit souvent enregistrer avec grand orchestre et arrangements profus, mais elle préférait le travail en petite formation et c’est dans ce contexte qu’elle aura donné le meilleur d’elle-même.
High Times, Hard Times, le titre de son autobiographie résume parfaitement une carrière en dents de scie. Mais cette battante aura survécu aux coups durs, à l’alcool et à la drogue, et continuait, à quatre-vingts ans passés, à se produire sur scène et à donner des interviews de grande dame indigne, réjouissantes d’humour et d’esprit.
Sa discographie disponible reste lacunaire, Verve ayant préféré, à quelques exceptions près, la saucissonner en compils (d’ailleurs bien composées) plutôt que rééditer les albums originaux (plusieurs d’entre eux furent repressés au Japon, mais sont à présent introuvables). Dans l’état actuel du catalogue, on se fera une bonne idée de l’étendue de son art en fréquentant les disques Anita Sings The Winners, Pick Yourself Up, Anita Sings the Most, Jazz Masters 1949 et Anita O’Day’s Finest Hour.
On peut enfin la voir dans Jazz on a Summer’s Day (festival de Newport, 1958), film aussi passionnant qu’agaçant en raison d’un montage absurde qui privilégie les vignettes d’ambiance sur les plaisanciers et les badauds mangeurs d’esquimaux glacés au lieu de se concentrer sur les musiciens. Mais enfin, Anita est là, en robe noire et sous un chapeau extravagant, qui détaille avec une gourmandise narquoise un Sweet Georgia Brown en crescendo avant d’emballer Tea for Two à toute vibure, jusqu’à une finale gag irrésistible. Quelle femme !
***
Addendum (mars 2008). Depuis que ces lignes furent écrites, certains Verve japonais sont à nouveau sporadiquement disponibles sous nos cieux. This Is Anita, Trav’lin’ Light, Waiter, Make mine Blues et Cool Heat (superbement arrangé par Jimmy Giuffre) sont tous d’excellents disques. Sous le titre Anita Sings for Oscar, Lonehill Jazz a réuni sur une seule galette Pick Yourself Up et Anita Sings the Most : excellente affaire (quoi qu’on pense des pratiques peu scrupuleuses de ce label). Néanmoins, il serait grand temps que Verve fasse à Anita l’honneur d’une intégrale soignée, sur le modèle de celles de Lester Young et de Billie Holiday.
Doppelgänger
Relecture des épreuves du Carnet et les Instants. La bibliographie m’apprend que ma camarade mandrillienne Caroline Lamarche vient d’être traduite en letton et que son nom est devenu dans cette langue Karolina Lamarša. Je me prends à imaginer que la traduction a donné vie à ce double exotique, et que tandis que Caroline boit son thé à Liège, Karolina se promène à Riga au bord de la Baltique, le regard lointain, coiffée d’une toque en fourrure. Peut-être, la nuit, rêvent-elles l’une de l’autre.
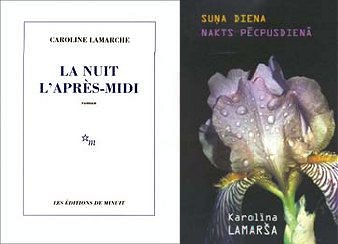
Une étrange amitié
 Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.
Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.
En 1943, Lubitsch est victime d’une crise cardiaque. On annonce aussitôt sa mort, et l’on demande à Raphaelson de rédiger dans l’urgence un hommage au disparu. Le scénariste se sent d’abord paralysé, mais bientôt le déclic se fait et le texte « sortit de moi comme une scène parvenue à maturation [c’est moi qui souligne] ». Non seulement il y dévoile la profondeur de son attachement au cinéaste mais c’est en l’exprimant que, pour la première fois, il en prend conscience. Et cette évidence le foudroie : cet homme était mon ami, et je n’ai pas su le lui dire de son vivant.
Or, Lubitsch survit à son infarctus. L’éloge funèbre est oublié dans un tiroir, la vie reprend son cours. Mais il arrive que la secrétaire de Raphaelson transmet le texte en cachette à celle de Lubitsch, qui le donne à lire à son patron – lequel aura donc l’étrange privilège de lire de son vivant sa notice nécrologique. On ne se méfie jamais assez de sa secrétaire. Je vous laisse la surprise de la scène extraordinaire qui s’ensuivra, lorsque les deux hommes se retrouveront quelques années plus tard pour écrire le scénario de la Dame au manteau d’hermine. Disons seulement que c’est l’un des plus beaux cas de déformation professionnelle qu’on puisse imaginer.
Qu’est-ce que la sincérité entre amis, quelle est, dans l’amitié, la part nécessaire du mensonge ? Et qu’est-ce d’ailleurs que l’amitié ? Sur ces questions sans réponse, et sur ce qu’il suggère entre les lignes du rapport de l’artiste à la vérité, ce livre court – 66 pages – mais riche en résonances laisse longtemps songeur, et son émotion rentrée va droit au cœur.
 Samson RAPHAELSON, Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch. Traduction d’Hélène Frappat. Allia, 2006.
Samson RAPHAELSON, Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch. Traduction d’Hélène Frappat. Allia, 2006.
Ping-pong : sur ce livre, voir aussi Exit Option.
Destination… Out !
Sous cet intitulé emprunté à l’un des meilleurs Blue Note de Jackie McLean se cache un excellent blogue consacré au free jazz, avec nombreux extraits en èmme-pé-trois de disques rares ou épuisés, qui restent accessibles une quinzaine de jours.
À ne pas manquer pendant que c’est en ligne, une pièce aussi brève que volcanique de Pharoah Sanders avec le Jazz Composers Orchestra, Preview, d’une montée en puissance impitoyable. On dirait la bande-son d’un de ces rêves où un désastre imminent va nous foudroyer sur place et qu’on reste paralysé, incapable d’arracher les pieds du sol.
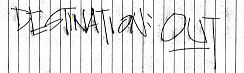
Les invisibles
 Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Dans une villa luxueuse, Claude Rains se réveille. Il fait beau, les petits oiseaux chantent. Le héros caresse un chat voluptueux et magnifique, s’approche de la fenêtre, prend des graines dans une boîte toute prête et les sème sur l’appui. Les petits oiseaux s’approchent, mangent et gazouillent. Lors Rains saisit une raquette, écrase les volatiles, en prend un et, le tendant à son chat : « Breakfast ? »






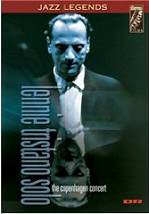 Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…). Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
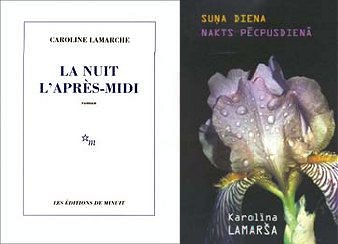
 Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.
Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.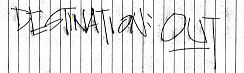
 Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :