Lecture de vacances

David Niven, Mémoires. Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Simone Hilling et Rosine Fitzgerald. Séguier, 2021, 960 p.
David Niven avait un solide talent de raconteur qui fit de lui la coqueluche des soirées d’Hollywood puis, à la fin de sa vie, des talk-shows télévisés anglais. Ce don oral, il sut le transporter tout naturellement à l’écrit (cela ne va pas toujours de soi), si bien que ses mémoires comptent parmi les meilleures autobiographies d’acteur qu’on connaisse. La réédition de Séguier réunit en un fort volume les deux tomes parus dans les années 1970 chez Robert Laffont, Décrocher la lune et Étoiles filantes, épuisés de longue date.
Le premier tome adopte l’ordre chronologique. Le ton est à l’humour et à l’autodérision détachée, comme il sied à toute autobiographie de gentleman anglais. Les étapes du parcours sont classiques mais abondent en anecdotes savoureuses : enfance turbulente, années de vaches maigres et d’expédients, débuts difficiles au théâtre puis au cinéma, ascension vers la gloire. Son passage à l’armée inspire à Niven des pages désopilantes qui font comprendre pourquoi la vie militaire anglaise est un réservoir inépuisable de personnages et de situations ayant inspiré tant de romans, de films et de sitcoms – mais la réalité, naturellement, dépasse la fiction. Parce qu’il a commencé au bas de l’échelle et que sa carrière a coïncidé avec l’âge d’or du cinéma américain classique, il est en mesure de brosser un portrait complet d’Hollywood, depuis la foule anonyme des figurants jusqu’aux moguls des grands studios.
Le deuxième tome est plus inégal – s’y intercalent des pages de fiction qu’on est tenté de lire en diagonale – mais contient certains des meilleurs chapitres de l’ensemble. Il s’agit cette fois, sans souci de chronologie, d’une galerie de souvenirs où Niven se confirme un portraitiste remarquable : Greta Garbo, Clark Gable, Errol Flynn, Douglas Fairbanks, Constance Bennett, Fred et Phyliss Astaire, Cary Grant, George Sanders, Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Ernst Lubitsch, David Selznick, Samuel Goldwyn, les redoutables commères Hedda Hopper et Louella Parsons, et l’on en passe. Le ton est davantage à la mélancolie. C’est désormais un cimetière qu’arpente le comédien, alors que le crépuscule est tombé sur le vieil Hollywood.



Norman Parkinson en mouvement

Les expositions du musée McCord consacrées à la mode sont toujours réussies, qu’il s’agisse de présenter une époque (la mode de l’Expo 67 à Montréal), l’œuvre d’un couturier (Balenciaga) ou celle d’un photographe (Horst P. Horst). L’exposition Norman Parkinson, photographe anglais dont j’ignorais l’existence, ne déroge pas à la règle.
Photographe de mode et portraitiste de vedettes (Audrey Hepburn, David Bowie, Jane Birkin, les Beatles et les Rolling Stones…), Parkinson a été actif durant près de six décennies, des années 1930 à la fin des années 1980. Associé principalement à Vogue, il a collaboré à d’autres magazines, tels que Harper’s Bazaar, Queen et Town & Country. Aussi doué pour le noir et blanc que pour la couleur, il appartient à la génération qui a réinventé la photographie de mode, en délaissant les poses statiques au profit d’un style dynamique et vivant, non dénué d’humour, et en faisant sortir les mannequins des studios pour investir les lieux extérieurs. L’impression de spontanéité qui se dégage de nombre de ses images s’appuie sur un sens très sûr de la composition.
Bien conçue, scénographiée et proportionnée (ni trop ni trop peu), l’exposition présente quatre-vingt photographies et une soixantaine de couvertures de magazines. En regard, une dizaine de robes et d’ensembles splendides de grands couturiers français, italiens et anglais, réalisés entre les années 1930 et 1970.




Chambres


Montréal, rue de La Roche
Lectures expresses
R.C. Sherriff, The Fortnight in September (1931). Persephone Books, 2021.
 Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.
Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.
Chaque année en septembre, la famille Stevens passe quinze jours de vacances à la mer et c’est toute une expédition. Cette année-ci, si les six membres de la famille retrouvent avec plaisir une routine balnéaire immuable, chacun sent confusément que ces vacances ont un parfum de dernière fois. La pension de famille où les Stevens prennent leurs quartiers depuis toujours manifeste des signes de plus en plus flagrants de délabrement. Mais oseront-ils changer de gîte l’année prochaine au risque de peiner leur vieux couple d’hôtes ? Les deux aînés des Stevens ont grandi et s’essaient timidement au flirt sur la plage. Accepteront-ils de revenir l’année prochaine avec papa-maman, ou n’aimeront-ils pas mieux passer leurs vacances avec des jeunes gens de leur âge ? Comme il en va souvent dans les romans de vacances, le plaisir s’ombre de mélancolie.
R.C. Sherriff manie souplement le discours indirect libre, qui lui permet tantôt de présenter la famille comme un bloc uni et tantôt d’envisager tour à tour le point de vue de chacun des Stevens sur les menus événement de la quinzaine. Il réussit remarquablement une grande scène de malaise social, lorsque la famille est invitée à prendre le thé dans la riche villa du patron de M. Stevens. Son écriture fondée sur l’observation minutieuse des détails de la vie quotidienne a cependant son revers : cette histoire est tout de même bien terre-à-terre et tout en reconnaissant le doigté de l’auteur, on s’ennuie un peu à la longue, il faut le dire. Ce point de vue n’est pas partagé outre-Manche, où la réédition du livre a suscité un accueil critique enthousiaste. La préface, extraite des mémoires de Sherriff, où celui-ci raconte la genèse du livre et donne quelques clés de son écriture, est intéressante, à l’instar de quasiment tous les textes où un écrivain ouvre la porte de son atelier.
Chambres

Paris, rue Broca
Retournements

La Belle Espionne (Sea Devils, 1953) réunit toutes les qualités des meilleurs films de Raoul Walsh : la verve picaresque, l’élan narratif, la franchise plastique (belle photo couleur, souvent crépusculaire, de Wilkie Cooper), l’investissement des paysages naturels qui, plus que simple décor, semblent partie prenante de la vie des personnages. À quoi s’ajoute la sûreté de la direction d’acteurs. Excellente comédienne, Yvonne De Carlo se voit confier un rôle d’aventurière plus riche que les emplois stéréotypés où la cantonnait la Universal. Rock Hudson (que Walsh avait pris sous contrat personnel) est employé au meilleur de ses capacités. Et c’est toujours un fin plaisir de voir Brunius à l’écran, ici dans le rôle de Fouché, fait pour lui comme un gant.
Au point de départ de l’écriture du film, le projet d’adapter les Travailleurs de la mer. De cette première intention ne restent que le cadre maritime et quelques allusions. On peut rêver à ce qu’aurait été une adaptation en bonne et due forme du roman de Victor Hugo par Walsh : il était, plus qu’aucun autre à Hollywood, l’homme de la situation. N’importe. À l’arrivée, Sea Devils propose un alliage très séduisant de fantaisie historique, de film d’aventure et de film d’espionnage entre l’Angleterre et la France, au temps des guerres napoléoniennes.
Au lendemain de la vision d’un film de Walsh, ce sont moins des plans en particulier qui restent en mémoire (comme on peut conserver le souvenir net d’un plan tiré au cordeau de Fritz Lang) que l’énergie de leur enchaînement. Il y a ainsi, dans Sea Devils, une séquence admirable dans sa vitesse et sa concaténation, parce qu’elle implique, en l’espace de quelques minutes, un triple retournement de situation.
1. Déclic mental. Fouché comprend soudain que le majordome du château de Rémusat est un espion à la solde des Anglais.
2. Fouché poursuit le majordome jusque dans le pigeonnier du château, pour l’empêcher d’envoyer un message aux Anglais. Il l’abat d’un coup de pistolet. Mais, en expirant, le majordome libère le pigeon voyageur porteur du message. Fatalitas ! Le geste destiné à empêcher une action devient précisément celui qui la fait s’accomplir.
3. Le pigeon franchit la Manche. Les Anglais reçoivent le message et se croient maîtres du jeu. Mais ils ignorent que Fouché sait qu’ils savent. Ils envoient un message de réponse, sans se douter que Fouché l’interceptera à son arrivée et n’aura plus qu’à tendre tranquillement sa souricière.





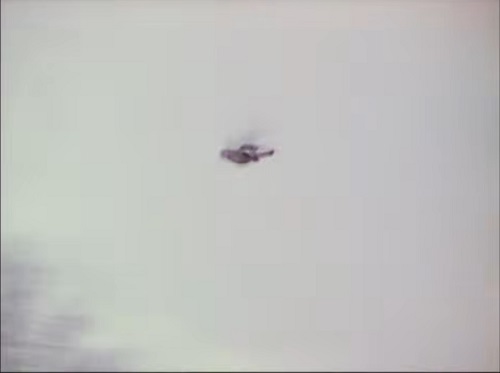
Lectures expresses
Sergueï Dovlatov, le Livre invisible suivi de le Journal invisible. Traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs. La Baconnière, 2023.
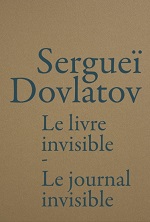 Deux formidables récits en miroir.
Deux formidables récits en miroir.
Le Livre invisible. Récit des tentatives infructueuses de Dovlatov pour publier son premier livre dans l’URSS poststalinienne. Dovlatov n’a rien d’un « dissident » au sens connoté par ce mot, il n’est pas spécialement politisé ; c’est un soutier du journalisme et de la littérature, un conteur né doté d’un solide humour de survie et dont les nouvelles, fondées sur l’observation de la vie quotidienne, rapportent simplement ce qu’il a vu et vécu – mais même cela est impubliable en URSS. Bien entendu, il ne se heurte pas à une censure franche – on ne le menace pas du goulag – mais à une bureaucratie tatillonne et labyrinthique opérant par manœuvres dilatoires, renvoi des responsabilités et petites phrases à sous-entendus. Pour finir, son ultime tentative pour se trouver un éditeur semble enfin en voie d’aboutir, toutes les étapes sont franchies comme par inadvertance mais la publication est bloquée au dernier moment, entre la correction des épreuves et l’envoi sous presse.
Le Journal invisible. Si le récit des déboires d’un écrivain dans un système kafkaïen en décomposition pouvait avoir quelque chose d’attendu, il n’en va pas de même de cette seconde partie qui lui apporte un contrechamp indispensable. Ayant émigré aux États-Unis avec sa femme, Dovlatov s’agrège à une communauté de journalistes russes fraîchement expatriés, qui entreprend de fonder une revue russophone à New York. Le comique d’observation de l’auteur fait à nouveau mouche dans la peinture d’un petit monde vivant en vase clos en ayant transporté dans le « monde libre » son mode de vie en URSS, constitué de personnages diversement excentriques, incompétents ou alcoolisés, combinards par habitude, en complet porte-à-faux avec les règles d’une économie de marché soumise à forte concurrence. L’humour décapant de Dovlatov n’épargne rien ni personne, ni les travers de l’American way of life, ni les discours stéréotypés de ceux qui la critiquent tout en en profitant, ni les postures vertueuses sinon messianiques de la dissidence — comme tous les humoristes, sa première cible est la langue de bois, de quelque bord qu’elle émane —, et il a l’élégance de ne pas s’oublier lui-même en faisant preuve d’autodérision.

















 Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.
Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.






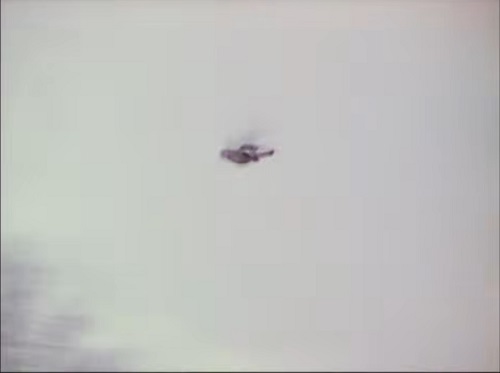
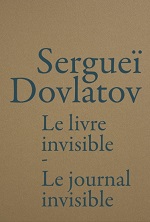 Deux formidables récits en miroir.
Deux formidables récits en miroir.